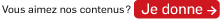R.E.A. - Avant que le gouvernement ne passe cette loi, la communauté d'affaires islandaise avait reconnu la nécessité de diversifier les CA. Cette étape est essentielle. Les associations sectorielles, les groupements d'entrepreneurs, les groupements de femmes, tous s'étaient entendus sur des objectifs communs. Le gouvernement, lui, a mis des chiffres et une date sur ce consensus.
D.B. - Le Québec n'est pas le seul à avoir rejeté les quotas. D'autres États ont préféré les mesures incitatives aux mesures coercitives. Quels résultats l'Islande enregistre-t-elle un an et demi après l'entrée en vigueur des quotas ?
R.E.A. - J'étais sceptique. Tout comme les membres de votre comité québécois, je doutais de l'efficacité des quotas. Mais je dois admettre que cette loi semble porter ses fruits. En un an, la représentation des femmes dans le CA des entreprises islandaises de 50 employés et plus est passée de 10 % à 40 %.
D.B. - L'objectif de cette loi est donc atteint ?
R.E.A. - Pas encore, il ne faut pas confondre la fin et les moyens. Je ne vais pas crier victoire parce que les CA des sociétés islandaises de 50 employés et plus comptent 40 % de femmes. Je veux des résultats tangibles prouvant que nous avons choisi la bonne voie. Cette loi est un moyen d'atteindre une diversité de pensée et de contribution et, ultimement, de multiplier la créativité et l'innovation dans les entreprises. Elle sera un succès si elle a un impact économique. Nous devons donc trouver la façon de mesurer son impact.
D.B. - Selon vous, pour réduire le risque que posent les mères aux employeurs, il faut augmenter celui que posent les pères. Expliquez-nous.
R.E.A. - Laissez-moi vous donner l'exemple du congé parental islandais. Depuis l'an 2000, il ressemble à ceci : trois mois pour la mère, trois mois pour le père et trois mois que les parents peuvent se diviser comme bon leur semble. Si le père ne prend pas son congé, il le perd. Impossible de le transférer à la mère. L'enfant se retrouve donc trois mois plus tôt en garderie. Les parents y pensent deux fois avant de gaspiller ces trois mois. Plus de 90 % des pères prennent leur congé parental. Du coup, cela les rend plus engagés dans la vie domestique. Ils restent à la maison lorsque les enfants sont malades, par exemple. Les employeurs savent que le père sera autant absent que la mère lors des premiers mois qui suivent la naissance, et même après. En fait, depuis cette loi, les hommes constituent une plus grande menace que les femmes pour leur employeur, puisqu'ils peuvent avoir des enfants bien plus longtemps que nous ! (Rires.)