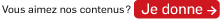En 1969, alors âgé de 30 ans, Ted Turner s’ennuie. Il a hérité de son père une entreprise de panneaux d’affichage publicitaire qui se porte bien, mais… quoi faire, maintenant ? Un domaine l’attire : la télévision. Pourquoi ne pas acheter une chaîne, se dit-il.
« Il n’y connaissait absolument rien. Il avait envie de tout risquer, de faire peur à tout le monde, de vivre des sensations fortes », écrit l’un des nombreux biographes de Ted Turner, Christian Williams, dans Lead, Follow or Get Out of the Way (1981).
###
La chaîne en question, c’est WJRJ (17), à Atlanta, une station indépendante sur la bande UHF qui devait donc être captée au moyen d’une antenne spéciale. Logée dans un immeuble décrépit, à côté d’un funérarium (on disait à la blague qu’elle se trouvait aux portes de la mort), elle utilisait de l’équipement désuet, misait sur du personnel incompétent et n’avait aucune programmation digne de ce nom. Résultat : des pertes de plus d’un demi-million de dollars par an. L’avocat de Ted Turner, Tench Coxe, et son comptable, Irwin Mazo, s’opposaient fermement à l’acquisition de cette chaîne. « Nous avons tenté de lui faire comprendre que, si ce projet pouvait peut-être fonctionner, il pouvait aussi causer sa perte. Et nous n’étions pas les seuls à le mettre en garde, tout le monde l’avertissait », dira Irwin Mazo des années plus tard.
On connaît la suite. Ted Turner n’a écouté personne. Armé de son courage, cet homme aux nerfs d’acier allait remporter l’America’s Cup, affronter les grands réseaux télévisuels, épouser une vedette de cinéma et devenir milliardaire. Il s’habille en cow-boy, donne l’impression de signer des contrats sans les lire. Impulsif, il boit, hurle, bref, il incarne parfaitement l’entrepreneur téméraire qui n’hésite pas à tout risquer. Il achète la chaîne, et c’est ainsi que naît l’un des plus grands empires télévisuels du XXe siècle.
Le savant calcul de Ted Turner
Au-delà de la légende, il faut admettre que Ted Turner n’a pas hérité d’une quelconque entreprise de panneaux publicitaires. Il dirige à l’époque la plus grande société d’affichage extérieur du sud des États-Unis, un secteur très lucratif dans les années 1960 et 1970. Ce commerce bénéficie alors de lois fiscales avantageuses, n’exige pas beaucoup d’investissement en capital et génère des flots de liquidités. Les pertes de WJRJ serviraient donc à compenser l’impôt que paie la société d’affichage. Mieux encore, le réseau d’affichage allait dynamiser la notoriété de la chaîne : grâce à ses nombreux panneaux, libres 15 % du temps, l’entrepreneur pouvait promouvoir gratuitement les émissions de WJRJ.
Sur le plan de la programmation, il avait aussi sa petite idée. À l’époque, les réseaux offraient une gamme complète d’émissions à leurs membres affiliés locaux. Mais ceux-ci choisissaient parfois de diffuser une programmation locale, comme le sport et les actualités, et le contenu national restait alors sur les tablettes. Ted Turner est parvenu à convaincre les réseaux new-yorkais de lui confier toute la programmation inutilisée. « Quand nous avons inscrit à notre grille horaire quotidienne quatre émissions de la NBC qui n’étaient pas diffusées ailleurs, j’ai fait installer des panneaux publicitaires disant : “Le réseau NBC passe à la chaîne 17” », écrit l’homme d’affaires dans son autobiographie, Call Me Ted (2009).
Selon Christian Williams, Ted Turner était «â€Żattiré par le risque » de la transaction. Mais il semble tout aussi plausible de croire que l’entrepreneur a été séduit par l’absence de risque. « Nous ne voulons pas tout risquer, car le jeu n’en vaut pas la chandelle », aurait dit Irwin Mazo à Ted Turner. Tout risquer ? Le prix d’achat de WJRJ n’était que de 2,5 millions de dollars américains, une fraction de ce que valaient les propriétés similaires à l’époque. Mieux encore, Ted Turner a payé au moyen d’un échange d’actions conçu de telle façon qu’il n’a pas déboursé un sou. En moins de deux ans, la chaîne est devenue rentable, enregistrant dès 1973 un profit d’un million de dollars américains.
Avant tout des prédateurs
Dans un récent essai intitulé Portrait de l’homme d’affaires en prédateur, les chercheurs français Michel Villette et Catherine Vuillermot ont tenté de découvrir ce que les entrepreneurs prospères avaient en commun, en se fondant sur des cas concrets de bâtisseurs d’empire — de Sam Walton, fondateur de Walmart, à Bernard Arnault, du conglomérat du luxe LVMH. Dans presque tous les cas, ont-ils conclu, l’individu accumule soudainement un fort capital, réalisant une transaction exceptionnelle qui le catapulte à l’avant-scène. Il profite alors d’un « trou structurel », c’est-à-dire d’un créneau ignoré des autres.
« Ce type d’homme d’affaires, poursuivent Michel Villette et Catherine Vuillermot, cherche des partenaires qui n’ont pas la même définition que lui de la valeur des biens échangés : ils sous-évaluent ce qu’ils lui vendent ou surévaluent ce qu’ils achètent de lui. » Le véritable homme d’affaires prospère, selon ces chercheurs, est donc tout sauf un joueur. C’est plutôt un prédateur, et les prédateurs cherchent à courir le moins de risques possible quand ils chassent.
Des exemples? Giovanni Agnelli, fondateur de Fiat, a financé sa jeune entreprise avec l’argent d’investisseurs — qu’il a ensuite exclus de la société, soulignent les chercheurs. George Eastman, fondateur de Kodak, a transféré le risque financier de sa nouvelle entreprise à sa famille et à son riche ami, Henry Strong. Le fondateur d’IKEA, Ingvar Kamprad, a fait fabriquer ses meubles en Pologne communiste pour la moitié de ce qu’il lui en aurait coûté en Suède. Enfin, Marcel Dassault, pionnier français de l’aviation, a effectué, pour le compte de l’armée française, une étude qui souli¬gnait la valeur des hélices… puis a racheté un fabricant d’hélices !
« Ce type-là est fou raide »
L’entrepreneur le plus prospère de Wall Street, du moins au cours de la dernière décennie, est un gestionnaire de fonds spéculatifs (hedge funds) dénommé John Paulson. Sa carrière a débuté lentement et relativement tard, puisqu’il a lancé sa petite entreprise de gestion financière en 1994, à près de 40 ans. Il allait pourtant en faire un mastodonte. Le récit de son aventure, The Greatest Trade Ever, de Gregory Zuckerman, illustre à merveille la thèse du prédateur.
Fils d’un père immigrant, John Paulson a grandi dans le Queens, au sein d’une famille de classe moyenne. En 2004, il gérait deux milliards de dollars américains, ce qui le plaçait au milieu du peloton des fonds spéculatifs. Selon Gregory Zuckerman, c’était « un investisseur solide, prudent et sans éclat ». Ses transactions figuraient « parmi les placements les plus sûrs ». Il avait notamment pour mentor un certain Marty Gruss, « pour qui l’investissement idéal comportait un risque limité et la promesse d’une plus-value substantielle ». Dans cette optique, Paulson demandait sans cesse à ses analystes : « Combien risquons-nous de perdre dans cette transaction ?»
Au tournant de 2004-2005, John Paulson commence à se méfier du boom immobilier. Il décide de court-circuiter le marché hypothécaire, en utilisant un instrument financier appelé « swap sur défaillance » (credit-default swap, ou CDS), qui correspond grosso modo à une police d’assurance. Il achète une tonne de contrats de CDS, trouvant même de nouveaux investisseurs quand il manque d’argent. À l’éclatement de la bulle, il détient des assurances sur quelque 25 milliards de dollars américains en hypothèques à haut risque. Il fait donc fortune quand les Américains ne parviennent plus à rembourser leurs emprunts hypothécaires.
John Paulson a-t-il couru un risque en achetant autant de CDS ? Selon la sagesse populaire, oui. Dans le jargon de la finance, il s’agit d’une transaction à portage négatif : si elle n’est pas rapidement rentable, elle peut devenir ruineuse. Pour qu’elle soit avantageuse, il faut non seulement deviner la présence d’une bulle, mais aussi prévoir à quel moment elle éclatera.
Un jour, avant l’effondrement immobilier, un opérateur en Bourse de Morgan Stanley raccroche après avoir reçu une nouvelle commande de CDS de la part de Paulson. Il se tourne vers un collègue, incrédule : « Ce type-là est fou raide », lui dit-il avec un petit rire, ébahi de constater que John Paulson accepte de faire d’aussi nombreux versements d’assurance annuels qu’exigent les CDS. Aux yeux de Wall Street, il était fêlé.
L’était-il vraiment ? L’adjectif « méticuleux » conviendrait mieux. En 2006, sa firme a entrepris une analyse rigoureuse du marché immobilier dirigée par Paolo Pellegrini, l’associé de John Paulson. « Ils ont fait des calculs, joué avec des logarithmes et des fonctions logistiques, évalué divers scénarios, imaginant ce qui se passerait si le prix des maisons cessait d’augmenter. Leurs découvertes étaient ahurissantes : même si les prix se stabilisaient, sans plus, les propriétaires sentiraient une telle pression financière que cela entraînerait des pertes de 7 % de la valeur du groupe-type de prêts hypothécaires à risque. Et si le prix des maisons diminuait de seulement 5 %, cela entraînerait des pertes allant jusqu’à 17 %», écrit Gregory Zuckerman.
Il s’agit d’une découverte cruciale. À l’époque, la plupart des analystes croient que le grand nombre de cessations de paiement sur hypothèques provient d’une combinaison de facteurs économiques structurels, tels que le taux de chômage, les taux d’intérêt élevés, voire la santé économique régionale. C’est pourquoi tant d’investisseurs de Wall Street aiment vendre à John Paulson des swaps sur défaillance : ils pensent que seule une tempête parfaite peut causer un effondrement du marché. Mais les données de Paolo Pellegrini montrent au contraire que la bulle n’est gonflée que par un seul facteur : l’augmentation du prix des maisons. Il suffit donc de très peu pour que la bulle éclate.
« Il n’y a jamais eu d’occasion semblable », déclare John Paulson à un collègue en enfilant les paris. Jamais dans cent ans ! Dans l’une des nombreuses scènes mémorables décrites dans son livre, Gregory Zuckerman explique comment une baisse de cinq points de ce qu’on appelle « l’indice ABX » (une mesure de la santé hypothécaire) a rapporté à John Paulson, en une seule matinée, 1,25 milliard de dollars américains. En 2007, au plus fort de la crise immobilière, Paulson & Co. a récolté des profits de 15 milliards, dont quatre empochés par John Paulson lui-même. En 2008, les revenus de son entreprise s’élèvent à cinq milliards. Dans toute cette histoire, peu de gens ont gagné autant d’argent en si peu de temps.
Une aversion viscérale au risque
L’histoire de Paulson illustre à quel point le prédateur diffère de l’idée qu’on se fait généralement de l’homme d’affaires prospère. Le modèle risque-tout suggère que le plus grand avantage de l’entrepreneur réside dans son tempérament téméraire. Selon le modèle du prédateur, l’entrepreneur possède en fait un avantage d’ordre analytique : il perçoit mieux que nous une occasion d’affaires. John Paulson a examiné le même marché que tous les autres professionnels de Wall Street, mais il en a tiré des conclusions différentes. Étranger au monde immobilier, il avait un regard neuf et était plus à l’aise que ses concurrents en ce qui concerne les transactions à portage négatif. Il a cherché et trouvé des partenaires n’ayant pas la même vision que lui de la valeur des actifs échangés (c’est-à-dire les banques, qui vendaient des swaps sur défaillance pour un sou par dollar), puis a exploité impitoyablement cet avantage.
Gregory Zuckerman compare John Paulson à trois autres investisseurs qui ont fait le même pari sur les prêts hypothécaires à haut risque : Greg Lippmann, opérateur à la Deutsche Bank, Jeffrey Greene, magnat de l’immobilier de Los Angeles, et Michael Burry, qui dirigeait un fonds spéculatif établi dans la Silicon Valley. Une constante se dessine : tous avaient une confiance suprême en leurs décisions, tous avaient fait des recherches approfondies, et tous s’étaient rabattus, tels de parfaits prédateurs, sur une anomalie du marché. Fait à noter, aucun de ces hommes n’avait le tempérament propice à la moindre prise de risque. S’ils se démenaient autant pour trouver la transaction la plus sûre, c’était parce que tout le reste leur donnait des ulcères.
Une leçon pour les actionnaires
L’histoire de John Paulson jette un tout nouvel éclairage sur les idées reçues et généralement acceptées à propos des politiques de rémunération des entreprises. L’un des principaux arguments en faveur des généreuses options d’achat d’actions, si souvent accordées aux PDG, c’est qu’elles sont nécessaires pour encourager la prise de risque chez les dirigeants. Cette idée provient de ce qu’on appelle la « théorie de l’agence », qui constitue, selon Freek Vermeulen, de la London Business School, « l’une des rares théories avancées par des universitaires qui ait eu une influence véritable sur le monde de la gestion ». En vertu de cette idée, « les gestionnaires sont par nature réfractaires au risque, beaucoup plus que les actionnaires ne le voudraient. Et la théorie recommande de leur donner des options d’achat d’actions plutôt que des actions, pour les inciter à prendre davantage de risques. » Pourquoi les actionnaires veulent-ils que les gestionnaires prennent plus de risques ? Parce qu’ils souhaitent que des sociétés prudentes deviennent plus audacieuses et croient que la prise de risque est le propre d’entrepreneurs audacieux.
Dans son livre The Illusions of Entrepreneurship, l’économiste Scott Shane développe une argumentation semblable. Oui, beaucoup d’entrepreneurs prennent un tas de risques — mais ce sont généralement des entrepreneurs ratés, et non ceux qui réussissent. Les ratés enfreignent toutes sortes de principes, et ce, dès la création de leur entreprise. Par exemple, le succès d’une nouvelle société dépend en grande partie de sa capitalisation initiale. Or, les entrepreneurs ratés ont tendance à être largement sous-capitalisés. Dans le même esprit, il vaut mieux se lancer avec des partenaires, mais les entrepreneurs ratés ont tendance à être les seuls propriétaires de l’entreprise. Rédiger un plan d’affaires est vital ; les entrepreneurs ratés s’en donnent rarement la peine. Racheter une firme existante est toujours la meilleure chose à faire ; les ratés préfèrent partir de zéro. La liste est sans fin : ils n’insistent pas suffisamment sur le marketing, ne comprennent pas l’importance des contrôles financiers, tentent de concurrencer au moyen des prix, etc. Scott Shane reconnaît que certains de ces risques sont inévitables : les entrepreneurs les prennent parce qu’ils n’ont pas le choix. Cela dit, un grand nombre de ces risques reflètent un manque de préparation ou de prévoyance.
Le modèle de l’échec en entreprise décrit par l’auteur rappelle la fameuse expérience menée par David McClelland, un psychologue de Harvard, auprès d’enfants en garderie, au cours des années 1950. David McClelland regardait des enfants jouer aux anneaux — un jeu qui consiste à lancer des anneaux de façon à les enfiler sur un poteau. Les enfants qui jouaient à ce jeu de la manière la plus risquée, c’est-à-dire en s’éloignant tellement du poteau qu’ils n’avaient aucune chance de réussir, étaient aussi ceux qui obtenaient le moins de points quant au désir de réussir. (Un autre groupe au score inférieur se situait à l’autre extrême et se tenait si près du poteau que le jeu cessait d’en être un.)
Prendre des risques excessifs est donc une stratégie de protection psychologique : si on s’éloigne suffisamment du poteau, personne ne peut nous blâmer en cas d’échec... Ces enfants s’appliquaient à prendre un risque « professionnel » afin d’éviter un risque personnel. C’est ce que présument les sociétés en faisant leurs offres démesurées d’options d’achat d’actions : des paris si extravagants que, si le joueur perd, cela ne met pas en jeu son statut social dans le milieu des affaires. « Tant et aussi longtemps que la musique joue, il faut continuer à danser »: voilà ce qu’avait déclaré Charles Prince, ex-PDG de Citigroup, alors que sa société accumulait les investissements douteux. Il craignait davantage pour son image que pour la santé financière de son entreprise.
Un brin de romantisme
Revenons à notre ami Paulson. Après avoir terminé sa recherche sur le marché hypothécaire qui montrait à quel point le prix des maisons était gonflé, Paolo Pellegrini s’est empressé d’aller montrer les résultats à son patron. Voici comment Gregory Zuckerman décrit la scène:
C’est incroyable! » s’exclame Paulson, incapable de détourner les yeux du tableau. Un sourire espiègle se forme sur son visage, comme si Pellegrini venait de partager un secret inestimable. « C’est notre bulle! C’est la preuve. Maintenant, on peut le prouver », lance John Paulson. Pellegrini sourit, masquant difficilement sa fierté. Ce tableau était la pierre de Rosette de Paulson, la clé permettant de décoder tout le marché résidentiel. Des années plus tard, il le garde encore sur son bureau, par-dessus une pile de papiers, l’étale devant ses clients et le met à jour chaque mois à l’aide de nouvelles données, comme un collectionneur de voitures qui cire et caresse affectueusement une auto antique de grande valeur... « Je le regarde encore. J’adore ce tableau », dit régulièrement l’homme.
Il y a un certain nombre de moments comme celui-ci dans The Greatest Trade Ever, où l’on perçoit à quel point John Paulson aimait son travail. Oui, il voulait gagner de l’argent. Mais il était fabuleusement riche bien avant de s’intéresser au marché hypothécaire. Sa véritable motivation était le défi de résoudre un problème particulièrement complexe. Il était comme un enfant devant un puzzle. Cela recoupe la seule découverte incontestée de toute la recherche sur l’entrepreneuriat : ceux qui travaillent à leur compte sont beaucoup plus heureux que les autres.
Et le goût du risque, lui ? Quand les sociologues Hongwei Xu et Martin Ruef ont demandé à un vaste échantillon d’entrepreneurs de choisir entre trois possibilités — une entreprise au profit potentiel de cinq millions de dollars américains avec 20 % de chances de succès, une deuxième qui ferait un profit de deux millions avec 50 % de chances de succès, ou une troisième au profit de 1,25 million avec 80 % de chances de succès —, la plupart d’entre eux ont opté pour la troisième, plus sûre. Peu se sont laissé tenter par la mince possibilité d’empocher cinq millions, et beaucoup ont été attirés par les 80 % de chances de faire ce qu’ils aimaient. Le prédateur est un acteur suprêmement rationnel. Mais au fond, c’est aussi un romantique, motivé par la simple joie qu’il trouve dans son travail. Au diable le risque !
Rien n’arrête le prédateur
Dans Call Me Ted, Ted Turner raconte l’un de ses pre¬miers grands traumatismes. Lorsqu’il avait 24 ans, son père s’est suicidé. Depuis des mois, ce dernier souffrait de dépression et, un jour, après le petit-déjeuner, il est monté à l’étage et s’est tué d’une balle. Après les funérailles, on a appris que, la veille de sa mort, le père de Ted avait vendu les joyaux de l’entreprise familiale — les biens immobiliers de General Outdoor — à un certain Bob Naegele. Affligé de douleur, Ted Turner a décidé de se battre bec et ongles pour récupérer le bien familial.
Débauchant le service du bail à long terme de General Outdoor, il a fait passer dans son camp les biens immobiliers sur lesquels étaient installés les panneaux d’affichage publicitaire de l’entreprise familiale, pour annuler ces baux et en signer de nouveaux avec Turner Advertising. Puis, il s’est envolé vers Palm Springs pour obliger Bob Naegele à lui remettre la société. Ted Turner, l’acteur rationnel, a négocié l’entente. Mais c’est Turner le romantique qui, au moment où il souffrait le plus, avait décidé de se battre.
Ce que l’homme d’affaires a compris, c’est qu’aucune de ses ambitions grandioses n’était possible sans la vache à lait que représentaient les panneaux d’affichage. Il avait éprouvé la joie de régler un problème très complexe, et ne pouvait plus y renoncer.
En passant, Bob Naegele a exigé 200 000 dollars américains, une somme que Ted Turner n’avait pas. Mais celui-ci s’est aperçu qu’il était absurde, lorsqu’on était dans la tranche de revenus de Bob Naegele, de recevoir une si modeste somme. Il a donc répliqué par une offre de 200 000 dollars en actions de Turner Advertising. « J’ai enlevé l’entreprise à Naegele, et cela ne m’a pas coûté un sou comptant », écrit-il dans son autobiographie. Bien sûr que Ted Turner n’a pas payé : c’est un prédateur. Pourquoi diable aurait-il pris un tel risque?