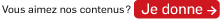Après des décennies d’exploitation, les professionnels de haut niveau ont vu leurs salaires augmenter de façon exponentielle. Les joueurs de baseball sont ainsi devenus multimillionnaires et les PDG se sont payé des jets privés. Comment expliquer une telle métamorphose ? Malcom Gladwell raconte.
Auteur : Malcolm Gladwell, The New Yorker
Lorsque Marvin Miller a pris la direction de la Major League Baseball Players Association, en 1966, il s’est vite aperçu que ses membres ignoraient tout de la vie syndicale. Il leur expliquait que leurs contrats étaient injustes, que leur part des profits était ridicule, que leur régime de retraite et leurs prestations de soins de santé étaient anémiques, que leur sort pourrait s’améliorer s’ils se prenaient en main. Mais les joueurs restaient sourds à ses arguments. C’est qu’ils étaient jeunes et venaient pour la plupart de petites villes éloignées des foyers du syndicalisme. De plus, ils se sentaient privilégiés : ne s’offraient-ils pas du steak au restaurant en plus d’être acclamés par des milliers de fans ?
Même lorsque Miller leur parlait du commerce fort lucratif des cartes de baseball, les joueurs demeuraient inconscients de leur valeur et des bénéfices qu’ils pourraient en tirer. « Les représentants de la compagnie de gomme à mâcher Topps faisaient régulièrement le tour des ligues mineures, raconte Miller. Quand les dépisteurs de talent leur signalaient un joueur promis à une carrière dans les ligues majeures, ils s’empressaient de lui faire signer un contrat. Et vous avez combien ils le payaient ? Cinq dollars ! En 1966, 1967, un joueur recevait cinq maigres dollars. En échange, la compagnie possédait les droits d’exploiter l’image du joueur pendant cinq ans, sans lui verser de pourcentage sur les ventes, contrairement à ce qui se fait dans ce genre de transaction. S’il parvenait à se hisser dans les ligues majeures, le joueur touchait 125 dollars américains par année, ce qui donnait à la compagnie le droit de prendre sa photo, de s’en servir à des fins publicitaires, de la mettre sur une carte, avec son nom et ses statistiques à l’endos. Chaque fois que cela se produisait, j’interrogeais les joueurs : “Pourquoi signez-vous ?” Invariablement, ils me répondaient d’un air penaud : “Quand j’étais petit, je collectionnais ces cartes ; et aujourd’hui, c’est moi qui suis dessus !” »###
Il n’y a pas si longtemps, les personnes qui étaient au sommet de leur profession — les talentueux — ne gagnaient pas beaucoup d’argent. Dans les années d’après-guerre, les juristes d’entreprise, les investisseurs de Wall Street, les cadres des entreprises du Fortune 500 et les athlètes professionnels ne gagnaient qu’une fraction de ce qu’ils gagnent aujourd’hui. Dans le monde du baseball, le salaire minimum ainsi que le salaire supérieur ont chuté de plus de 33 %, en dollars constants, entre le milieu des années 1940 et celui des années 1960. De même, aux États-Unis, un avocat gagnait en 1935 quatre fois le revenu moyen par habitant ; en 1958, ce rapport n’était plus que de 2,4.
En 1956, Roswell Magill, un associé chez Cravath, Swaine & Moore, s’est fait le porte-parole de toute une génération en écrivant que les cabinets d’avocats « ne sont tout bonnement plus en mesure de promettre aux jeunes gens qu’en devenant associés ils pourront faire des économies substantielles, se faire construire des maisons de campagne avec un jardin, comme leurs pères et leurs grands-pères l’ont fait avant eux, ou s’offrir des vacances en Europe ».
De salaire minable à traitement de star
Puis, le monde a basculé. Les impôts ont commencé à diminuer. Les salaires versés aux professionnels de haut niveau ont connu une hausse exponentielle. Les joueurs de baseball sont devenus multimillionnaires et les PDG se sont payé des jets privés. Puis, contre toute attente, les années 1970 ont donné lieu à une véritable résurrection du salarié.
L’histoire de cette métamorphose peut être relatée de bien des façons. Ainsi, les économistes évoquent la mondialisation de l’économie et l’avènement d’un modèle économique qu’on peut résumer par la phrase « Au plus fort la poche » (ce que Robert Frank et Philip Cook appellent la winner-take-all economy). Quant aux politologues, ils rappellent que le consensus social a évolué dans le sens des privilégiés : les impôts ont baissé et l’engagement envers la parité économique s’est dégradé. Cela dit, il y a une pièce cruciale du puzzle qu’il ne faut pas négliger. Comme le faisait valoir il y a quelques années Roger Martin, doyen de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto, au Harvard Business Review, « les gens qu’on peut qualifier de “talentueux” se sont rendu compte qu’ils détenaient quelque chose de relativement rare par rapport à ce que les “possédants” avaient à leur disposition ». Et à qui doit-on une telle prise de conscience ? Aux Marvin Miller de ce monde.
La faute à Marvin Miller ?
Aujourd’hui, Marvin Miller a plus de 90 ans. Maigre et frêle, il vit à Manhattan dans un modeste gratte-ciel de l’Upper East Side garni de gravures japonaises. Avant de faire son entrée dans le baseball, Miller était économiste en chef au Syndicat des métallos. Il était présent pendant les huit jours que dura la séance épique de négociation avec la Maison-Blanche, en 1965, qui a permis d’éviter de justesse une grève en pleine guerre du Vietnam. Par son tempérament, mais aussi grâce à son expérience, Miller demeure le syndicaliste par excellence, une espèce qui se fait de plus en plus rare.
Son premier mandat dans le monde du baseball l’a placé à la tête d’un syndicat qui n’en était pas un : c’était une simple association de joueurs. Chaque équipe élisait son représentant, et les représentants formaient un comité informel dirigé par un conseiller à mi-temps que les propriétaires se chargeaient de sélectionner et de rémunérer. Autrement dit, les proprios faisaient ce qu’ils voulaient.
Quelques mois après son embauche, Miller a été invité à assister à une réunion du conseil exécutif du baseball majeur, à Chicago. Il y découvrit que la ligue avait décidé de mettre fin à l’accord sur le financement du régime de pension des joueurs, qui prévalait depuis 10 ans. Jusqu’alors, les propriétaires versaient aux joueurs 60 % des revenus provenant de la diffusion de la Série mondiale. Mais, comme ils s’apprêtaient à signer une entente beaucoup plus importante avec les réseaux de télévision, les proprios avaient décidé que 60 %, c’était trop.
Miller, qui avait à son actif une centaine de négociations syndicales, fut abasourdi par la décision sans appel des propriétaires. Il n’avait pas de personnel à l’époque et ne disposait pratiquement d’aucun budget. Il devait ainsi affronter un groupe de propriétaires réunissant les hommes les plus riches d’Amérique, contre qui les joueurs avaient perdu chacun de leurs procès, y compris en Cour suprême. Pourtant, lorsque Miller s’opposa aux propriétaires, ces derniers capitulèrent. Il finit par gagner la bataille des revenus générés par la télévision. Il rebâtit le régime de retraite des joueurs. Il força la direction à admettre les joueurs à la table des négociations. Il gagna le droit de soumettre les différends salariaux et autres griefs à l’arbitrage exécutoire, une victoire qu’il décrit comme ayant fait « la différence entre la dictature et la démocratie ». Miller n’imaginait pas que la lutte serait aussi aisée. À un certain moment, il voulut que les propriétaires utilisent l’excédent des revenus provenant du régime de retraite pour bonifier les avantages sociaux. Les propriétaires refusèrent carrément et c’est à contrecœur que Miller entraîna les joueurs à faire la grève — une première dans l’histoire du sport professionnel. Cette fois, se disait-il, la lutte allait être longue et âpre. Il se trompait ; après 13 jours, les propriétaires abdiquaient. Le journaliste Leonard Koppett a d’ailleurs résumé de manière savoureuse l’allure des négociations dans le Times :
— Les joueurs : « Nous voulons des prestations de retraite plus élevées. »
— Les proprios : « Vous n’aurez pas un sou. »
— Les joueurs : « L’argent est déjà là. Laissez-le-nous gérer à notre façon. »
— Les proprios : « C’est trop risqué. »
— Les joueurs : « Nous l’avons déjà fait, et de toute façon nous ne jouerons que si nous pouvons avoir une partie de cet argent. »
— Les proprios : « O.K. d’abord. »
Des capitaux qui capitulent
L’idée que même les riches détenteurs de capitaux pouvaient être vulnérables traversa l’esprit des professionnels au milieu des années 1970, soit au même moment où Miller entraîna ses joueurs à faire la grève. Mais comment expliquer un tel effritement ? Dans une récente édition du Managerial and Decision Economics, les économistes Aya Chacar et William Hesterly proposent une réponse qui s’inspire du travail d’Alan Page Fiske, un anthropologue de la University of California, Los Angeles (UCLA). Selon Fiske, les gens ont recours à un des quatre modèles suivants lorsqu’ils interagissent socialement : le partage collectif, la réciprocité des services, le prix du marché et le respect hiérarchique. Il y a partage collectif lorsque des colocataires se donnent la permission de consulter les livres et de porter les vêtements des uns et des autres. La réciprocité des services, c’est le covoiturage : « Je dépose ton enfant à l’école aujourd’hui, tu conduis le mien demain. » Le prix du marché, c’est lorsque les conditions d’échange sont négociables, ou sujettes aux lois de l’offre et de la demande. Enfin, le respect hiérarchique, c’est le paternalisme, un système autoritaire par lequel « les supérieurs s’approprient ou confisquent ce qu’ils désirent », dixit Fiske, et où « ils ont la responsabilité qui incombe à un pasteur de s’occuper de leurs subordonnés dans le besoin et d’assurer leur protection ».
Qu’un paradigme soit meilleur qu’un autre, là n’est pas la question. L’argument de Fiske, c’est que les êtres humains choisissent la forme d’interaction qui est la plus appropriée à une circonstance donnée. L’anthropologue donne l’exemple d’un dîner que vous donnez. Vous achetez la nourriture dans un magasin, où vous payez les articles à un prix proportionnel à leur valeur. C’est le prix du marché. Vous avez peut-être invité certaines personnes parce qu’elles vous ont invité à un dîner dans le passé : c’est la réciprocité des services. Au cours du dîner, chacun est censé se servir soi-même (partage collectif), mais, en tant qu’hôte, c’est vous qui assignez leur place à vos invités, qui obtempèrent (respect hiérarchique). Supposons que vous intervertissiez les modèles qui régissent votre dîner. Si vous choisissez de faire jouer la réciprocité des services pour la nourriture, le partage collectif pour les invitations, le respect hiérarchique pour déterminer qui mange quoi et le prix du marché pour les places, il est possible que la nourriture, les invités et le lieu soient inchangés, mais à la place d’un dîner vous aurez une soirée-bénéfice. Autrement dit, le modèle retenu dans une situation donnée aura une profonde incidence sur la nature même de l’interaction. Comme l’expliquent Chacar et Hesterly, si nos interactions avec les talentueux ont connu une telle métamorphose, c’est parce que les modèles relationnels dans le monde professionnel ont changé brusquement.
Quand Miller a pris la tête du syndicat des joueurs en 1966, le baseball était gouverné par la clause dite de réserve. Grâce à cette disposition, un club pouvait détenir les droits sur un joueur à perpétuité — autrement dit, à partir du moment où un joueur signait un contrat des ligues mineures, il devenait la propriété de son équipe et n’était plus libre de jouer où il voulait. Lors de ses rencontres avec les joueurs, Miller ne perdait pas une occasion de répéter que ce système était mauvais. Mais il fut très difficile de convaincre les joueurs de l’aspect pernicieux de cette clause.
Il faut dire que l’attitude des joueurs était l’incarnation du respect de l’autorité. Les joueurs ne se sentaient pas exploités : leurs salaires n’étaient peut-être pas aussi élevés qu’ils auraient pu l’être, mais ils étaient plus élevés que ceux de leurs camarades d’enfance. De plus, les propriétaires prenaient soin d’eux d’une manière paternaliste. Par exemple, un propriétaire pouvait récompenser un joueur qui venait de disputer un excellent match en lui refilant un billet de 50 $, ou défrayer les frais médicaux de son enfant malade. Pour les joueurs, la clause de réserve était satisfaisante parce qu’ils obéissaient à un modèle selon lequel il valait mieux laisser les propriétaires prendre toutes les décisions. Selon Chacar et Hesterly, « les économistes ont tendance à croire que les agents qui se trouvent du mauvais côté de la table des négociations se battront pour obtenir la parité. Un tel raisonnement suppose toutefois que les agents en question abordent les relations économiques d’un point de vue commercial. » Or, avant que Miller ne fasse des miracles au sein de ses équipes, les joueurs n’avaient tout bonnement pas pris conscience de cette réalité.
D’autant qu’en ce temps-là, l’autorité hiérarchique prévalait même à Wall Street. Un exemple éloquent ? En 1956, le président de Goldman Sachs, Sidney Weinberg, réalisa pour la Ford Motor Company ce qui constituait de loin le premier appel public à l’épargne le plus important de l’histoire. Dans The Partnership, Charles Ellis décrit ainsi l’entente préalable :« Lorsque Henry Ford demanda d’entrée de jeu à Weinberg quels seraient ses honoraires, ce dernier refusa de donner une somme précise et proposa plutôt qu’on lui verse un dollar par année jusqu’au terme de la transaction ; la famille Ford déciderait ensuite de la valeur réelle de ses efforts. Au-delà de ses honoraires, Weinberg aimait à répéter qu’il appréciait la lettre manuscrite pleine d’affection que Ford lui avait envoyée, dans laquelle celui-ci écrivait, entre autres propos flatteurs : “Sans vous, nous n’aurions pas réussi.” Weinberg fit encadrer la lettre et l’accrocha dans son bureau, et il se plaisait à dire : “En ce qui me concerne, c’est ma plus grande récompense.” C’était une boutade qui n’était pas loin de la réalité. On estimait à l’époque que ses honoraires s’élevaient à un million de dollars américains. Mais c’était très loin du compte : ses deux années de travail, couronnées d’un succès phénoménal, lui valurent à peine 250 000 $. Amèrement déçu, Weinberg ne révéla jamais la somme qu’il avait reçue. »
Un dollar par année ? Aucun banquier de nos jours ne s’en remettrait aussi aveuglément à un client pour fixer sa rémunération. Outre l’ajout de quelques zéros au traitement salarial consenti, ce sont les relations entre le banquier et le client qui ont changé : elles sont dorénavant sujettes à négociation.
Il y a quelques années, lorsque Robert Nardelli a quitté Home Depot, il a touché des indemnités de départ de 210 millions de dollars américains, et ce, en dépit de l’insatisfaction du conseil d’administration à son égard. Si l’entreprise lui a accordé un tel parachute doré, c’est en raison de la clause que le PDG déchu avait fait inscrire dans son contrat d’embauche. Et ce qui avait poussé Home Depot à acquiescer aux demandes de Nardelli, c’est qu’à notre époque les « possédants » ont l’habitude de céder aux requêtes des « talentueux » — même lorsque ceux-ci manquent singulièrement… de talent.
L’ennui avec l’ancien système hiérarchique, c’était l’arrogance, c’est-à-dire la présomption que le monde devait impérativement obéir aux caprices des riches détenteurs de capitaux. L’ennui avec l’ordre nouveau, c’est sans contredit la cupidité — la présomption que les talentueux méritent tout ce qu’ils arrivent à extorquer. Comme le souligne Roger Martin, de la Rotman School of Management, « la question que se pose cette classe professionnelle n’est plus “Quelle somme me suffirait ?” mais “Quelle somme me ferait plaisir ?” »
Dix ans avant que Marvin Miller ne fasse son entrée dans le monde du baseball, Stan Musial, un des plus grands baseballeurs de l’histoire, connut sa pire saison chez les pros, avec une moyenne au bâton de 76 points inférieure à sa moyenne en carrière. Musial alla alors trouver le directeur général de son équipe afin qu’il prélève 20 % de son salaire, qui s’élevait à 100 000 $. Miller aurait été scandalisé par cette histoire, car, même à son salaire initial, Musial était honteusement sous-payé. Miller aurait aussi fait remarquer que l’équipe de Musial ne lui aurait jamais accordé de façon unilatérale une augmentation de 20 % s’il avait joué brillamment cette saison-là. Le syndicaliste aurait eu raison dans les deux cas. Mais on ne peut s’empêcher, à une époque où les cadres ratés touchent des salaires princiers et où les gestionnaires de fonds spéculatifs ont un train de vie digne des requins de l’industrie à l’âge d’or du chemin de fer, de ressentir un peu de nostalgie devant l’explication fournie par Musial pour justifier sa demande de diminution de salaire : « Il n’y avait rien de noble là-dedans. J’ai eu une mauvaise année, et je ne méritais pas une telle somme d’argent. »