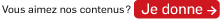Ça n'a pas été long : le lendemain de l'annonce de la vente de Rona à Lowe's, Robert Lafont s'est fait dire qu'on n'avait plus besoin de lui. En termes polis, les services de sa firme n'étaient plus requis.
La perte des sièges sociaux et le déplacement du pouvoir, c'est ça. Quand le nouveau propriétaire arrive, il fait le ménage dans ses fournisseurs. Il en a le droit : c'est lui le boss, c'est lui qui décide.
On fait état des équipementiers québécois qui s'interrogent sur le sort de leurs futures commandes chez Rona. Avec raison. Mais l'impact est bien plus grand. Toutes les entreprises qui ont, ou avaient, des relations d'affaires sont désormais en ballotage. C'est ce qui arrive aux cabinets d'avocats, de comptables, de relations publiques ou de services financiers, comme Lafont, autrefois chargé de gérer les programmes d'assurances collectives des employés de Rona.
Dans ce cas, le travail se fera dorénavant à partir de Toronto. Encore une fois.
Robert Lafont gère une firme bien établie dont l'origine remonte à 1968 et qui a pris son nom lorsqu'il en est devenu président en 1984. C'était la grande époque du Régime d'épargne-actions, de l'effervescence dans l'entrepreneuriat québécois, dont le monde québécois du service-conseil a bien profité.
Mais y a-t-il essoufflement ? Deux générations plus tard, beaucoup d'entreprises sont à un tournant. «Quand elles atteignent un seuil, plusieurs connaissent un changement structurel, c'est dans l'ordre des choses, dit-il. Ce qui me heurte, c'est cette perte automatique d'influence dans leur milieu lorsqu'elles sont vendues à des étrangers.»
On en a moins parlé, mais l'industrie québécoise de la publicité n'échappe pas au phénomène. La plupart des grandes agences ont maintenant de nouveaux propriétaires. Coup sur coup, Cossette, Bos et Sid Lee sont passées entre les mains de firmes asiatiques. Et Robert Lafont de s'interroger : «Est-ce normal qu'un secteur lié d'aussi près à notre culture dépende maintenant de l'extérieur ? demande-t-il, lui qui a participé de près au développement de certaines de ces agences et qui a dû s'effacer par la suite, lors du changement de garde. «Ça se fait parfois civilement, dans la dignité, mais les liens disparaissent quand même.»
Les nouveaux propriétaires finissent immanquablement par imposer leurs propres réseaux, et les anciens fournisseurs écopent. Il faut alors que ceux-ci repartent à la chasse de nouveaux contrats. Robert Lafont n'y échappe pas, lui dont la firme compte quelques centaines d'employés à Montréal et dans ses bureaux régionaux.
Il risque de connaître prochainement une autre déconvenue avec l'annonce de la cession prochaine de la chaîne de pharmacies Uniprix au géant américain McKesson, par l'intermédiaire de sa filiale canadienne. Le siège social est situé à Toronto. Ses liens d'affaires avec Uniprix seront-ils maintenus ? Il devait même prendre la parole lors du congrès annuel des pharmaciens liés à Uniprix, à la fin de mai, congrès maintenant annulé. Tout est en suspens. On attend...
Oui, c'est vrai, la valeur des achats d'entreprises québécoises à l'extérieur est supérieure à celle des prises de contrôle par des étrangers. Mais l'impact est différent. Quand CGI, Couche-Tard ou d'autres achètent dans le monde, les actionnaires en profitent, mais en termes de création d'emplois ici, le résultat est mince. Il en va tout autrement quand un soi-disant fleuron québécois passe entre des mains étrangères. On parle alors, la main sur le coeur, de «potentiel d'expansion» et de «nouvelles occasions», mais trop souvent, dans les faits, les salariés québécois en paient le prix.
Est-ce inéluctable ? Robert Lafont appelle à la lucidité. «Oui, nous pouvons rebondir. Plein de belles PME progressent au Québec. Mais si nous laissons tomber notre culture d'affaires, si nous ne faisons que subir la montée de la mondialisation, nous allons tous y perdre.»
Adrenalys en Ontario
Favoriser l'émergence de nouvelles entreprises championnes, c'est le mandat que s'est donné le programme Adrenalys, lancé en 2015 avec le concours de six partenaires : RCGT, Fasken Martineau, Banque Nationale, le Fonds de solidarité, Proaction et Ascendis, une firme d'experts conseils en gestion dirigée par Dominic Denault, lui-même à l'origine de cette initiative dérivée du défunt projet des Gazelles.
La première cohorte comprenait 24 PME choisies pour leur potentiel de croissance, des entreprises comme Fourgons Transit, Soucy Industrie, la Boulangerie Saint-Méthode... Toutes ont pu profiter de conseils pro bono et de financement.
On est en train d'évaluer l'impact de ces mesures d'accompagnement, mais comme prévu, Adrenalys veut recruter un autre groupe de 25 PME prometteuses. On connaîtra le nom de ces nouvelles entreprises à l'automne, mais en attendant, Adrenalys veut faire des petits en Ontario : la même formule y est maintenant lancée avec l'objectif de recruter 50 PME de haut calibre d'ici la fin de juin.
Pourquoi élargir ainsi les horizons ?
«L'occasion est belle de partager les expériences, les pratiques et la culture d'affaires, dit Dominc Denault. De plus, nous avons fondé le Club des PDG, où les dirigeants se rencontrent quatre fois par année, et le bassin va ainsi substantiellement augmenter.»
Ces champions en devenir parviendront-ils à s'imposer et à se faire valoir loin de leurs marchés actuels ? C'est l'idée, et pourquoi pas ?