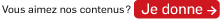Notre journaliste a rencontré le pdg de Bombardier dans le jet qu'il utilise pour ses déplacements. Le but ? Être dans un environnement correspondant bien au sujet de la discussion : la gestion d'une multinationale à partir du Québec. Avec ses 71 700 employés et ses 80 sites de production et d'ingénierie dans 26 pays, Bombardier est l'une des quelques entreprises québécoises à pouvoir utiliser ce qualificatif sans rougir. Voici une rare occasion d'entendre Pierre Beaudoin aborder les enjeux liés à la gestion d'une organisation mondiale.
Les Affaires - Comment voyez-vous votre rôle ? En quoi ça consiste d'être pdg de Bombardier, aujourd'hui ?
Pierre Beaudoin - C'est de donner les grandes orientations à l'entreprise. S'assurer que nous utilisons les bonnes façons de mesurer le progrès que nous faisons en fonction des objectifs que nous nous donnons. Choisir les bons leaders pour l'entreprise et veiller à créer un esprit d'équipe qui nous permette vraiment de progresser.
L.A. - Vous avez deux divisions assez différentes, soit les avions et les trains. Comment conciliez-vous ça ?
P.B. - Ce sont des métiers semblables, en fait. Les produits sont différents, mais ils sont tous très complexes. Quand je compare l'ingénierie, la gestion de projet, le type de leaders dont nous avons besoin, la nécessité d'être global et de comprendre les différents marchés, il y a plus de ressemblances qu'on peut penser entre un train et un avion.
L.A. - À quelle fréquence embarquez-vous dans cet avion ?
P.B. - Je voyage environ 50 % de mon temps. C'est un peu normal : il faut être devant les clients, voir les occasions d'affaires, faire connaître l'entreprise, rencontrer nos employés afin de bien comprendre les enjeux... Être pdg d'une entreprise comme Bombardier, c'est accepter de faire le tour du monde régulièrement.
L.A. - Vous allez à Berlin, où se trouve le siège social de Bombardier Transport (BT). À quelle fréquence ?
P.B. - Souvent. Je vais en Europe au moins une fois par mois, souvent deux. Surtout ces temps-ci, puisque nous venons de changer de président. [André Navarri a pris sa retraite et Lutz Bertling est président et chef de l'exploitation de BT depuis juin 2013.] Évidemment, au début, il y a plus de voyages afin que nous puissions bien nous connaître et nous comprendre.
L.A. - Comment fait-on pour asseoir son autorité lorsqu'un océan nous sépare ?
P.B. - Je ne pense pas que ça fasse une grosse différence. Autant Lutz Bertling que Guy Haché [président et chef de l'exploitation, aéronautique] ont des entreprises globales à gérer. Nous nous arrangeons pour nous voir, bien échanger et nous entendre sur des objectifs et des approches face aux problèmes. Nous finissons par très bien nous connaître.
L.A. - De quelle manière faites-vous en sorte que votre garde rapprochée ait accès à vous, malgré votre horaire chargé ?
P.B. - Premièrement, nous faisons beaucoup de dossiers ensemble. Je demande à ces personnes-là d'être impliquées dans leurs fonctions à travers les divisions, donc elles aussi voyagent beaucoup. Nous en profitons souvent pour avoir des réunions dans l'avion. Nous faisons aussi des comités de gouvernance d'entreprise pour bien comprendre les enjeux et échanger. C'est une discussion constante, tous les jours ou, à tout le moins, une fois par semaine.
L.A. - Votre agenda est-il planifié très longtemps d'avance ou est-il plutôt rempli d'imprévus ?
P.B. - Nous planifions. Nos réunions de gouvernance interne, par exemple, sont prévues un an à l'avance. Mais il faut aussi être flexibles : lorsqu'un client veut nous voir, il faut être capable d'y aller. Par exemple, en début d'année, le premier ministre de la Chine a demandé de rencontrer Bombardier. La demande est arrivée le samedi, pour une rencontre le mardi. Il faut être capable de se retourner de bord, parce que ce n'est pas moi qui décide de l'agenda du premier ministre chinois !
L.A. - À quel moment entrez-vous dans les discussions avec un client important, normalement ?
P.B. - Ça dépend du client. Souvent, j'entre au début du processus pour créer la relation. J'ai le privilège, grâce à mon poste, de pouvoir ouvrir des portes pour nos vendeurs par différentes réunions internationales. Comme à Davos [Forum économique mondial] : tous nos clients sont là. Pour moi, c'est une belle occasion de créer des relations pour que mes équipes puissent rencontrer ces personnes-là après.
L.A. - Jusqu'à quel niveau de détails pouvez-vous aller avant de tomber dans le micromanagement ?
P.B. - J'ai toujours un peu de difficulté avec le terme micromanagement. Parfois, dans n'importe quelle entreprise, il faut vraiment aller dans les détails pour bien comprendre. Il arrive, par exemple, que, pour un problème technique sur un produit, je veuille vraiment comprendre quelle pièce est utilisée, avec quel fournisseur, en quoi consiste l'enjeu...
L.A. - À ce point-là ?
P.B. - Oui, parce que des fois, c'est ce que ça prend pour pouvoir appuyer nos employés et contribuer à régler le problème. Évidemment, il ne faut pas que je fasse ça tous les jours. Parfois, il s'agit plutôt de comprendre l'enjeu pour l'entreprise afin de prendre des décisions en conséquence.
L.A. - Est-ce difficile de mettre une limite, de dire «là, je ne vais pas plus loin, j'en sais assez» ?
P.B. - C'est difficile pour moi, parce que j'ai exploité plusieurs de nos divisions à travers les années et, parfois, j'aime ça aller beaucoup dans le détail pour bien comprendre. Mais je pense aussi que c'est difficile de bien appuyer nos équipes si on ne comprend pas l'enjeu et qu'on ne va pas dans le détail, au moins à l'occasion.
L.A. - Comment s'assure-t-on que l'information monte de la base jusqu'au pdg ?
P.B. - On vérifie. C'est pour ça que j'aime rencontrer nos clients et nos employés. J'essaie de comprendre si l'information qui m'est donnée correspond à l'histoire «sur le plancher». Nous avons aussi des outils de communication à l'interne, dont un webzine vidéo, qui me permettent de parler aux employés. Évidemment, il y a toujours les courriels : j'en reçois plusieurs de l'interne qui m'adressent des questions, et nous avons un système permettant à un employé de communiquer directement avec moi et le siège social de façon confidentielle. Reste qu'on ne peut pas gérer une entreprise comme Bombardier sans être capable d'aller dans les usines et les bureaux dans le monde, là où l'ouvrage se fait.
L.A. - Ça doit faire un brouhaha lorsque le grand patron débarque dans une usine, non ? Ça ne doit pas être tellement naturel...
P.B. - Pas toujours, mais nous avons quand même des standards très élevés quant aux processus de production. Cela dit, avec l'expérience, on remarque tout de suite si c'est un spectacle plutôt que la vie de tous les jours. Je n'apprécie pas tellement le spectacle et nos équipes sont au courant.
L.A. - Y a-t-il encore des différences culturelles auxquelles vous devez vous adapter ?
P.B. - Je dirais que oui. Il faut être flexible dans nos usines, sans jamais faire de compromis sur les valeurs de l'entreprise. C'est un équilibre. Les employés acceptent qu'ils travaillent pour Bombardier et que nous avons nos processus et nos valeurs, mais nous devons aussi des fois, dans certaines communautés, nous ajuster à leur réalité. Je pense que c'est pour ça que nous avons beaucoup de succès avec nos usines un peu partout dans le monde : nous pouvons réunir nos employés du Mexique et de Montréal, par exemple, et ils reconnaissent les valeurs, ils sentent qu'ils travaillent pour la même entreprise. En même temps, ils ont des conversations intéressantes sur les petites différences liées à leur culture.
L.A. - Votre slogan est «l'évolution de la mobilité». Comment cerner les tendances lorsqu'on est une entreprise mondiale ?
P.B. - Nous travaillons constamment à évaluer de quelle façon les personnes se déplaceront dans le futur. C'est fait localement et ça varie d'un marché à l'autre. Nous avons des équipes qui nous donnent leur point de vue et nous faisons des recherches. Pour la Série C, par exemple, nous avons pris plus de cinq ans et dépensé 150 M $ pour étudier le marché et s'assurer que nous prenions une bonne décision. Ça demande une très grande discipline et je pense que nous faisons très bien ça.
L.A. - Vous arrive-t-il de ne pas être d'accord avec l'analyse de vos gens sur le terrain ?
P.B. - Oui, souvent [rires]. Des fois, j'ai raison. Des fois, non. L'important est de comprendre pourquoi ils voient le marché d'une certaine manière. Nous discutons de la façon dont ils ont fait leur analyse, des raisons pour lesquelles ils croient que les clients veulent tel type d'avions ou de trains, des tendances qu'ils ont décelées.
L.A. - Comment vous assurez-vous d'avoir une vision réellement mondiale, qu'elle n'est pas déformée par le fait que vous êtes ici, au Québec ?
P.B. - C'est important de voyager et de rencontrer les clients. Et surtout, de réellement les écouter. Parfois, lorsque nous avons un plan ou une idée, nous n'écoutons pas vraiment ce que la personne a à dire. Il s'agit de développer la discipline d'écouter nos clients, puis de retourner poser les mêmes questions afin de vérifier que notre interprétation de ce qu'ils nous ont dit est la bonne. Ça semble très facile à faire tout ça, mais ce n'est pas si évident. Nous le faisons en ce moment pour les nouveaux Global 7000 et 8000, des appareils de 65 M$ et plus. Nous avons eu plusieurs discussions avec les milliardaires dans le monde !
L.A. - Vous faites des affaires au Maroc, en Russie, en Chine... On a l'impression que ce n'est pas vraiment possible de faire des affaires dans ces pays sans graisser la patte de quelqu'un. Ça se vit comment, chez Bombardier ?
P.B. - Je pense que c'est plutôt un mythe. Nous avons des règles d'intégrité chez Bombardier et nous les respectons. Ce n'est jamais nécessaire d'outrepasser notre code d'éthique pour faire des affaires, peu importe le pays. C'est sûr qu'il faut surveiller qu'aucun de nos employés ne prenne de liberté, mais en insistant constamment sur notre code d'éthique, nos employés vont le respecter. Surtout s'ils voient que nos gestionnaires se comportent de façon éthique. Je pense que c'est ça le plus important : l'exemple.
L.A. - Ça vous arrive de refuser des contrats ?
P.B. - Oui, ça nous arrive de ne pas être intéressés. Quand les conditions proposées nous demanderaient de faire certaines affaires qui sont inacceptables pour notre entreprise.
L.A. - Ça doit être déchirant de laisser filer un contrat financièrement intéressant, non ?
P.B. - Non, pas vraiment. Ça ne vaut jamais la peine. Nous avons une réputation impeccable à travers le monde. Faire affaire avec des personnes qui ont une éthique questionnable, qui ne sont pas intègres, ce n'est pas intéressant pour moi. Donc, non, je ne trouve jamais ça difficile de laisser passer une occasion - je n'appellerais même pas ça une occasion - de participer à quelque chose qui est inacceptable.
Visionnez une partie de la rencontre avec Pierre Beaudoin sur lesaffaires.com/videos
marie-claude.morin@tc.tc