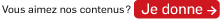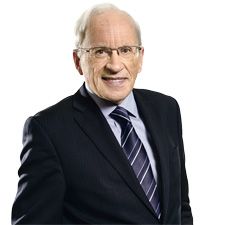Selon le Conseil des aéroports du Canada, 4,8 millions de Canadiens ont préféré prendre leur vol à un aéroport situé aux États-Unis plutôt qu'au Canada en 2011. C'est une hausse de 15 % par rapport à l'année précédente.
Cette statistique horrible s'explique à la fois par le fait que 75 % de la population canadienne vit à 90 minutes de la frontière canado-américaine et que les tarifs aériens sont beaucoup plus bas au sud de celle-ci. Les résidents du sud du Québec connaissent bien Plattsburgh, qui s'affiche comme «l'aéroport américain de Montréal», et les Manitobains sont des habitués de l'aéroport de Grand Forks au Dakota du Nord, qui se dit fier d'être «l'aéroport international américain le plus près de Winnipeg». Pour sa part, la station de ski de Whistler offre aux skieurs américains qui atterrissent à Seattle plutôt qu'à Vancouver des rabais entre 74 $ (départ de Los Angeles) à 264 $ (départ de Chicago).
Alors que nos aéroports devraient être des moteurs de l'économie, nos gouvernements les voient plutôt comme des postes de péage. Ottawa impose aux 26 principaux aéroports du pays un loyer fondé sur leurs revenus et non sur leur valeur foncière, comme c'est le cas pour les autres personnes morales et les propriétaires immobiliers. Selon Fred Lazar, de l'Université York, les huit principaux aéroports du pays ont payé 268 millions de dollars en loyer en 2009, soit 11 % de leurs revenus (12 % pour Montréal, Toronto et Vancouver). Ottawa est en effet toujours propriétaire des principaux aéroports du pays, même s'il en a confié la gestion à des sociétés à but non lucratif.
Aux États-Unis, les aéroports sont généralement la propriété des municipalités, qui ne leur imposent ni loyer, ni taxe foncière. Ils reçoivent des fonds du programme d'améliorations aéroportuaires. Au Canada, les villes imposent les aéroports sur leur valeur foncière comme tout autre entreprise, bien qu'ils soient des organismes à but non lucratif.
Frais afférents exorbitants
Si on ajoute au tarif de base les frais exigés pour le contrôle aérien, la sécurité, les améliorations aéroportuaires, les taxes d'accise sur le carburant (Ottawa a déjà promis d'abolir la sienne), les taxes de vente fédérale et provinciale et les droits d'atterrissage (l'aéroport Pearson aurait les droits les plus élevés du monde), on comprend pourquoi un vol effectué entre deux villes canadiennes peut coûter le double d'un vol comparable aux États-Unis.
L'ensemble des droits, frais et taxes qui s'ajoutent au tarif aérien augmente de 60 à 75 % le coût des voyages au Canada, alors que ces suppléments n'ajoutent que de 10 à 18 % aux billets vendus États-Unis. Selon le Forum économique mondial, les frais afférents ajoutés aux tarifs de base aériens font que le Canada se classe au 125e rang parmi 139 pays.
Ces données devraient inciter Ottawa à revoir sa philosophie de gestion des aéroports, d'autant plus que, dans un rapport récent, le Comité sénatorial permanent des transports et des communications propose d'abolir graduellement le loyer imposé aux 26 principaux aéroports du pays. Le Comité recommande aussi à Ottawa d'envisager d'en céder la propriété aux organismes qui les gèrent.
Ces suggestions, qu'Ottawa se doit d'étudier, visent à donner aux autorités locales les plus dynamiques l'autonomie nécessaire pour leur permettre de faire de l'aéroport un véritable moteur de leur économie.
Mais ce dont le Canada a surtout besoin dans ce domaine, c'est une stratégie de développement de ses industries du transport aérien et du voyage. Alors que les transporteurs aériens et l'industrie touristique demandent depuis longtemps à Ottawa de mettre en place une véritable politique de développement de ses industries, il est inconcevable que cet appel ne soit toujours pas entendu.
Le Canada pourrait s'inspirer de la Turquie, où le nombre de touristes étrangers est passé de 10,4 M, en 2001, à 31,5 M l'an dernier, représentant alors des revenus d'environ 25 milliards de dollars américains. Ce pays possède un plan de développement très détaillé de son industrie touristique, qui vise à accueillir 63 M de visiteurs étrangers et obtenir 86 G$ US de recettes en 2023.
L'économie canadienne profiterait grandement d'un réseau d'aéroports plus concurrentiels. Les Canadiens les utiliseraient davantage, plus de voyageurs étrangers seraient incités à transiter par le Canada et cela aiderait l'industrie du fret. Le Canada a aussi besoin d'une vraie politique touristique. Il est inconcevable que ces deux industries soient aussi négligées.
MON COMMENTAIRE
J'aime
Les investissements de la Caisse de dépôt dans CGI (1 G$), la Banque Laurentienne (100 M$) et Genivar (98,5 M$) permettront à ces trois sociétés de faire des acquisitions très stratégiques pour leur développement. CGI achètera Logica, société britannique de services informatiques, la Banque Laurentienne acquerra Fiducie AGF, et Genivar se portera acquéreur du groupe d'ingénierie et de construction WSP d'Angleterre.
Je n'aime pas
La coupe déborde pour la ministre Michelle Courchesne. Après la publication de deux rapports du vérificateur général la blâmant sévèrement en raison de favoritisme dans l'attribution de places en garderie et de subventions pour des infrastructures sportives, voilà que l'on constate qu'elle a accordé des subventions à des écoles juives dont les programmes n'étaient pas conformes aux politiques du ministère de l'Éducation. La ministre se mêle aussi du conflit de travail à la Commis-sion de la construction du Québec, où elle cherche à imposer un règlement favorable aux syndicats. Pourquoi une telle intervention, alors que les salariés de la CCQ sont mieux traités que ceux de la fonction publique ?
jean-paul.gagne@tc.tc