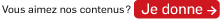Depuis qu’il a fait l’acquisition de Mailhot Industries — alors en très mauvaise posture financière —, l’entreprise connaît une croissance fulgurante tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Humaniste dans l’âme, Yvan Morin révèle avec une étonnante franchise sa vision très personnelle du leadership, tout en égratignant au passage quelques mythes sur l’art de diriger.
par Yvan Morin Président-directeur général, Mailhot Industries
À 20 ans, j’étais un jeune rempli de rêves et d’espoir. J’ai compris très tôt qu’on vient une seule fois sur Terre. Il y a des gens qui passent comme si rien ne s’était produit. Et il y a ceux qui laissent un monde meilleur derrière eux quand ils partent. Moi, je me suis toujours dit que j’aimerais faire ma marque : pas grand-chose peut-être, mais laisser une marque, même petite.
Un jour, j’ai lu une phrase qui disait que l’héroïsme, ce n’est pas d’accomplir des exploits extraordinaires, mais de faire des petites choses d’une manière extraordinaire. Ça a guidé ma vie. Dès ma plus tendre enfance, j’ai décidé de mon avenir. Comme j’ai été au pensionnat, j’ai dû apprendre très jeune à compter sur moi, à 13 ans, je voulais être autonome, et je savais déjà que je voulais faire des études classiques. Alors, j’ai obtenu mon bac ès arts, puis une maîtrise en administration de l’Université de Sherbrooke. J’ai ensuite travaillé chez IBM pendant quelques années, avant de devenir responsable des hebdos régionaux chez Quebecor. Ensuite, le destin a voulu que je me spécialise dans le redressement d’entreprises; c’est cet « accident de parcours » qui m’a amené chez Mailhot Industries.###
Changement de parcours
C’était en 1982. Quand je suis arrivé chez Mailhot, c’était pour aider à remettre l’entreprise sur ses rails, pas pour l’acheter ! Je ne voulais pas être propriétaire d’entreprise, je n’avais vraiment pas ce genre d’ambition ! Quelques jours après mon arrivée, j’ai assisté à un pique-nique, organisé par les employés, où il y avait 33 familles. Moi, je savais déjà que l’entreprise était alors vouée à la fermeture, mais pas ces gens-là. J’ai alors compris l’impact terrible de la fermeture d’une entreprise sur les employés, leurs conjoints et leurs enfants. Comme cette usine était le moteur économique de la région, les travailleurs mis à pied auraient d’énormes difficultés à se trouver un autre emploi. C’est peut-être mon petit côté curé, mais, à ce moment-là, j’ai compris que j’avais une responsabilité sociale : je devais faire l’impossible pour relancer l’entreprise, même si la probabilité de réussite était très faible. J’ai dit aux employés : « Je vais tout faire pour remettre l’entreprise sur pied. Si tout le monde y met du sien, je vous promets d’être transparent. Et, même si je n’ai rien à vous offrir pour l’instant, je vous assure que, dès que la situation s’améliorera, nous en profiterons tous. »
J’ai fait l’acquisition de l’entreprise quelques mois plus tard, pendant une période très difficile. Après la signature du contrat de vente, les banquiers m’ont même avoué qu’ils « n’auraient jamais touché à ça ». Alors, qu’est-ce qui m’a fait dire, envers et contre tous, « ça va marcher ! » ? L’intuition ! Une intuition, on ressent ça dans nos tripes : « C’est la bonne chose à faire, je le sais ! » La situation était désespérante, mais pas désespérée. C’est pour ça que j’ai acheté l’entreprise; j’y ai vu quelque chose que personne d’autre n’avait vu…
Savoir prendre les virages
Presque 30 ans plus tard, beaucoup de mes employés se sont mariés, ont eu des enfants, ont grimpé dans l’entreprise ou sont retournés aux études. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais, pour moi, c’est toute cette évolution sociale qui donne de la valeur et de l’envergure à Mailhot Industries, même si ça n’apparaît pas dans les bilans financiers.
Quand on achète une entreprise qui est en mauvaise posture financière, il faut se retrousser les manches, prendre des risques, oser et, surtout, être ouverts. Le plus bel exemple ? Ça remonte à cinq ans après mon arrivée ici, quand un ingénieur a contribué à doter l’entreprise d’une technologie de traitement des métaux quasi unique au monde. Ça faisait un an qu’il avait été embauché, un produit posait problème, et il nous a proposé d’investir dans une technologie allemande; il fallait donc faire des recherches plus poussées en Allemagne. L’enjeu était énorme, et les coûts étaient élevés. Après analyse, on a décidé d’intégrer cette façon de faire à la nôtre. C’était une décision difficile, parce que je savais que je jouais le sort de l’entreprise. Mais, comme mon intuition me disait d’y aller, j’ai pris le risque. Après avoir signé le contrat avec notre partenaire allemand, j’ai réuni tous les employés pour leur annoncer que je venais de jeter les bases de l’avenir de l’entreprise. « Vous verrez, dans 20 ans, on va révolutionner l’industrie hydraulique ! » On l’a fait… et en moins de 20 ans !
L’autre grand tournant, ça a été notre ouverture aux marchés internationaux. Je me rappelle ma première tournée chez un de nos clients en Australie, qui m’avait reçu en déroulant le tapis rouge. Il était tellement fier de me dire qu’il appréciait nos produits… des produits fabriqués dans un rang de Saint-Jacques de Montcalm ! Ça a été un vrai déclencheur. Je me suis dit : « Le monde nous appartient. » Vous savez, les limites qu’on a, c’est celles qu’on se donne ! Aujourd’hui, on exporte nos produits dans 14 pays, dont l’Allemagne, la Grande-Bretagne, le Mexique, le Brésil et l’Australie. Au gré de mes rencontres à l’étranger, j’ai compris que le Québec possède une grande richesse sur le plan des affaires : le fait d’avoir à la fois un tempérament latin et un savoir-faire américain. Aujourd’hui, je n’ai aucun — mais aucun ! — complexe quand je rencontre des industriels allemands et que je leur propose notre technologie. Il est temps d’être conscients de notre valeur !
Se sortir de la récession
On vient de traverser une période de récession qui nous a tous énormément touchés. Du jour au lendemain, 40 % de notre marché s’est écroulé. Et, franchement, j’ai vécu cette épreuve avec beaucoup de réalisme. Vous savez, dans les moments d’incertitude, il faut apprivoiser notre insécurité, apprendre à naviguer malgré l’ambiguïté ambiante et, surtout, ne pas fuir. L’expérience m’a appris que, dans ces cas-là, réunir le plus d’éléments d’information possible suffit souvent à nous faire faire le tour du problème… et à dédramatiser la situation à 90 %. C’est ce qu’on a fait, et vite !
On a tout d’abord limité les difficultés à l’interne. En gros, tout part de là : quand on vit une période aussi difficile, il faut faire travailler ce que j’appelle le « cerveau collectif de l’entreprise » : tout le monde doit contribuer, parce que la force d’une entreprise, c’est celle des énergies de chaque personne qu’on réussit à mobiliser. On se réunit, on élabore un plan stratégique, on répartit les responsabilités, on suit les indicateurs en cours de route et on ajuste notre tir. C’est un peu comme une volée de canards sauvages qui s’en vont tous dans la même direction ! Ensuite, quand toute l’équipe a été mobilisée autour de nos objectifs, on a déclenché une offensive pour réinventer l’entreprise en quelques mois : on a ouvert de nouveaux marchés et on a développé de nouveaux produits. Ces stratégies nous ont permis de colmater les brèches et d’éponger les pertes, surtout que le début de la récession avait coïncidé avec un très gros investissement qu’on venait de faire au Mexique. Heureusement, les profits qu’on avait engrangés et notre excellent bilan financier nous ont aidés à passer au travers de la crise. Mais rien n’est jamais gagné. Il faut garder le cap et ne jamais lâcher.
Ego, pouvoir et coups durs
À mon avis, on ne bâtit pas une entreprise, on bâtit des gens qui bâtissent une entreprise. Ce sont les gens qu’on forme, qu’on aide à s’épanouir et à se dépasser. Diriger des gens m’a demandé une grande rigueur. J’ai toujours eu une certaine discipline personnelle, mais il m’en a fallu davantage. Chacun a sa vision de la discipline. Pour moi, c’est une question d’ego. J’ai réalisé que l’ego était probablement le pire obstacle que je pouvais avoir dans mon métier. J’ai appris à m’affranchir de son emprise. Je me suis « vidé un peu de moi-même » pour « faire place aux autres en moi », sans quoi l’ego me menait à l’échec, certain ! J’entends par ego le souci de l’image de soi qu’on projette aux autres. J’ai trop vu d’entrepreneurs, une fois qu’ils atteignaient un certain niveau de sécurité, devenir assoiffés de pouvoir. Le pouvoir, si on n’y prête pas attention, peut nous détruire.
Même chose pour les épreuves, elles peuvent nous anéantir ou nous pousser à tourner la situation à notre avantage. La motivation entre alors en jeu et les obstacles soulèvent la passion ; après tout, on n’est jamais à l’abri des coups du destin. Quand, après avoir surmonté de grandes épreuves familiales, j’ai compris que ce qui me restait, c’était la santé, et qu’un bon matin j’ai fait un infarctus, j’ai dû me reprendre en mains et continuer. Et lorsque, quatre ans plus tard, j’ai souffert d’un anévrisme à l’aorte et qu’il m’a fallu subir une seconde chirurgie cardiaque, et que j’ai compris que je ne pouvais pas laisser l’entreprise en plan, je me suis relevé et j’ai continué.
L’âme d’une entreprise
Comme leader, j’ai un rôle social. Prenons la rentabilité de l’entreprise, par exemple: c’est un sujet que je ne suis jamais gêné de débattre avec mes employés. En 1993, on avait ouvert une usine au Mexique, et, quand le marché est devenu difficile, des employés m’ont demandé ce qu’on faisait là : « On n’a pas besoin de faire des affaires au Mexique, pourquoi on ne ferme pas cette usine ? » Il fallait qu’on en parle, alors j’ai rassemblé tout le monde. Je leur ai dit que, si c’était vraiment ce qu’ils voulaient, j’étais prêt à fermer l’usine, mais qu’il fallait d’abord bien mesurer les conséquences de ce geste. J’ai expliqué d’une manière très simple que le Mexique produisait des pièces qu’on ne produit pas ici, et les employés ont réalisé que, si on fermait l’usine au Mexique, on devrait aussi couper des postes ici, au Québec. Les gens se sont rendu compte qu’ils faisaient partie de l’équation : dans une entreprise, tout le monde est interrelié, notre succès dépend aussi du succès de nos partenaires, et, en créant de la richesse là-bas, on en crée aussi ici. Ce jour-là, j’ai donné une leçon importante sur la profitabilité et la solidarité au sein d’une entreprise.
Soutenir, donner, redonner vie
Avec le temps, j’ai compris aussi que, quand on est à la tête d’une entreprise, on n’est pas seulement là pour s’enrichir. En fait, on est responsables des autres — de la vie des autres. C’est facile de dire qu’on est responsables de la vie des autres; le défi, c’est de traduire les paroles en actions. Un jour, je faisais le tour de l’usine, et j’ai remarqué qu’un employé n’avait vraiment pas l’air en forme. Je me suis approché, et il m’a confié que sa femme venait de tomber enceinte et qu’ils n’avaient pas les moyens d’avoir un troisième enfant. Il m’a dit : « Elle veut se faire avorter, mais moi, j’en veux, de cet enfant-là. Je ne sais pas quoi faire. » Ça m’a touché, et je suis revenu quelques heures plus tard pour lui proposer de passer me voir avec sa femme. Quand je les ai rencontrés, j’ai proposé à la femme de mener la grossesse à terme, et je leur ai dit qu’ils auraient mon soutien financier — à une condition : dès que le bébé viendrait au monde, je voulais qu’ils me l’amènent, pour que je puisse le prendre dans mes bras ! Depuis, à chaque party de Noël du bureau, je vois la petite, qui est aujourd’hui une ado. Qu’est-ce qui m’a poussé à faire ce geste-là ? C’est une question de valeurs. J’ai toujours su que le fait d’avoir reçu plus que les autres ne fait pas de nous de meilleures personnes — ça nous donne plutôt plus de responsabilités. Ce jour-là, j’ai assumé mes responsabilités…
Quand ça a fait 10 ans que j’avais acheté l’entreprise, mes employés, qui connaissaient mon engagement social et humanitaire, m’ont remis une charte pour la création d’une fondation. C’est comme ça que, après avoir doublé, grâce à un tournoi de golf, les fonds recueillis, j’ai créé la Fondation Yvan Morin, qui a pour mission de soutenir les plus démunis parmi les démunis, les laissés-pour-compte de la société. Depuis 18 ans, la Fondation a pris de l’ampleur, et on a remis près de un million de dollars à des œuvres de charité, au Québec et aussi en Haïti, où on soutient une école et un dispensaire. Et j’en suis très fier.
La retraite en vue
J’ai 73 ans bien sonnés, et le temps est venu de penser à tirer ma révérence. Rien n’est encore arrêté, mais la réflexion est déjà bien entamée. Je veux rester actif, mais travailler moins, m’impliquer de moins près dans l’entreprise, passer à autre chose. J’aimerais être plus libre de mon temps et cesser d’être dépendant des événements. Aujourd’hui, j’ai moins besoin de faire, et plus besoin d’être. Je crois très humblement que c’est après mon départ que les gens vont récolter les fruits de mes efforts. Les graines qu’on sème mettent parfois beaucoup de temps à germer, et elles ne poussent pas toutes ! Mais ce qui compte, c’est ce qui reste. C’est ce qui nous fait dire que tout ça, finalement, en a vraiment valu la peine.
5 leçons de leadership
1. « Garde ça simple ! »
Au tout début de ma carrière, je me suis lié d’amitié avec un grand chef d’entreprise qui était resté très humble malgré sa réussite en affaires. Un midi, on mangeait ensemble, et il m’a dit : « Parle-moi donc de tes diplômes... » Tout fier, je lui ai parlé de ma formation universitaire. Très calmement, il m’a répondu : « C’est bien beau, ton affaire ! Moi, vois-tu, j’ai une 12e année de l’orphelinat Saint-Arsène. Si tu veux réussir, il y a quelque chose que tu dois apprendre le plus vite possible : c’est le “bon gros jugement d’habitant”. » Sur le coup, je l’ai détesté : il venait de me faire descendre de mon piédestal. Mais ce qu’il me disait, au fond, c’est de garder les deux pieds sur terre. De garder ça simple. Je n’ai jamais oublié ce conseil.
2. « Gagnerais-tu ton élection ? »
Quand un de mes gestionnaires me demande s’il est efficace, je lui propose d’imaginer la chose suivante : « Si, demain matin, les employés de ton service avaient à voter pour le meilleur leader, celui qui les aiderait à s’améliorer et à aller plus loin, penses-tu que tu serais élu ? » S’il me répond oui, je lui dis qu’il fait bien sa job. Mais, si la réponse est non, ça veut dire qu’il passe à côté de l’essentiel. Je lui conseille alors de se dépêcher d’écouter ses employés et de les encourager à se dépasser. Récemment, chacun leur tour et sans s’être consultés auparavant, deux vice-présidents sont venus dans mon bureau et m’ont dit : « Moi, je suis une bien meilleure personne depuis que je travaille ici. » Ça, c’est ma plus grande satisfaction !
3. « La tête ou les tripes ? »
Vous savez ce que je dirais à un finissant en gestion ? « Si tu crois en ce que tu es et à l’aventure que tu entreprends, lance-toi ! Mais si tu n’y crois pas dans tes tripes, que tu veux le faire seulement pour l’argent et que tu n’es pas prêt à investir ce que tu as de meilleur en toi, alors n’y va pas. » Tout est une question de motivation. Et la vraie motivation vient des tripes, pas de ce que j’appelle « le quatre pouces d’en haut ». La motivation, ça ne s’invente pas; et, quand on est motivés, on est passionnés.
4. « Posons-nous les bonnes questions ! »
Un jour, on a reçu un coup de fil à l’usine : sur un chantier, un cylindre hydraulique s’était brisé et un ouvrier était mort. Surtout, pas de panique ! Le bon réflexe, c’est de rassembler toutes les personnes impliquées et de dire « OK, on va faire le tour de la situation ». On va poser les bonnes questions, celles qui déconstruisent le problème. « Que s’est-il passé ? Quelle est l’ampleur réelle de la catastrophe ? Peut-on aller évaluer ça sur le terrain ? » Une fois qu’on a fait ça, c’est automatique, la tension tombe ; les gens trouvent leurs repères et se mobilisent dans l’action. C’est ce qu’on a fait quand ce terrible accident s’est produit… Et on a découvert que le cylindre qui avait lâché ne sortait pas de nos usines, mais de celle d’un de nos concurrents, qui avait tenté de copier nos produits.
5. « Un leader, ce n’est pas un gestionnaire ! »
Je suis frappé par le nombre de dirigeants qui n’ont pas de vision d’avenir pour leur entreprise. Or, c’est ça qui départage un leader et un gestionnaire. Un gestionnaire, c’est celui qui prend plusieurs éléments, qui les met ensemble et qui fait en sorte que ça marche. Un leader, lui, donne une âme à son projet, il est capable de l’imaginer, de le projeter dans l’avenir. Évidemment, les leaders ne sont pas des gestionnaires, et les gestionnaires ne sont pas des leaders. C’est pourquoi un bon leader sait s’entourer de bons gestionnaires, et qu’il les laisse travailler, sans se mêler de la gestion ni des opérations au quotidien. Sinon, il nuit au bon fonctionnement de son entreprise ! Quand on réussit à jumeler un bon entrepreneur et un bon gestionnaire, on a une recette gagnante.
Propos recueillis par Manon Chevalier