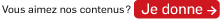À lire aussi : Les nouveaux ténors du jeu québécois
Un success-story à la sauce québécoise... Ça se passe en juillet 1997 : séduite par la promesse d'une subvention qui absorbera la moitié de ses salaires en sol québécois, Ubisoft débarque dans le Mile-End. À l'époque, ce quartier au pied du Mont-Royal s'essouffle. Les anciennes usines sont désertées, les ruelles sont sales et les commerces lugubres.
Vingt ans plus tard, le contraste est frappant. Piétons, cyclistes et automobilistes se partagent des artères toujours aussi mal pavées, mais incontestablement plus dynamiques, entre des cafés, des microbrasseries et des bureaux d'où émergent tant des jeunes sociétés technologiques que des studios de jeu indépendants. Les quelque 6 000 professionnels montréalais du jeu vidéo, et leur salaire annuel moyen de 72 000 $ (le double du salaire moyen québécois, toutes industries confondues), y sont pour beaucoup...
Source : Alliance Numérique
Si le Mile-End revit, c'est au tour d'Ubisoft de passer un mauvais quart d'heure. La crise de 2008 a fait mal à la société française, qui émerge à peine d'un creux boursier de huit ans. Une reprise stimulée par la tentative répétée de prise de contrôle par une rivale, Vivendi, qui aimerait fusionner Ubisoft avec Gameloft, l'autre studio français qu'elle vient tout juste d'acquérir.
Plus tôt ce printemps, cette guerre d'actionnaires a mené Yves Guillemot, qui a cofondé Ubisoft en 1986 avec ses frères, à solliciter d'éventuels investisseurs canadiens. Les frères Guillemot détiennent quelque 9 % d'Ubisoft, par rapport à 17,73 % pour Vivendi, et mènent la résistance, pour ainsi dire, afin d'éviter cette prise de contrôle.
Leur crainte : que Vivendi rationalise et fusionne Ubisoft à Gameloft, entraînant une fuite de ses employés les plus talentueux ; qu'elle force la nouvelle entité à recourir à ses autres filiales européennes (notamment Studiocanal) pour son financement, sa distribution et ses ventes ; qu'elle délaisse ses partenaires nord-américains au profit des partenaires français du groupe.
Bref, Ubisoft craint d'avoir à recentrer ses activités en Europe, alors que l'Amérique du Nord est son plus important marché... et un important lieu de production pour ses produits les plus lucratifs.
À Montréal, c'est toute l'industrie qui s'intéresse à cette saga boursière. «Nous suivons ce dossier de près», confirme Lucie Rodrigue, directrice des mesures fiscales, chez Investissement Québec. Quand il est question d'attirer des studios étrangers chez nous, c'est Investissement Québec qui s'en charge, mais son mandat est un peu plus vaste que ça...
«On protège nos sièges sociaux. On fait la même chose avec des investissements comme Ubisoft, qui a une masse salariale importante au Québec. On ne détient aucune participation dans la société, mais on parle régulièrement à ses administrateurs.»
Autrement dit, advenant une éventuelle restructuration d'Ubisoft qui menacerait sa présence dans la Belle Province, Investissement Québec serait aux avant-postes pour tenter de sauver les meubles, mais n'aurait aucune mesure précise, aucun levier concret pour protéger les studios d'Ubisoft de Montréal et de Québec.
Quel rendement pour le Québec ?
Vingt ans plus tard, la mesure qui a donné le jour à l'industrie québécoise du jeu vidéo demeure : le crédit d'impôt pour la production de titres multimédias couvre 37,5 % du salaire des employés des quelque 140 studios de jeu vidéo qu'on dénombre actuellement en sol québécois.
Ce crédit ne s'applique qu'ici, mais pour des multinationales comme Ubisoft, son apport est global. Au cours des 10 dernières années, l'entreprise a généré un bénéfice net de 304,4 millions d'euros (439 M$), mais a reçu 343,7 M$ grâce au crédit d'impôt québécois. Le bilan positif du géant français est donc indirectement financé par l'aide québécoise. Détail important : la loi qui encadre ce crédit ne tient pas compte de la rentabilité des sociétés dans ses critères d'admissibilité.
Une industrie mature ne devrait-elle pas pouvoir se passer de l'aide publique pour être profitable, ou à tout le moins rentable ? «Oui et non, nuance Alain Tascan, un des premiers dirigeants d'Ubisoft au Canada, aujourd'hui observateur indépendant de l'industrie. Comme toute industrie soutenue publiquement, il y en a qui abusent du système. Les crédits [du multimédia] coûtent cher et rapportent peu d'argent, mais ils font rayonner le Québec. Et ça amène autre chose : l'industrie des effets spéciaux, plus de production pour la télé et le cinéma...»
L'an dernier, Québec a annoncé des réductions budgétaires dans l'aide accordée aux entreprises, réduisant le crédit d'impôt pour les produits multimédias à 30 %. Ubisoft et Warner étaient exclus de cette mesure, car les deux sociétés ont une entente particulière qui les protège jusqu'en 2019.
Le crédit d'impôt pour les produits multimédias avait coûté 135 M$ au gouvernement du Québec en 2014. L'industrie s'est mobilisée. Parmi les rapports présentés, une étude réalisée par KPMG-Secor, intitulée «L'industrie du jeu vidéo : un moteur économique pour le Québec», a révélé que le crédit initial à 37,5 % avait permis au gouvernement de toucher 145 M$ en taxes, impôts et autres cotisations, et que c'était donc une mesure «rentable».
Convaincu, Québec a rétabli le crédit à son niveau initial. Selon l'étude de KPMG, le secteur du jeu vidéo a généré un rendement annualisé de 7,4 % sur 20 ans. En comparaison, c'est inférieur au rendement annualisé de l'indice boursier américain S&P 500 pendant la même période, soit 10,6 %. Bref, c'est moins impressionnant sur papier que ce à quoi on pense quand on parle de créer une industrie dynamique à forte croissance, axée sur l'avenir.
«Dans l'ensemble, on n'a pas encore obtenu le rendement espéré de cet investissement, concède Alain Tascan. Mais je suis convaincu qu'on finira par le voir. La Silicon Valley ne s'est pas faite en 20 ans. Depuis quelques années, on voit les entreprises québécoises émerger et commencer à dominer l'industrie. Des jeunes Québécois réussissent sur la scène internationale, et ça en inspire d'autres. C'est un impact positif, ça aussi.»
À lire aussi : Les nouveaux ténors du jeu québécois
Un univers en croissance
«Le crédit d'impôt sur les titres multimédias et la rentabilité sont deux choses distinctes», indique Catherine Émond, directrice des services aux membres de l'Alliance numérique. L'organisme, qui parle au nom de l'industrie, est catégorique : l'aide gouvernementale permet aux entreprises de prendre des risques là où, autrement, elles seraient moins audacieuses, et donc, moins bien positionnées sur l'échiquier international.
«Ça leur permet d'innover, de développer de nouveaux produits. C'est la même chose pour Ubisoft : ses studios au Québec sont des centres de R-D, par opposition à des centres générateurs de grand profit.» Et leur présence a permis d'attirer dans la province plus de la moitié de l'industrie vidéoludique canadienne ainsi que des multinationales étrangères parmi les plus importantes du monde, dont Square Enix et Warner. Cette «masse critique» d'entreprises spécialisées, c'est l'autre atout que l'industrie québécoise a développé en deux décennies. Celui qui fait qu'on suit de près le cas Vivendi-Ubisoft, mais qu'on ne s'en inquiète pas trop. Si Ubisoft en venait à recentrer ses activités hors Québec, l'industrie d'ici survivrait.
«C'est un univers qui change rapidement, mais qui est toujours en croissance. C'est important d'offrir de l'assistance pour que les entreprises s'adaptent à cette transformation incessante : le mobile, la réalité virtuelle, et ce qui viendra ensuite.»
Ce serait un excellent résumé, si on avait à définir les bases de ce qui assurera les 20 années à venir du jeu vidéo québécois. Alain Tascan utilise d'autres termes, mais dit essentiellement la même chose : «Il faut plus que des banquiers. Les entreprises sont plus matures, il faut acquérir une expertise financière spécifique au jeu vidéo.»
C'est ce que tente justement de faire Investissement Québec. On a ouvert le Québec au reste du monde, il est temps de faire l'inverse, semble-t-on dire. «On donne déjà un bon coup de pouce aux studios québécois, mais on veut aller plus loin. On vient de mettre en place des mesures pour développer davantage la propriété intellectuelle des entreprises d'ici», explique Benoît Leroux, directeur de l'investissement chez Investissement Québec.
Car la clé, dans le divertissement numérique, un marché où le principal produit est abstrait et logiciel, c'est ça : la propriété intellectuelle. La «marque» à partir de laquelle des produits dérivent : un jeu «AAA» pour console, une application mobile, et pourquoi pas, éventuellement, un film, des t-shirts, etc. Ce que d'aucuns appellent la méthode Angry Birds.
Sauf que créer et développer la propriété intellectuelle exige du temps et de l'argent. Dans l'industrie, l'adage veut que la plupart des studios ne deviennent rentables qu'après leur sixième production.
À ce jour, l'écrasante majorité des grandes marques développées au Québec appartiennent à des sociétés étrangères : Assassin's Creed, Deux Ex, Far Cry, Prince of Persia. Et les studios «indépendants» qui s'en tirent le mieux sont ceux qui conçoivent en sous-main un jeu ou une licence appartenant à un tiers.
Le Québec est donc un pôle important du jeu vidéo mondial, mais son influence reste limitée. C'est en somme ce qu'espère changer la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec, un regroupement de 90 entreprises québécoises spécialisées dans ce domaine qui s'est formé au cours de la dernière année.
«On souhaite et on vise la création de plus grandes entreprises de propriété québécoise dans notre secteur», résume Louis-Félix Cauchon, président de la Guilde, qui voit évidemment une meilleure stabilité à long terme pour l'industrie locale si ses membres les plus importants en sont issus. La preuve ? «Les grandes entreprises sont la raison pour laquelle l'industrie existe et pour laquelle les crédits provinciaux ont été créés», ajoute-t-il.
Ça tombe sous le sens. Et pour y arriver, les mesures sont évidentes aux yeux de M. Cauchon : aider à gérer le risque lié à la création de nouveaux produits, faciliter la commercialisation à l'international, et fournir aux plus petits studios des outils de marketing dignes d'une multinationale. «Au Québec, nous sommes tous des exportateurs. Aucun d'entre nous n'est le concurrent direct de l'autre. Les crédits provinciaux sont déjà très généreux, mais les petits studios ont tout de même des ressources limitées pour rivaliser sur la scène mondiale.»
Autrement dit, il faut permettre au prochain Ubisoft d'émerger. Car comme l'a prouvé l'industrie du jeu vidéo ces 20 dernières années, on ne sait jamais ce que réserve l'avenir. Et le meilleur moyen d'en profiter, c'est probablement de prendre soi-même la tête...
Ubisoft Canada a refusé nos nombreuses demandes d'entrevue dans le cadre de ce reportage.
À lire aussi : Les nouveaux ténors du jeu québécois