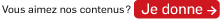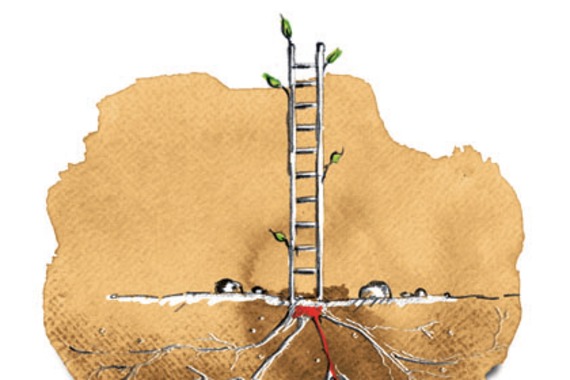
On dit souvent que certains ont moins de chance que d’autres dans la vie. À tort. Car ceux qui démarrent avec un désavantage s’habituent à se battre plus tôt que les autres et sont ainsi plus à même d’atteindre des sommets.
Sidney Weinberg, né en 1891, était l’un des 11 enfants de Pincus Weinberg, un Polonais d’origine, trafiquant d’alcool et grossiste en spiritueux, qui peinait à joindre les deux bouts dans le quartier de Brooklyn, à New York. De petite taille, il a été décrit par E. J. Kahn, journaliste au New Yorker, comme « une poupée Bout d’chou toujours sur le point d’être avalée tout rond par les grands fauteuils direc¬toriaux ». Sidney Weinberg (qui prononçait son nom « wine-boig ») a abandonné l’école à 15 ans. Il arborait derrière la tête des marques de bagarres à l’arme blanche qui remontaient à la préadolescence, une période pendant laquelle il ven¬dait inlassablement les journaux du soir à la criée au terminus du traversier Manhattan-Brooklyn, dans l’avenue Hamilton.
###
À 16 ans, Sidney Weinberg arpentait un jour Wall Street à l’affût d’un « beau gratte-ciel, imposant et élancé », devait-il évoquer plus tard. Il a arrêté son choix sur l’immeuble situé au 43 Exchange Place. Il est monté jusqu’au dernier étage et a entrepris de redescendre en s’arrêtant à chacun des bureaux, étage par étage, pour demander si l’on avait besoin d’un garçon de courses. À la fin de la journée, arrivé au troi¬sième étage, il est entré dans les bureaux d’une petite firme de courtage, où, là encore, on lui a dit qu’il n’y avait pas de travail pour lui. Cela ne l’a pas empêché d’y retourner le lendemain, en affirmant qu’on lui avait dit de se présenter. Son bluff a été payant: on lui a offert un poste d’aide-concierge à trois dollars par semaine. La modeste firme en question portait le nom de Goldman Sachs.
C’est ainsi que Weinberg a commencé son inexorable ascension vers le sommet, raconte Charles Ellis dans son livre The Partnership: The Making of Goldman Sachs. L’une de ses premières tâches a consisté à apporter, en trolley, un porte-drapeau à la résidence de la famille Sachs. C’est Paul Sachs, le petit-fils du fondateur de l’entreprise, qui lui a ouvert la porte, et il s’est aussitôt lié d’amitié avec le jeune homme. Weinberg a alors été très rapidement promu à la manutention du courrier, qu’il a réorganisée promptement. Puis Sachs l’a envoyé apprendre les rouages du métier au Browne’s Business College, à Brooklyn. En 1925, la firme lui a offert un poste à la Bourse de New York. Il a été promu au rang d’associé en 1927, puis d’associé principal trois ans plus tard. Durant les 39 années qui ont suivi — et jusqu’à son décès en 1969 —, Weinberg a été Goldman Sachs, propulsant une firme qui vivotait au premier rang mondial des banques d’affaires.
Ingrédient essentiel de l’histoire des États-Unis, ces histoires de passage de la misère à la richesse se sont vu attribuer deux interprétations diamétralement opposées. Au xixe siècle, on insistait sur l’importance de surmonter des obstacles et des circonstances désavantageuses pour progresser dans la société. Selon la sagesse populaire de l’époque, la meilleure façon de réussir était de commencer au bas de l’échelle, car cela obligeait les fonceurs à acquérir les talents nécessaires pour atteindre les sommets. Dans une étude publiée en 1954 et intitulée The Self-Made Man in America, Irvin G. Wyllie note ainsi que « les commerçants new-yorkais préféraient embaucher de jeunes campagnards, qu’ils estimaient plus travailleurs, opiniâtres, obéissants et enthousiastes que des gens de New York ». Andrew Carnegie, dont l’histoire personnelle se voulait l’archétype même de ces hommes qui s’étaient élevés à la force du poignet, affirmait qu’il était profitable de naître et de grandir dans un milieu défavorisé: « Les enseignants, les martyrs, les inventeurs, les hommes d’État, les poètes et même les gens d’affaires ne sont généralement pas des enfants de millionnaires ou issus de l’aristocratie. Ils sont presque tous passés par l’école de la pauvreté. »
De nos jours, on tend plutôt à croire que le succès dépend de la manière dont on se sert de certains atouts socioéconomiques. Les méca–nismes de promotion sociale — les bourses d’études, les aides à l’accès à la propriété, etc. — visent tous à extraire les pauvres de leur situation désespérante. On ne veut plus tirer des leçons de la pauvreté, mais plutôt la fuir, et le livre de Charles Ellis sur la saga Goldman Sachs en est une illustration parfaite.
« Un stupide ignorant de Brooklyn »
Weinberg n’avait rien d’un génie de la finance, mais c’était un communicateur hors pair. À son apogée, il était membre de 31 conseils d’administration et participait à quelque 250 comités et réunions d’affaires chaque année. Durant la Grande Dépression, il a travaillé au Comité de planification et de services-conseils de l’entreprise implanté par le président Franklin D. Roosevelt, qui l’a alors surnommé « le politicien » en raison de ses talents de médiateur. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été vice-président du Comité de production militaire: sa faculté de convaincre de nombreux jeunes cadres d’entreprise de s’associer à l’effort de guerre lui a valu le sobriquet de « voleur de cadavres ».
Quand le constructeur automobile Ford a décidé, au milieu du siècle dernier, de devenir une entreprise publique, les deux parties engagées dans cette transaction d’une complexité phénoménale — la famille Ford et la Fondation Ford — voulaient être représentées par nul autre que Weinberg, « Monsieur Wall Street ». E. J. Kahn, qui a dressé le portrait de Weinberg dans le New Yorker il y a 50 ans, expliquait bien pourquoi: « Il avait un rôle d’éminence grise. Aucun haut dirigeant d’entreprise importante ne lui était inconnu. Ceux qui cherchaient des informations sur leurs compétiteurs se tournaient d’emblée vers lui, tout comme les agences de vérification de crédit et de conseil. Quand il parlait au téléphone, il émaillait sa conversation de phrases telles que “Si je connais untel ? Bien sûr que oui, c’est un ami personnel. O.K., je vais lui demander de vous passer un coup de fil”. »
Une telle affinité était de mise dans le milieu financier américain du début du xxe siècle. Si l’on voulait conclure des affaires d’envergure, il fallait connaître le président de chaque entreprise concernée, ce qui était nettement plus facile quand on avait été son confrère de classe à l’université. Pourtant, Weinberg était le produit de l’école publique et non d’une prestigieuse institution, et il n’a d’ailleurs jamais prétendu faire partie de cette élite, bien au contraire: « N’embellissez pas mon histoire, je ne suis qu’un stupide ignorant de Brooklyn », martelait-il.
Dans les années 1920, Weinberg a fait l’acquisition d’une modeste résidence à Scarsdale, où il a vécu jusqu’à sa mort. Il prenait toujours le métro. Il ne manquait jamais une occasion de rappeler à ses pairs qu’il provenait de l’autre côté de la clôture.
« Un jour, au cours d’une réunion, un haut dirigeant s’est lancé dans le compte rendu d’un assommant rapport statistique ponctué d’une interminable énumération de chiffres. Quand il s’est arrêté pour reprendre son souffle, Weinberg en a profité pour se lever d’un bond en agitant son exemplaire du rapport et s’est écrié “Bingo !” » raconte Charles Ellis. La stratégie idéale pour un immigrant, selon le vieil adage, est de penser en yiddish, mais de s’habiller à l’anglaise. Weinberg faisait exactement le contraire.
Le pouvoir insoupçonné de l’« étranger »
Comment expliquer que cette stratégie a été aussi payante pour Weinberg ? Difficile à dire, mais on peut supposer que la théorie d’Andrew Carnegie a du bon: il arrive parfois que d’être un « étranger » est précisément ce qui fait d’une personne un bon « candidat ».
Puisque Weinberg avait réussi à s’extirper de Brooklyn, comment pouvait-on douter de sa valeur ? Tout le monde savait qu’il était habitué à frayer dans un monde peuplé de diplômés de Yale et autres institutions prestigieuses. Lui savait surtout que, parmi ces gens, seuls quelques-uns étaient vraiment compétents, et que les autres ne devaient leur place à Wall Street qu’au solide réseau de contacts dont ils bénéficiaient d’entrée de jeu.
Ce côté marginal permettait à Weinberg de jouer le rôle classique d’intermédiaire issu d’une minorité. Ainsi, l’une des raisons du succès des Parsi en Inde, des Asiatiques du Sud-Est en Afrique et des Libanais dans les Antilles tient, selon des sociologues, au fait qu’ils se sont détachés de leur communauté d’origine. Par exemple, un Kényan qui veut ouvrir une épicerie au Kenya (ou un Malais en Malaisie, etc.) fait face à un gros handicap: celui d’avoir une parenté et des amis qui veulent un emploi ou des réductions. Il est difficile de refuser de faire crédit ou de réclamer le paiement d’une dette à son voisin si l’on fait partie d’une même communauté, car notre vie est liée à la sienne.
L’anthropologue Brian Foster décrit ainsi la situation commerciale en Thaïlande: « Un courtier soumis aux impératifs sociaux traditionnels pourrait difficilement rentabiliser son entreprise. S’il s’intégrait complètement à son milieu, il lui faudrait nécessairement faire preuve de générosité envers les plus démunis, ce qui l’obligerait à faire crédit en sachant qu’il ne récupérerait pas les sommes prêtées. Le conflit d’intérêts inhérent aux transactions commerciales individuelles compromettrait sérieusement l’étiquette de ses relations sociales, une notion extrêmement importante aux yeux des Thaïlandais. »
Les membres d’une minorité ne sont pas soumis à de telles règles, car ils peuvent séparer les relations sociales des considérations commerciales. Ils peuvent, entre autres, dénoncer publiquement un mauvais payeur ou un mauvais client sans s’inquiéter des implications sociales de leur geste.
Weinberg faisait preuve d’un détachement similaire face aux institutions financières, une attitude attrayante aux yeux des hauts dirigeants d’entreprise. « Sidney était le seul homme que je connaissais qui pouvait se permettre de me traiter d’idiot en pleine réunion du conseil d’administration tout en me donnant l’impression qu’il venait de me faire un compliment », reconnaissait E. F. Hutton, le PDG de General Foods.
Pas question de traiter le patron de General Foods de crétin si l’on a étudié à Yale, mais c’est acceptable si l’on est le fils de Pincus Weinberg, issu de Brooklyn. Une certaine distanciation sociale permet de dire plus facilement la vérité.
Durant la Seconde Guerre mondiale, l’amiral Jean-François Darlan, l’un des hauts dirigeants du gouvernement provisoire de Vichy, avait été invité à la Maison-Blanche. Militaire de carrière hautain et affecté, il était soupçonné d’être un sympathisant nazi. Le protocole exigeait qu’en sa qualité d’allié, il soit traité avec respect et courtoisie, et tous s’y plièrent, à l’exception de Weinberg. Libre des contraintes sociales qui entravaient ses confrères, il ne s’est pas gêné pour dire tout haut ce que tous pensaient tout bas, sans doute à leur immense satisfaction. « Au moment du départ, relate Charles Ellis, Weinberg plongea la main dans sa poche en atteignant la sortie, prit une pièce de monnaie et la remit au militaire galonné en costume d’apparat, en lui disant: “Allez, mon brave, trouvez-moi un taxi”. »
D’heureuses carences intellectuelles
Andrew Carnegie était convaincu que la pauvreté prédisposait davantage au succès que l’aisance — autrement dit, qu’il était plus profitable de surmonter des obstacles que de tirer parti de circonstances favorables. C’est là une notion aussi familière que déroutante.
Curieusement, plusieurs entrepreneurs très prospères souffrent de sérieuses carences intellectuelles. Paul Orfalea, le fondateur de la chaîne de photocopieuses Kinko, a collectionné les « D », a redoublé à deux reprises et a été expulsé de quatre écoles: « En troisième année, le seul mot que je pouvais lire était “le”. Pour suivre comme les autres, dans un texte, je devais me repérer en passant d’un “le” au suivant », a-t-il déjà confié. De son côté, le milliardaire Richard Branson, qui a bâti l’empire Virgin, a quitté l’école à 15 ans en raison des ses difficultés en lecture et en écriture, et a avoué avoir été cons–tamment le dernier de la classe. Dans Silicon Valley, John Chambers, le fondateur de Cisco, n’est capable de déchiffrer que ses courriels. Craig McCaw, l’un des pionniers de la téléphonie mobile, est dyslexique, tout comme Charles Schwab, le fondateur de la firme de courtage qui porte son nom.
Professeure dans une école de commerce, Julie Logan a fait récemment une étude auprès de propriétaires de petites entreprises américaines, et elle a constaté que 35 % d’entre eux souffraient de dyslexie. Ce handicap est pourtant considéré comme lourd, du moins assez pour empêcher la personne qui en souffre d’évoluer normalement dans la société. Alors, comment les Schwab, Branson, McCaw et autres Orfalea ont-ils fait pour briller à ce point ? C’est, selon Carnegie, qu’ils ont réussi à surmonter leur handicap, de la même manière que les pauvres réussissent à s’élever au-dessus de leur rang social.
En raison de leurs problèmes de lecture et d’écriture, ces leaders ont dû devenir experts en résolution de problèmes et en communication orale, et ils ont appris très vite à déléguer des tâches, puisqu’il étaient, entre autres, obligés de s’appuyer sur les autres pour l’écrit. Une étude britannique montre que 80 % des entrepreneurs dyslexiques ont été capitaines d’une équipe sportive à l’école secondaire, un pourcentage qui tombe à 27 % chez les non-dyslexiques. Les dyslexiques ont compensé leurs lacunes scolaires en développant au maximum leurs talents relationnels, ce qui leur a procuré un avantage indéniable quand ils ont intégré le marché du travail. « Je n’avais aucune confiance en moi durant ma jeunesse, et ça m’a bien servi par la suite. À force de se heurter à des murs, on apprend à trouver sa propre voie », a dit à ce sujet Orfalea.
Les modèles d’interprétation selon lesquels les individus compensent leurs déficiences contredisent donc la théorie de la sélection naturelle de Darwin, qui affirme que les forts deviennent plus puissants alors que les plus faibles déclinent inexorablement. On nous a convaincus que la route du succès passe nécessairement par une scolarisation optimale: les meilleures écoles, des professeurs émérites, de petites classes, des locaux pimpants, etc. Pourtant, un seul coup d’œil sur les résultats d’enfants d’autres pays — souvent supérieurs à leurs homologues américains en dépit des salles de classe bondées, de budgets étriqués et de locaux vétustes et décrépits — nous force à nous demander si ce concept de capitalisation des avantages n’est pas tout aussi simpliste que la théorie de l’avantage des désavantages postulée par Carnegie.
L’erreur Catchings
E. J. Kahn, dans son portrait de Weinberg, raconte l’histoire d’une retraite de cadres organisée par Averell Harriman à son centre de ski de Sun Valley, dans l’État de l’Idaho. Weinberg y participait même s’il n’avait jamais skié de sa vie: « Plusieurs dirigeants parièrent 25 dollars qu’il serait incapable de descendre la pente la plus abrupte de la station. » À l’aube de la cinquantaine, Weinberg ne se déroba pas et accepta le défi: « J’ai approché un instructeur nommé Franz ou Fritz quelque chose pour qu’il me donne un cours de base durant une demi-heure, à la suite de quoi je me suis rendu au sommet. Il m’a fallu une demi-journée pour descendre la piste, j’ai terminé le parcours sur un seul ski et j’ai été couvert de bleus pendant les deux semaines suivantes, mais j’ai gagné le pari », a-t-il dit.
Ainsi, dans un cadre idyllique, l’élite blanche anglo-saxonne de l’Amérique s’amusait, telle une bande de délinquants juvéniles, à tenter de tourner le petit juif en dérision, en accord avec la vague d’antisémitisme qui régnait alors. Vingt ans plus tard, Weinberg prit une éclatante revanche en pilotant la première émission d’actions de Ford, fondée par Henry Ford, un antisémite notoire. Weinberg avait sans doute réalisé que la prémisse selon laquelle les juifs contrôlent complètement le milieu bancaire s’appuie sur le fait que les juifs sont tout simplement d’excellents banquiers. Par conséquent, le premier stéréotype est réducteur, alors que le second est un tremplin apte à attirer de nouveaux clients. Bref, quand on veut bâtir un empire, il faut utiliser toutes les ressources disponibles à son avantage.
En 1918, Henry Goldman, un associé principal de Goldman Sachs, claqua la porte de la banque d’affaires pour protester contre les « bons de la Victoire » (Liberty Bonds). Germanophile convaincu, il refusait d’aider les Alliés durant le conflit — ce qui ne l’empêcha pas, plus tard, d’acheter un Stradivarius à Yehudi Menuhin, alors âgé de 25 ans, ainsi qu’un yacht qu’il offrit à Albert Einstein. Pour le remplacer, les frères Arthur et Walter Sachs jetèrent leur dévolu sur un jeune homme du nom de Waddill Catchings, un ami proche d’Arthur durant ses années à Harvard. Celui-ci travaillait déjà à Wall Street, au vénérable cabinet Sullivan & Cromwell, il possédait une bonne connaissance du milieu industriel et il avait réorganisé plusieurs entreprises. Par-dessus le marché, Catchings était « le plus talentueux, élégant, charmant, érudit et ambitieux de tous les hommes de Wall Street », selon Charles Ellis.
Catchings avait un plan audacieux, qui consistait à créer la Corporation de courtage Goldman Sachs, une immense fiducie similaire aux firmes de fonds spéculatifs d’aujourd’hui. L’idée était de contracter des emprunts massifs pour acquérir des parts majoritaires dans d’importantes entreprises. À l’origine, la valeur du fonds devait se chiffrer à 25 millions de dollars, mais Catchings, propulsé aux premières loges du boom boursier des années 1920, fit passer le montant à 50 millions, puis à 100 millions de dollars, avant de fusionner le fonds Goldman à un autre et de créer deux trusts subsidiaires. À son apogée, la société mise en place par Catchings contrôlait un actif d’un demi-milliard de dollars.
« Les frères Sachs visitaient l’Europe durant l’été 1929, et c’est en Italie qu’ils eurent vent des manœuvres de Catchings, lesquelles inquiétèrent beaucoup Walter. Dès son retour à New York, celui-ci fonça chez Catchings pour l’exhorter à plus de prudence, mais ce dernier, emporté par l’euphorie boursière, ne bougea pas d’un cil: “Le problème avec toi, Walter, c’est que tu n’as aucune imagination”, rétorqua-t-il », selon Ellis.
Après le Vendredi noir, le titre de Goldman Sachs, qui avait valu jusqu’à 326 $, chuta à 1,75 $. La banque d’affaires fut aussitôt bombardée de poursuites en justice, dont la dernière ne fut finalement réglée qu’en 1968. Eddie Cantor, un humoriste populaire de l’époque et un investisseur malheureux, tourna en dérision le nom jusqu’alors fort respecté de Goldman Sachs: « Ils m’ont dit d’investir dans leurs actions pour assurer mes vieux jours et leur plan a parfaitement réussi. Au bout de six mois, je me suis soudainement senti très très vieux ! » raillait-il.
Catchings fut congédié et Walter Sachs commenta son départ en ces termes: « Très peu de gens savent comment gérer le succès et, de toute évidence, Catchings n’était pas un de ceux-là. » Élevé dans la ouate, il n’était absolument pas prêt à affronter une crise de cette ampleur. Il fut remplacé par quelqu’un qui n’avait pas eu la vie facile. Avec le recul, on ne peut qu’applaudir cette sage décision. Ce dont Wall Street a besoin, c’est de plus de Sydney Weinberg et de moins de Waddill Catchings.