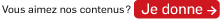Dans The Self-Destructive Habits of Good Companies... And How to Break Them, Jagdish N. Sheth soutient que les entreprises les plus florissantes ont encore un ennemi à battre: elles-mêmes. Car le succès peut les rendre aveugles à la concurrence et aux changements dans leur marché.
POURQUOI des leaders de leur industrie comme Xerox ou General Motors finissent-ils par voir pâlir leur aura ? « À mesure qu’elles croissent, ces sociétés développent déni, arrogance, dépendance à l’égard d’une compétence clé et myopie concurrentielle 1 », répond Jagdish N. Sheth. Des comportements autodestructeurs qui expliquent la cécité dont souffrent même les plus brillantes entreprises, ce qui les rend inaptes à voir leur environnement changer et à ressentir le besoin de s’adapter.
The Self-Destructive Habits of Good Companies… And How to Break Them | Jagdish N. SHETH, Wharton School Publishing, août 2009.
###
EN BREF
Les géants soi-disant « invincibles » peuvent eux aussi s’écrouler. Selon Jagdish N. Sheth, les naufrages d’entreprises florissantes s’expliquent par des comportements destructeurs comme l’arrogance, le déni (du changement), la « myopie concurrentielle » et une trop grande dépendance à l’égard des compétences qui ont jadis fait leur succès.
Or, on peut parfaitement prévenir ces comportements malsains. Encore faut-il entendre les signaux d’alarme, éviter le déni, et reconnaître ses faiblesses et ses mauvaises habitudes pour renverser la vapeur. Le mieux consiste à empêcher que de tels comportements s’installent et à admettre que les clés du succès d’hier pourraient ne plus fonctionner demain.
***
DANS SON OUVRAGE The Living Companies 2, paru en 1997, Arie de Geus soulignait que le tiers des entreprises du Fortune 500 de 1970 n’existaient déjà plus en 1983. Il expliquait également qu’en Europe, l’espérance de vie moyenne d’une entreprise était d’à peine 12,5 ans. Selon Jagdish N. Sheth, les géants aussi peuvent s’écrouler : certaines entreprises ont beau avoir les meilleurs gestionnaires, de multiples succès, des produits géniaux et un avantage imprenable sur leurs concurrents, elles n’échappent pas toujours au naufrage. Pourquoi ? Généralement, parce qu’elles ont été incapables de changer, alors que leur environnement les y forçait. Raison de ces échecs : le déni, l’arrogance, la dépendance à l’égard de certaines compétences et la « myopie concurrentielle », autant d’attitudes destructrices acquises sur le chemin du succès.
LE DÉNI
LE REFUS DE RECONNAÎTRE LA RÉALITÉ
« Le syndrome du déni touche souvent les entre¬prises qui ont perdu l’humilité de leurs débuts et qui créent une mythologie de leur grandeur. » C’est d’autant plus dangereux que les réussites sont souvent liées à la « chance d’être là au bon moment », rappelle l’auteur. Habituellement, l’humilité des débuts disparaît avec le fondateur, quand la se¬conde ou la troisième génération prend les rênes. Les valeurs jadis partagées autour d’une histoire commune se transforment alors en mythes, en routines organisationnelles. Résultat : l’environnement évolue, mais la rigidité de l’entreprise l’amène à nier les menaces qui pèsent sur elle.
Un exemple : comment General Motors a nié l’évolution de son environnement
Selon Jagdish N. Sheth, le déni porte généralement sur l’évolution de son environnement. Par exemple, l’émergence d’une nouvelle technologie, comme Kodak en a fait les frais avec l’arrivée soudaine de la photographie numérique au début des années 2000. Il peut également s’agir d’un déni de la variation de l’environnement global de l’entreprise. Le cas General Motors en est un bel exemple. Quand Jack Smith, alors cadre dirigeant de GM, visite Toyota au Japon au début des années 1980, il constate que sa propre société a deux fois plus d’employés pour construire exactement le même nombre de voitures que son concurrent. De retour aux États-Unis, il n’arrive pas à convaincre son comité exécutif. Résultat : en 1990, les pertes de GM s’élevaient à 2 milliards de dollars, puis à 4,5 milliards en 1992. Le marché mondial de l’automobile change, mais pas GM. Plus récemment, en 2008, malgré l’aide de l’État, l’ancien fleuron de l’industrie américaine affichait une perte nette de 30,9 milliards de dollars. Ce groupe automobile est aujourd’hui celui qui résiste le moins bien à la crise.
L’ARROGANCE
UN SENTIMENT DE SUPÉRIORITÉ, DE FIERTÉ ET D’INSOLENCE
L’arrogance renvoie à une image de soi déformée, qui ne reflète pas la réalité. « En gros, cela veut dire : aimer à un tel point le son de sa voix qu’on n’entend plus celle des autres », explique Jagdish N. Sheth. Souvent, l’arrogance se développe à la suite de réussites exceptionnelles qui altèrent la perception des réalités d’aujourd’hui et des changements à venir.
Un exemple : comment l’arrogance a poussé Microsoft à sous-estimer ses concurrents
L’arrogance prend des formes diverses, mais toutes proviennent d’un parcours jalonné de succès. C’est le cas de Microsoft, une petite entreprise créée par deux étudiants, qui, en quelques années, est devenue le leader mondial du logiciel informatique. Partis de rien, Bill Gates et Paul Allen ont réussi à imposer leurs logiciels (notamment le système d’exploitation Windows et la suite bureautique Microsoft Office) sur la presque totalité des ordinateurs. Mais cette situation de quasi-monopole est en train de s’essouffler. D’une part, parce que de nombreux pays soulignent les abus qui découlent de la position dominante de Microsoft, ce que le groupe a encore du mal à admettre ; d’autre part, parce que l’arrivée d’Internet a profondément modifié le marché, permettant à d’autres firmes, notamment Google, de voir le jour.
LUTTER CONTRE L’ARROGANCE
Pour combattre l’arrogance, Jagdish N. Sheth nous invite à miser sur la diversité des individus et des parcours. Par exemple, il recommande de :
> Confronter les dirigeants à des difficultés dans des marchés non familiers et risqués : Jagdish N. Sheth rappelle que « Jack Welch disait qu’il aimait les gestionnaires dont le CV comporte quelques échecs, car l’échec enseigne la modestie » ;
> Mettre en place des plans de relève originaux : sélectionner les gestionnaires bien avant qu’ils n’arrivent au sommet et les intégrer à plusieurs divisions, fonctions et marchés ;
> Diversifier les talents en recrutant des gens aux profils différents : « L’insularité nourrit l’arrogance », rappelle Jagdish N. Sheth en prenant l’exemple de Whirlpool qui, pendant des années, ne recrutait que des diplômés de l’Université Purdue, au détriment de son innovation ;
> Changer de leadership : en situation de crise, l’entreprise ne doit pas hésiter à recruter un dirigeant qui a fait ses preuves à l’extérieur. Comme Lou Gerstner, embauché pour sauver IBM au début des années 1990. Ce n’est pas une garantie de succès, mais c’est probablement le meilleur moyen pour repenser la culture de l’entreprise.
LA DÉPENDANCE À L’ÉGARD D’UNE COMPÉTENCE CLÉ
LA FOCALISATION SUR UN SAVOIR-FAIRE PARTICULIER
Pour Jagdish N. Sheth, si « le succès de la plupart des entreprises dépend d’une compétence clé, cette dépendance devient un comportement autodestructeur quand elle limite la vision et empêche de percevoir de nouvelles occasions d’affaires ». Que faire, en effet, quand une compétence clé devient soudainement obsolète ? Quand quelqu’un d’autre fait du meilleur travail et que vos clients vous abandonnent ?
Un exemple : la dépendance de Lego à l’égard du design
La dépendance à l’égard des compétences peut porter sur différents éléments de la chaîne de valeur : la R-D, les ventes, le service à la clientèle ou le design, comme la société Lego l’a appris dernièrement. En 1949, la création des briques Lego permet au groupe d’entamer une période de croissance ininterrompue de plusieurs décennies. Mais en 1994, pour la première fois de son histoire, Lego voit son chiffre d’affaires chuter de 20 %. En 1998, l’entreprise doit licencier 10 % de son effectif. Malgré ses efforts, en 2000, le groupe danois perd 105 millions de dollars, puis 170 millions en 2003. Jagdish N. Sheth explique cette « triste histoire d’un produit génial » par la trop forte dépendance de Lego à l’égard de ses briques de construction : « Dans les années 1980 et 1990, tout a changé, y compris les loisirs des enfants, mais pas Lego. » Depuis 2005, la tendance s’est inversée, notamment grâce à une meilleure prise en compte de l’attrait des enfants pour les jeux vidéo.
LUTTER CONTRE LA DÉPENDANCE À L’ÉGARD D’UNE COMPÉTENCE CLÉ
Pour Jagdish N. Sheth, le meilleur moyen de lutter contre la dépendance à l’égard d’une compétence consiste à toujours s’intéresser aux nouvelles occasions d’affaires qui se présentent. Il propose de :
> Chercher de nouvelles applications à ses compétences pour trouver des sources originales de création de valeur. L’enjeu : surveiller constamment son marché ;
> Trouver de nouveaux marchés dans lesquels les compétences existantes restent un atout, notamment en misant sur le développement international. Par exemple, les vastes marchés émergents de l’Inde et de la Chine constituent de nouvelles pistes de développement;`> Étendre son bagage de compétences tout au long de la chaîne de valeurs : comme le fait IBM, qui vend aujourd’hui son savoir-faire à d’autres constructeurs informatiques (cartes à puces, serveurs et logiciels, notamment);
> Développer de nouvelles compétences: cons¬cient de la baisse de la demande pour les pellicules argentiques, Kodak s’est peu à peu repositionnée comme un acteur incontournable du numérique. Un changement stratégique réussi qui lui aurait coûté près de trois milliards de dollars (dont une grande partie a été financée par la vente de pellicule dans les pays émergents).
LA « MYOPIE CONCURRENTIELLE »
UNE DÉFINITION TROP ÉTROITE DE CE QU’EST LA CONCURRENCE
Jagdish N. Sheth parle de « myopie concurrentielle » à propos des entreprises qui « manquent d’une vision périphérique qui leur permettrait de déceler les concurrents cachés, dont la menace n’apparaît pas encore au radar, mais qui est néanmoins bien réelle et dangereuse ». C’est le cas, par exemple, de Coca-Cola, qui n’a pas vu venir Pepsi, ou de Boeing, qui a longtemps sous-estimé Airbus.
LUTTER CONTRE LA MYOPIE CONCURRENTIELLE
Jagdish N. Sheth propose quelques pistes pour identifier ses concurrents et mettre en place des stratégies de défense :
> Redéfinir le paysage concurrentiel. Les concurrents varient en fonction des différents marchés dans lesquels se trouve une entreprise. Par exemple, s’il est facile pour IBM de reconnaître ses concurrents en matière de construction de matériel informatique, elle doit être beaucoup plus vigilante sur le marché extrêmement éclaté des services informatiques.
> Consolider ses marchés. Renforcer son positionnement en augmentant sa capacité à répondre aux besoins des clients : voilà la stratégie choisie par Air France lors du rachat de KLM en 2004 et du lancement de Transavia en 2007 pour résister aux compagnies qui offraient des tarifs aériens réduits.
> Contre-attaquer ses concurrents non traditionnels et développer sa présence sur le marché de ses concurrents. Comme le fabricant d’électroménagers Electrolux qui, face à une concurrence de plus en plus féroce des américains Whirlpool et GE, est parvenu à s’imposer dans le marché des États-Unis en rachetant White Consolidated à la fin des années 1990.
> Se recentrer sur ses activités principales et concentrer ses forces sur les marchés les plus rentables. À l’image de Ratan Tata qui, après une grande diversification du groupe indien Tata, recentre ses activités sur quelques secteurs clés : le thé, l’acier, l’automobile, les télécoms, l’énergie et les technologies de l’information.
Un exemple : McDonald’s n’a pas prévu la guerre du fast food
McDonald’s est sans conteste un exemple à suivre pour beaucoup d’entreprises. Créée à la fin des années 1930, elle s’est imposée, en un demi-siècle, comme le leader mondial de la restauration, et sa marque demeure l’une des plus connues dans le monde. Pourtant, depuis le début des années 2000, elle fait face à bien des difficultés : entre 2000 et 2002, elle a fermé 175 restaurants et licencié 1 300 collaborateurs. Son erreur : avoir concentré son attention sur la concurrence dans le marché du hamburger (en particulier Burger King), sans voir la percée de concurrents non traditionnels : Pizza Hut, Poulet frit Kentucky, Taco Bell. Depuis 2003, la nouvelle stratégie, qui mise notamment sur la diversification (offre de salades et de menus santé, lancement des McCafé), permet au groupe de reprendre des parts de marché à ses concurrents : en 2008, le chiffre d’affaires de McDonald’s était en croissance de près de 7 % par rapport à 2007.
Chaque entreprise développe probablement ses propres habitudes autodestructrices. Comment toutes les déceler et y remédier ? Le problème doit être pris dans le sens inverse, explique Jagdish N. Sheth, qui préfère inviter les entreprises à prévenir leur apparition. Le secret pour y parvenir : prendre conscience que ce qui a fait les succès d’autrefois pourrait très bien ne plus fonctionner demain. Cette sensibilisation ne peut naître qu’au sommet de la hiérarchie, grâce à des leaders ouverts qui voient les changements se profiler et refusent de s’enfermer dans le monde rassurant des routines organisationnelles.
1. SONT PRÉSENTÉES ICI QUATRE DES SEPT HABITUDES AUTODESTRUCTRICES QUE MENTIONNE JAGDISH N. SHETH DANS SON OUVRAGE. LES TROIS AUTRES SONT : LA COMPLAISANCE, L’OBSESSION DES VOLUMES ET L’INSTINCT TERRITORIAL.
2. THE LIVING COMPANY – HABITS FOR SURVIVAL IN A TURBULENT BUSINESS ENVIRONMENT, PAR ARIE DE GEUS. BOSTON, HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESS, 1997.
***
Repérer et prévenir les mauvaises habitudes
D’après The Self-Destructive Habits of Good Companies… And How to Break Them, de Jagdish N. SHETH (Wharton School Publishing, août 2009)
Après avoir relevé les habitudes autodestructrices, vérifiez si l’une d’elles ne se montre pas le bout du nez. Comment savoir si votre entreprise souffre de déni, d’arrogance, de dépendance à l’égard d’une compétence clé ou de myopie concurrentielle ? Pour Jagdish N. Sheth, certains signes ne trompent pas, mais les détecter ne résout pas le problème. En un sens, il est même déjà un peu tard ! Que faire alors pour éviter que les voyants ne passent au rouge ?
Petite liste de vérification.
1 LE DÉNI : LE REFUS DE RECONNAÎTRE LA RÉALITÉ
Les signaux d’alarme
> Le syndrome « Ça n’arrive qu’aux autres » : vous pensez que vous êtes différent et vous êtes sûr de ne jamais tomber dans le piège du déni.
> Le syndrome du « Pas inventé ici » : vous ne voulez pas adopter une nouvelle idée qui pourrait vous être utile, car vous ne l’avez pas développée vous-même.
> Le syndrome « C’est pas ma faute » : vous ignorez vos propres problèmes et trouvez des prétextes, ou vous les imputez aux autres.
Prévenir le déni
> Remettez en question les fondements de votre entreprise et vos façons de travailler.
> Créez un « institut de développement des leaders » qui mise sur l’anticipation du futur.
2 L’ARROGANCE : UN SENTIMENT DE SUPÉRIORITÉ, DE FIERTÉ ET D’INSOLENCE
Les signaux d’alarme
> Vous croyez tout savoir mieux que les autres. Cela vous dispense d’écouter vos clients, vos employés, vos investisseurs et l’ensemble des parties prenantes.
> Vous adorez parler de vos succès.
> Vous manquez de considération pour les règles et les procédures, car votre entreprise est intouchable.
> Vous vous entourez de personnes qui pensent comme vous et vous écartez les autres.
Prévenir l’arrogance
> Gardez à votre disposition un coach spécialisé, qui détectera tout comportement arrogant et vous rappellera les écueils auxquels mène cette attitude.
> Mettez en place un système de contrepoids pour vous assurer que le pouvoir n’est pas concentré chez une seule personne.
> Donnez à vos collaborateurs le droit à l’erreur.
3 LA DÉPENDANCE À L’ÉGARD D’UNE COMPÉTENCE : LA FOCALISATION SUR UN SAVOIR-FAIRE PARTICULIER
Les signaux d’alarme
> Réingénierie, réorganisation, réoutillage. Vous avez tout essayé pour changer, en vain.
> Dans l’entreprise, les employés sont inquiets, impuissants et découragés.
> Les investisseurs et les fournisseurs vous abandonnent.
Prévenir la dépendance à l’égard d’une compétence
> Surveillez constamment les innovations technologiques.
> Mettez vos compétences à profit pour développer de nouveaux produits et services.
> Diversifiez vos compétences pour gagner d’autres marchés ou segments de marché.
> Mettez en place une stratégie de croissance fondée sur les acquisitions et l’intégration.
4 LA MYOPIE CONCURRENTIELLE : UNE DÉFINITION TROP ÉTROITE DE LA CONCURRENCE
Les signaux d’alarme
> Vous ne surveillez que les gros concurrents et vous négligez la menace que présentent les petites entreprises spécialisées.
> Vous tenez pour acquise la fidélité de vos fournisseurs sans vous rendre compte qu’ils pourraient trouver d’autres clients.
> Vous mésestimez la menace des nouveaux arrivants sur le marché, en particulier ceux des pays émergents.
> Vous avez trop attendu avant d’investir dans une nouvelle technologie, et il est désormais trop tard.
Prévenir la dépendance à l’égard d’une compétence
> Montez une équipe de veille concurrentielle.
> Investissez dans d’autres technologies concurrentes.
> Cherchez à acquérir des entreprises spécialisées qui ont des technologies innovantes.
> Ciblez un marché émergent d’où pourrait provenir une nouvelle concurrence.
***
Témoignage - Tata Group
Un combat quotidien contre la complaisance et le déni
D’après Business of Excellence: The Tata Journey (GroupPublications, 2008) et une interview de R. GOPALAKRISHNAN, directeur exécutif de Tata Sons, réalisée en décembre 2009.
Pour R. Gopalakrishnan, la nature humaine comporte sa part de tendances auto–destructrices – du déni à la complaisance. Même les meilleures entreprises (et les meilleurs gestionnaires), à un moment ou à un autre, ont du mal à y échapper. Selon lui, l’attaque de front est la stratégie la mieux adaptée pour les combattre. C’est peut-être là le secret des 140 ans d’existence et des courbes de croissance de Tata Group !
AU MOMENT OÙ RATAN TATA prend les commandes de Tata Group, en 1991, il arrive à la tête d’un conglomérat sans grande cohésion de quelque 75 entreprises dispersées aux quatre coins de l’Inde. Importantes ou modestes, rentables ou en difficulté, elles ont toutes un point commun : une certaine tendance à la complaisance et à la fierté. Plus de 40 ans de protectionnisme (coût des licences commerciales, restrictions des importations…) ont créé un climat très favorable pour des géants locaux tels que Tata Group, et nombre d’entreprises du groupe dorment tranquillement sur leurs acquis, en l’absence de véritable concurrence intérieure ou internationale.
Alarmé par la perspective de perdre tout avantage concurrentiel dans la nouvelle économie libéralisée, Ratan Tata décide, pour renverser la vapeur, de lancer une opération « Excellence en affaires », un projet d’envergure engagé sur plusieurs fronts : réduction des coûts, optimisation de la qualité, innovation, acquisitions à l’étranger, etc.
Deux décennies plus tard, les résultats sont là. Au début des années 1990, le revenu annuel du groupe se situait entre trois et quatre milliards de dollars, dont 90% provenaient du marché indien. Aujourd’hui, ce chiffre atteint 70 milliards, réalisés à 65% sur les marchés internationaux. R. Gopalakrishnan, directeur exécutif de Tata Sons, analyse les principales phases et les défis majeurs du « régime de remise en forme » qui a aidé le Groupe à laisser tomber son autosatisfaction léthargique pour devenir un poids lourd mondial.
Les premières étapes : le processus JRD QV
Pour lancer le mouvement, Ratan Tata a mis en place un comité de pilotage à Tata Sons, la société mère du Groupe, en septembre 1994. Comité qui, sous sa direction, s’efforce de mener à bien un programme visant la qualité à l’échelle du Groupe. Un sous-comité a également été constitué, avec pour mission de porter l’effort d’excellence et d’y rallier les effectifs. Les deux comités ont mis en œuvre le processus d’optimisation, baptisé «JRD QV» en hommage à l’ancien dirigeant JRD Tata1. Le JRD QV s’appuie sur le modèle de Malcolm Baldrige 2, qui préconise une méthodologie axée sur les processus et applicable à tous les secteurs d’activité. «Ce modèle permet d’établir des normes d’excellence à la fois en matière d’éthique commerciale et de qualité de l’offre, explique R. Gopalakrishnan. Il nous permet d’interpréter la pertinence de nos méthodes de leadership et d’analyser nos pratiques avec clairvoyance. »
Plusieurs étapes ont ponctué la mise en place du nouveau processus au sein du Groupe. D’abord, un livret explicatif sur les critères du modèle de Baldrige a été distribué dans toutes les sociétés. Ensuite, on a formé des évaluateurs pour implanter la méthodologie au sein de leur entreprise et assumer le rôle « d’ambassadeurs qualité ». Enfin, on a créé un prix d’excellence pour récompenser les entreprises qui s’étaient distinguées en matière de gestion de la qualité et de service à la clientèle.
Des débuts difficiles : les travers tenaces de la complaisance
Au départ, la voie du changement s’annonce difficile. Malgré la pression croissante du marché et de la concurrence, les leaders se montrent réticents face aux nouvelles méthodes de travail et défendent bec et ongles le statu quo. D’après R. Gopalakrishnan, des notions telles que le service à la clientèle, la planification stratégique et la gestion des talents sont restées dans un premier temps des concepts très abstraits. Même Tata Motors et Tata Steel, qui appliquaient déjà la méthode Baldrige, étaient loin de l’avoir intégrée avec succès. En 1995, les résultats des premiers JRD QV Awards, destinés à souligner l’excellence, reflètent de manière criante ces résistances et ces lacunes : le score moyen des 12 entreprises participantes plafonnait à 250 sur 1 000, un chiffre décevant qui n’illustrait pas vraiment l’excellence...
Les agents de changement TQMS : suivez le guide
Devant le peu de soutien apporté au nouveau programme visant la qualité, Ratan Tata réagit et s’efforce de clarifier les enjeux. Au colloque annuel de 1995, il déclare : « Si nous voulons surpasser nos concurrents, nous devons être complètement en phase avec le marché, mieux réagir aux besoins de nos clients, nous montrer bien plus attentifs aux exigences du marché et demeurer centrés sur la qualité de nos produits et services. » Le message est clair. Peu après le colloque, les dirigeants des entreprises Tata réclament l’aide d’une agence de facilitation pour guider la mise en place du programme d’excellence. Ratan Tata et l’équipe dirigeante répondent à cette demande en créant le Tata Quality Management Services (TQMS) en 1996. Sa mission : aider les entreprises du Groupe à atteindre leurs objectifs.
BEBP : un créateur de cohésion
L’année 1998 a marqué un autre tournant décisif dans le développement du projet d’excellence, avec le lancement d’une nouvelle initiative fondée sur l’identité du groupe : Brand Equity and Business Promotion (BEBP). Ce programme prévoit que chaque entreprise désireuse d’utiliser le nom de marque Tata adhère à un ensemble de principes éthiques (exposé dans un Code de conduite) et adopte la méthodologie JRD QV, désormais rebaptisée Tata Business Excellence Model (TBEM). « Pour être une entreprise Tata, il fallait désormais intégrer le modèle d’excellence et atteindre un score minimum pour les critères du TBEM, explique R. Gopalakrishnan. Une dynamique s’est imposée dans les esprits par une vraie valorisation de la marque. »
TSMG : entreprises performantes, gestionnaires conquis
Le Tata Strategic Management Group (TSMG), un pôle interne de 70 consultants créé en 1991, a joué un rôle clé auprès des entreprises du Groupe pour les aider à optimiser leurs performances. « Faire appel à McKinsey à la moindre difficulté nous aurait coûté très cher, remarque R. Gopalakrishnan. Avoir des consultants maison, c’est comme avoir un médecin de famille, toujours disponible en cas de besoin ! » Les consultants travaillent de concert avec chaque organisation pour mettre en évidence ses points faibles et renforcer les processus de planification stratégique. « L’impact a été très positif sur l’adhésion des gestionnaires au processus. Ils ne se sentent pas menacés, mais encouragés », souligne R. Gopalakrishnan.
Initiatives spécifiques : de la gestion des savoirs à la mondialisation
Outre la création de nouvelles entités organisationnelles et la définition de lignes directrices, le projet « Excellence en affaires » a généré plusieurs initiatives à l’échelle du Groupe : institution de mentors pour la formation des évaluateurs (2001), gestion des savoirs pour trouver et promouvoir les meilleures pratiques (2003), gouvernance d’entreprise pour une définition des règles et procédures relatives aux différentes fonctions (2004), programme de mondialisation pour piloter les acquisitions à l’étranger (2005), projets en innovation et en environnement (2007), etc.
De nombreuses entreprises Tata ont aussi lancé leurs propres projets d’optimisation des opérations et des processus. Ces efforts ont généralement été concentrés dans des domaines cruciaux comme le développement de la stratégie, la satisfaction du client, l’efficience opérationnelle et le développement des gestionnaires. Par exemple, Tata Steel a lancé une campagne baptisée « Big Q » pour intégrer et approfondir les notions liées à la qualité, et a ensuite créé une fonction particulière pour la stratégie et son exécution. La direction de Tata Chemicals a mis en place un programme de formation des gestionnaires, «Champions du changement», proposant différents modules : comportemental, fonctionnel, managérial et de leadership.
La réussite en récompense
Le projet « Excellence en affaires » a eu un effet positif sur toute la ligne. Les entreprises Tata sont désormais plus en phase avec les performances, l’intérêt des différents acteurs, la qualité des produits et des services, les problèmes liés à l’environnement, l’expansion géographique et bien d’autres enjeux. D’après R. Gopalakrishnan, les nouvelles méthodes de travail se sont traduites par l’amélioration des résultats financiers, particulièrement pour les sociétés phares du Groupe, qui affichent d’excellentes performances dans le cadre du TBEM. Par exemple, Tata Chemicals est le deuxième producteur mondial de soude ménagère, Tata Motors est le cinquième constructeur mondial de véhicules utilitaires et de tourisme, et Tata Consultancy Services (TCS), la société de services en ingénierie informatique numéro un en Asie.
Les résultats financiers sont éloquents, mais le plus grand apport du TBEM n’est pas quantifiable et n’a pas de prix : une culture plus cohésive, plus dynamique et tournée vers l’extérieur qui se trouve à des années-lumière du climat de complaisance qui régnait au début des années 1990. Rien n’est jamais acquis, conclut R. Gopalakrishnan. « Nous pouvons faire encore mieux. Pour nous, l’excellence est un effort perpétuel, un chemin à emprunter plus qu’une destination à atteindre. ».
1. JRD TATA A ÉTÉ PRÉSIDENT DU GROUPE DE 1938 À 1991. SOUS SA PRÉSIDENCE, TATA A DÉVELOPPÉ UNE RÉPUTATION D’EXCELLENCE EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE ET D’ENGAGEMENT SUR LA QUALITÉ.
2. LA MÉTHODOLOGIE MALCOLM BALDRIGE FAIT RÉFÉRENCE AU PROCESSUS DE SÉLECTION DES LAURÉATS DU MALCOLM BALDRIGE NATIONAL QUALITY AWARD. POUR RECEVOIR CE PRIX, UNE ORGANISATION DOIT FAIRE MONTRE D’UN SYSTÈME DE GESTION ORGANISATIONNELLE EXEMPLAIRE QUI SOIT À MÊME DE GARANTIR UNE AMÉLIORATION CONTINUELLE DES PRODUITS OU SERVICES PROPOSÉS, DES PROCESSUS EFFICACES ET PERFORMANTS, ET UNE GESTION INTERACTIVE ET ENGAGÉE DE LA RELATION CLIENT ET DES RELATIONS EXTERNES.