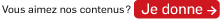Un bouchon de circulation (source photo: 123RF)
ANALYSE GÉOPOLITIQUE – Les rapports les confirment les uns après les autres: malgré nos efforts collectifs depuis des années, les émissions de gaz à serre (GES) continuent d’augmenter sur la Terre. Si la tendance se maintient, nous nous dirigeons vers un réchauffement planétaire d’environ 3,2 degrés Celcius d’ici la fin de ce siècle.
La transition écologique, parsemée de «mesures réalistes», pour reprendre l’expression de plusieurs décideurs politiques et économiques, est insuffisante dans l’état actuel.
Un changement de cap radical de notre mode de vie et de production s’impose donc afin d'éviter le pire pour l'environnement et l'économie (500 milliards de dollars américains par année aux États-Unis seulement dans les années 2090, selon un rapport du National Climat Assessment), disent les spécialistes.
C’est ce que révèle l’Emission Gap Report 2018, présenté le 27 novembre par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), à partir des plus récentes données rassemblées par une équipe internationale de scientifiques.
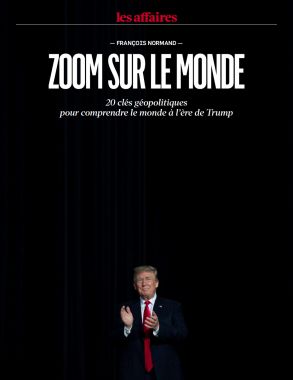
Leur objectif : concrétiser les directives de l’Accord de Paris sur le climat afin de limiter le réchauffement de la planète sous la barre des 2 degrés par rapport au début de l’ère industrielle au 19e siècle.
Et dans le meilleur des mondes, il faut limiter la hausse à 1,5 degré afin de «réduire largement les risques et les conséquences du changement climatique».
Or, la Terre s’est déjà réchauffée d’environ 1 degré depuis le 19e siècle, ce qui laisse peu de marge de manoeuvre à l’humanité.
Des conditions de vie difficiles
Le réchauffement climatique ne signifie pas la fin du monde.
En revanche, cela signifie que les conditions de vie des humains (et, du reste, des autres espèces) seront de plus en plus difficiles, surtout dans les régions près de l’équateur et dans les pays émergents ou en voie de développement.
Cela dit, la hausse du niveau des océans affectera aussi les pays développés et des villes côtières comme Vancouver, New York ou Stockholm, sans parler des régions comme la Gaspésie ou les Îles-de-la-Madeleine.
Sur le plan politique, il faut aussi s’attendre à deux grandes perturbations, selon un rapport du ministère américain de la Défense :
- Une augmentation de l’instabilité politique dans le monde.
- Une hausse du risque de conflits, notamment en raison des sécheresses et des migrations de réfugiés climatiques.
Dans ce contexte, on comprend pourquoi le changement climatique représente à terme le risque le plus important – davantage que les risques financiers, économiques ou réglementaires – pour des investisseurs institutionnels actifs aux quatre coins du monde.
Comment atteindre nos cibles de GES
La difficulté à stabiliser puis à réduire les émissions de GES n’est pas technologique.
Par exemple, les coûts de l’énergie solaire ont chuté de 78% depuis 2010, rendant cette source d’énergie très compétitive par rapport aux carburants fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel), rapporte le Washington Post.
Sur la même période, les coûts de l’énergie éolienne ont diminué de près de 25%.
À vrai dire, la difficulté est avant tout politique : il manque une réelle volonté politique des élus (qui veulent se faire élire ou réélire) pour imposer les efforts, voire les sacrifices, qui s’imposent afin de fixer et de faire respecter des cibles de réduction très ambitieuses.
C’est pourquoi un nombre grandissant d’analystes proposent que l’on retire des mains des politiciens la gestion de la lutte au changement climatique, pour la confier à des agences publiques indépendantes.
Des spécialistes comme François Delorme, qui enseigne l’économie de l’environnement à l’Université de Sherbrooke, proposent qu’on s’inspire de la Banque du Canada, une institution publique fédérale.
Ottawa nomme le gouverneur de la banque, mais il est indépendant par la suite pour assumer sa responsabilité de stabiliser les prix (dans l’économie) avec la politique monétaire.
Les gouvernements pourraient aussi nommer les dirigeants de ces agences du climat indépendantes. Par contre, par la suite, celles-ci pourraient prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la stabilité du climat.
Par exemple, elle pourrait augmenter les taxes sur le carbone pour limiter la hausse des émissions de GES, comme la Banque du Canada augmente son taux directeur pour limiter la hausse de l’inflation.
Un plafonnement de la consommation des ressources
Mais pour certains spécialistes, des taxes élevées sur la pollution et des innovations technologiques aideront, mais elles ne suffiront pas à limiter les émissions de GES, qui sont liées à la consommation de ressources naturelles (plus on consomme de ressources, plus on émet de GES).
Par exemple, l’économiste Daniel O’Neill, de l’University of Leeds au Royaume-Uni, affirme que la seule stratégie pour éviter une surconsommation de ressources naturelles est d’imposer des limites strictes à leur utilisation.
Comment ? Des traités ou des gouvernements imposeraient ces plafonds annuels. Toutefois, faire respecter ces quotas serait très complexe, sans parler de la résistance probable dans les pays émergents, grands consommateurs de ressources naturelles.
La lutte pour limiter le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés par rapport au début de l’ère industrielle n’est pas perdue, mais il se fait tard, très tard même, affirment les spécialistes.
Surtout, le temps des demi-mesures est révolu. La situation requiert des mesures beaucoup plus musclées pour réduire les émissions des gouvernements, des entreprises et des particuliers.
Si une transition vers une économie verte en douceur était possible encore il y a une dizaine d’années, la fenêtre est maintenant fermée.
C’est pourquoi il faut une révolution verte.