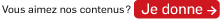Le capitalisme est menacé. On a perdu confiance dans le monde des affaires, et les décideurs politiques adoptent des mesures qui minent la croissance économique. Pour sortir de ce cercle vicieux, les entreprises doivent repenser leur rôle et créer de la valeur partagée.
Auteurs : Michael E. Porter et Mark R. Kramer, Harvard Business Review
Depuis quelques années, le monde des affaires est vu comme l’une des principales causes des problèmes sociaux, environnementaux et économiques. Et, selon une idée largement répandue, les entreprises se développeraient aux dépens de la communauté.
Ce n’est pas tout. Plus les entreprises ont adhéré à l’idée qu’elles ont une responsabilité sociale, plus on les a blâmées pour les échecs de la société. Jamais, dans l’histoire récente, le bien-fondé de leur façon d’agir n’a été autant débattu. Et cette perte de confiance amène les décideurs politiques à adopter des mesures qui nuisent à la compétitivité et à la croissance économique. Le monde des affaires est tombé dans un cercle vicieux.###
Les entreprises sont responsables en grande partie de cette situation, parce qu’elles se sont cantonnées, au cours des dernières décennies, dans une théorie aujourd’hui dépassée de la création de la valeur. En interprétant cette notion de façon étroite, elles ont obstinément cherché à maximiser leurs performances financières à court terme, sans égard aux besoins les plus élémentaires des consommateurs ni aux facteurs propres à contribuer à leur propre succès à long terme. C’est ce qui explique que les entreprises négligent à ce point la satisfaction de leur clientèle, la raréfaction des ressources naturelles, la solidité de leurs principaux fournisseurs et le désarroi, face aux problèmes économiques des collectivités qui les font vivre et dont elles sont parties prenantes. Si ce n’était pas le cas, elles ne verraient pas, par exemple, la délocalisation dans des pays où les salaires sont inférieurs comme la seule solution durable pour assurer leur compétitivité.
Pour réconcilier le monde des affaires et la société, les entreprises doivent réagir ; les entreprises de pointe et les leaders les plus éclairés le savent bien, et des indices laissent d’ailleurs penser qu’un nouveau modèle est en train d’émerger. Mais il faudrait un cadre général pour mieux orienter les efforts qui se font en ce sens, puisque, dans la plupart des entreprises, on comprend encore la responsabilité sociale comme une notion dont les composantes sont périphériques plutôt que centrales.
En fait, ce cadre général doit s’appuyer sur le principe de la valeur partagée, qui permet non seulement de créer de la valeur économique, mais aussi de la valeur qui peut profiter à la société tout entière, en répondant à ses besoins et en lui permettant de relever les défis qu’elle affronte. La valeur partagée n’est pas extérieure à l’activité des entreprises, elle en fait partie intégrante. Mais il ne faut pas confondre valeur partagée et responsabilité sociale, philanthropie ou développement durable : la valeur partagée est une nouvelle façon d’assurer le succès des entreprises. C’est pourquoi ces dernières doivent recréer un lien entre réussite économique et progrès social. Nous croyons que ce principe peut mener les entreprises à une toute nouvelle façon de concevoir leurs activités.
De plus en plus d’entreprises — GE, Google, IBM, Intel, Johnson & Johnson, Nestlé, Unilever et Wal-Mart, par exemple —, qui ne sont pourtant pas connues pour faire du sentiment, ont adopté le principe de la valeur partagée et travaillent à modifier le rapport entre leurs performances et les besoins de la société. Et nous commençons tout juste à entrevoir le réel pouvoir de cette approche. Sans compter que, pour que celle-ci puisse être largement mise en œuvre, il faut que les dirigeants d’entreprise acquièrent de nouvelles compétences : une vision plus précise des besoins sociétaux, une meilleure compréhension des bases véritables de la productivité et la capacité de travailler hors du cadre de la rentabilité à tout prix, par exemple.
Le capitalisme reste un système incomparable pour satisfaire les besoins de l’humanité de façon toujours plus efficace ainsi que pour créer de l’emploi et de la richesse, mais une conception étroite de ce système a bien souvent empêché les entreprises d’exploiter leur plein potentiel et de contribuer à relever les grands défis auxquels la société fait face. Les occasions n’ont pourtant pas manqué, mais on ne les a pas saisies. Parce que c’est en se comportant comme des organisations dont l’Objectif est le profit — et non comme des œuvres de bienfaisance — que les entreprises constituent la plus grande force susceptible de résoudre les problèmes urgents de nos sociétés. Le moment est donc venu de repenser le capitalisme, car les besoins sont de plus en plus nombreux. En outre, les consommateurs et les travailleurs — en particulier ceux des nouvelles générations — demandent aux entreprises de faire leur part.
Les entreprises doivent redéfinir leur rôle, ce qui signifie créer de la valeur partagée et pas seulement du profit. C’est ce qui permettra de lancer une nouvelle vague d’innovation et de productivité dans l’économie mondiale, et de remodeler le capitalisme. Et c’est ainsi que les entreprises retrouveront leur légitimité, passablement malmenée depuis un certain temps.
Finis les compromis !
Voilà trop longtemps que le monde des affaires et la société s’affrontent. La faute en revient, en partie, aux économistes qui ont défendu l’idée que, pour être profitables à l’ensemble de la société, les entreprises devaient tempérer leurs ardeurs économiques. Selon la théorie néoclassique, tout progrès social (une meilleure sécurité ou des emplois pour les personnes handicapées, par exemple) constitue une contrainte pour les entreprises, qui se traduit inévitablement par une augmentation des coûts et une réduction des bénéfices.
Le concept d’externalités, une notion connexe, mène à la même conclusion. On parle d’ex¬ternalités quand une entreprise engendre un coût social (la pollution, par exemple). L’une des conséquences — et c’est une croyance à l’origine de nombreuses décisions gouvernementales — est que, face à ce phénomène, la société se doit d’adopter des normes et d’imposer les entreprises (et à la limite, de les condamner à des amendes) pour que celles-ci « internalisent » ces externalités.
C’est cette même croyance qui marque les stratégies de la plupart des entreprises, qui négligent généralement les considérations sociales ou environnementales qui influencent pourtant leurs activités et l’économie en général. Parce que les entreprises considèrent leur existence et leurs activités comme des réalités incontestables, elles voient toute tentative de régulation comme étant contraire à leurs intérêts — la résolution des problèmes de société incombant, selon elles, aux gouvernements et aux organisations non gouvernementales (ONG). Et quand, en réaction à la pression extérieure, elles en viennent à accepter une partie de cette responsabilité — et à la voir comme une source inévitable de dépenses —, ce n’est en général que dans le but de soigner leur image de marque (toute autre raison entraînant une utilisation irresponsable de l’argent des actionnaires). Les gouvernements, de leur côté, adoptent souvent des politiques qui rendent difficile la création de valeur partagée. Bref, chacune des parties considère l’autre comme un obstacle sur son chemin et agit en conséquence.
Ce sont les besoins sociétaux, et pas seulement les besoins économiques au sens traditionnel du terme, qui définissent les marchés, et le concept de valeur partagée tient compte de cette réalité. Il prend aussi en considération, par ailleurs, que les torts causés à la société ou certaines failles dans son fonctionnement (le gaspillage d’énergie ou de ressources, les accidents, le besoin de pallier le manque de scolarité par de la formation) entraînent souvent des coûts internes pour les entreprises. Enfin, adopter le principe de valeur partagée, c’est comprendre que le risque de causer des préjudices à la société et les contraintes qui en résultent ne signifient pas inévitablement une hausse des coûts : ils se présentent plutôt comme une occasion d’innover, en ayant recours à de nouvelles technologies ou à de nouvelles méthodes d’exploitation et de gestion, pour augmenter la productivité et les parts de marché.
La valeur partagée n’a donc rien à voir avec des préférences individuelles, ni avec une volonté de « partager » (ou de redistribuer) la valeur que produisent les entreprises. Créer de la valeur partagée, c’est faire profiter un plus grand nombre de la valeur sociale et économique ainsi produite. Prenons l’exemple du commerce équitable : l’objectif est dans ce cas d’accroître la proportion des revenus qui reviennent à des producteurs pauvres, en leur donnant un meilleur prix pour leur récolte. L’intention est louable, mais il n’en reste pas moins que le commerce équitable est avant tout une redistribution de la valeur ainsi créée et qu’il n’entraîne aucunement la création de plus de valeur. Quand on adopte la perspective du partage de la valeur, on cherche plutôt à améliorer les techniques de culture, à renforcer l’ensemble des fournisseurs et des intervenants locaux, afin de permettre aux producteurs d’améliorer leur efficacité, leur rendement, ainsi que la qualité et la durabilité de leurs produits. Il en résulte un accroissement des revenus et des bénéfices, qui profite tant aux producteurs qu’aux entreprises avec lesquelles ils font affaire. Des études récentes réalisées auprès de producteurs de cacao de la Côte d’Ivoire indiquent que si le commerce équitable peut accroître les revenus des producteurs de 10 % à 20 %, ces chiffres grimpent à plus de 300 % quand on adopte plutôt l’approche de la valeur partagée.
Les origines de la valeur partagée
La compétitivité des entreprises et la vitalité des régions où elles s’installent sont étroitement liées. D’une part, le succès des entreprises dépend de la « santé » de la région, puisqu’il faut qu’il existe une demande pour leurs produits, mais aussi parce qu’elles ont besoin de suffisamment d’infrastructures pour créer un environnement propice à leurs activités. D’autre part, les régions ont besoin d’entreprises florissantes, qui créent de l’emploi et de la richesse pour les citoyens. Étant donné cette interdépendance, les politiques publiques qui affaiblissent la productivité ou la compétitivité des entre¬prises sont donc nuisibles — surtout dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, où l’on peut facilement délocaliser des installations, et donc des emplois. Il va sans dire que cela ne fait pas toujours l’affaire des gouvernements et des ONG.
Selon une lecture étroite et éculée de la notion de capitalisme, les entreprises contribuent au bien-être des citoyens en faisant des profits grâce auxquels elles créent des emplois, paient des salaires, font des achats et des investissements et paient de l’impôt. Tout ce qui touche au social ou au communautaire n’est pas considéré comme étant de leur ressort.
Cette conception influence la pensée entrepreneuriale depuis deux décennies. La préoccupation première des entreprises est de vendre leurs produits et services à un nombre toujours plus grand de consommateurs. La compétition féroce et les pressions exercées par les actionnaires pour améliorer les performances à court terme ont conduit les dirigeants à restructurer leurs entreprises, à supprimer des emplois, voire à déménager leurs installations là où les salaires étaient moins élevés. Les investisseurs ont ainsi accumulé des capitaux. Dans la plupart des cas, cela s’est soldé par une marchandisation à tout crin, une concurrence des prix, peu de véritable innovation, une croissance interne lente et un manque d’avantage compétitif réel.
Même quand les profits augmentent, les communautés tirent peu de bénéfices de ce genre de compétition. Les citoyens ont même l’impression que c’est à leurs dépens que les entreprises engrangent les profits, un sentiment qui s’est intensifié avec la reprise économique actuelle, puisque l’augmentation des profits n’a réduit ni le chômage, ni les difficultés des petites entreprises, ni les pressions énormes qui s’exercent sur les services publics.
Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi. À une certaine époque, les meilleures entreprises acceptaient de jouer des rôles multiples afin de satisfaire les besoins des travailleurs, des communautés et des entreprises avec lesquelles elles faisaient affaire. L’intégration verticale des entre¬prises a entraîné une plus grande dépendance face aux fournisseurs externes, et l’approvisionnement à l’étranger ainsi que les délocalisations ont affaibli le lien entre les entreprises et la communauté. En fait, à force de délocaliser, les entreprises ont perdu tout contact avec ce qui était leur environnement immédiat au départ. Ce n’est pas un hasard si la plupart d’entre elles se disent maintenant « mondiales ».
Il est vrai que ces transformations ont conduit à de grands progrès en ce qui a trait à l’efficacité économique ; mais d’importantes occasions de créer de la valeur ont été gaspillées, et quelque chose de plus capital encore a été perdu : la réflexion stratégique s’est vidée de son sens.
En cherchant à mieux comprendre l’environnement dans lequel se situent leurs entreprises, les dirigeants ont porté l’essentiel de leur attention sur leur domaine d’activité. La structure d’une industrie a bien sûr un effet décisif sur la rentabilité des entreprises qui en font partie, mais l’endroit où les entreprises choisissent de s’installer a également un effet déterminant sur la productivité et l’innovation, et c’est là un élément que les dirigeants ont souvent négligé.
Comment créer de la valeur partagée
Les entreprises peuvent créer de la valeur économique tout en créant de la valeur qui profitera à la société, et ce, de trois façons : en repensant leurs produits et leurs marchés, en redéfinissant la productivité dans la chaîne de valeur et en créant des pôles de développement là où l’entreprise est installée. Ces trois éléments forment le « cercle vertueux » de la valeur partagée : augmenter la valeur de l’un crée des occasions de le faire aussi pour les deux autres.
Le concept de valeur partagée redéfinit les frontières du capitalisme. Établir une corrélation entre la réussite des entreprises et le progrès social, c’est trouver de multiples façons de satisfaire des besoins nouveaux, d’accroître l’efficacité, de permettre la différenciation et d’étendre les marchés.
Créer de la valeur partagée est possible autant dans les pays en voie de développement que dans les pays développés — seules les occasions qui permettent de le faire sont différentes. Et si ces occasions varient aussi en fonction des secteurs d’activité, toutes les entreprises peuvent en profiter.
Repenser les produits et les marchés
Santé, logement, alimentation, soutien aux aînés, sécurité financière, protection de l’environnement : les besoins sociétaux sont immenses, et, dans l’économie mondialisée d’aujour¬d’hui, ce sont peut-être ceux auxquels on répond le moins. Pendant des décennies, les entreprises ont analysé la demande et les façons d’y répondre en oubliant une question fondamentale : tel produit ou service est-il vraiment avantageux pour nos clients ou pour les clients de nos clients ?
Dans les pays développés, la demande de produits et services susceptibles de répondre aux besoins sociétaux augmente rapidement. Par exemple, les entreprises alimentaires qui, pour faire grimper leurs ventes, se préoccupaient d’abord, jusqu’à présent, de facteurs comme le goût et la quantité cherchent maintenant plutôt à satisfaire des besoins liés à une saine alimentation. Intel et IBM créent des outils numériques qui permettront aux entreprises de services publics d’économiser de l’électricité. Wells Fargo a conçu des services et des outils pour aider ses clients à faire un budget, à gérer leur crédit ou à réduire leur dette. La vente des produits Ecomagination de GE a atteint 18 milliards de dollars en 2009 (soit la valeur d’une entreprise classée dans le Fortune 500) ; et, au cours des cinq prochaines années, GE prévoit que les revenus générés par la vente de ces produits croîtront deux fois plus vite que les revenus totaux de l’entreprise.
Ces réussites ouvrent de nouvelles voies pour innover et créer de la valeur partagée. La société en profitera, car il y a fort à parier que les entreprises privées feront un marketing plus efficace que celui des gouvernements et des ONG, marketing qui incitera les consommateurs à adopter des produits et services ayant des retombées sociales, comme les aliments santé ou les pro¬duits écologiques.
Dans les régions désavantagées et les pays en voie de développement, les occasions qui s’offrent aux entreprises sont tout aussi prometteuses, voire meilleures, parce que, si les besoins sont plus nombreux ou plus importants, ces régions ou ces pays sont souvent considérés comme des marchés non viables. Aujourd’hui, tous les regards se tournent vers l’Inde, la Chine et, de plus en plus, le Brésil, des pays (la « base de la pyramide », selon C. K. Prahalad) qui représentent des milliards de clients potentiels. Pourtant, les besoins y ont toujours été énormes, comme dans plusieurs autres pays en voie de développement.
La situation est la même dans certaines régions des pays développés, comme certains quartiers pauvres des États-Unis, par exemple : l’importance relative du pouvoir d’achat de leurs habitants est ignorée.
Vendre des produits et services appropriés aux citoyens défavorisés peut produire des avantages importants pour l’ensemble de la société tout en procurant des profits substantiels aux entreprises. Prenons l’exemple des services de téléphonie cellulaire à prix modique : en donnant accès à des services bancaires à distance, ils permettent aux habitants des pays les plus pauvres d’épargner en toute sécurité, et aident les fermiers à produire et à mettre en marché ce qu’ils cultivent. Le service bancaire mobile M-PESA, de Vodafone, s’est assuré une dizaine de millions de clients au Kenya depuis trois ans et gère maintenant un actif qui correspond à 11 % du produit intérieur brut du pays. Thompson Reuters offre en Inde un service très prometteur à des agriculteurs qui gagnent en moyenne 2 000 $ par an : pour cinq dollars par trimestre, les clients ont accès à des bulletins météo, à de l’information sur les cours des produits agricoles et à des conseils personnalisés. On estime le nombre d’abonnés à deux millions, et des recherches indiquent que le service a permis d’accroître leurs revenus dans plus de 60 % des cas (certains auraient même triplé leurs gains). Quand les entrepreneurs s’intéressent aux communautés les plus pauvres, les occasions de développe¬ment et de progrès social croissent de façon exponentielle.
Pour créer ce type de valeur ajoutée, les entreprises doivent commencer par définir les besoins sociétaux, puis évaluer les bénéfices et les préjudices que peuvent entraîner leurs produits. Les occasions d’affaires ne sont pas statiques, elles changent constamment, au fur et à mesure que les technologies évoluent, que les économies se développent et que les priorités sociétales changent. C’est par un questionnement constant sur les besoins de la société que les entreprises peuvent trouver des moyens de se démarquer, de se repositionner sur des marchés traditionnels et de saisir le potentiel d’autres marchés qu’elles avaient jusque-là négligés.
Combler des besoins sur des marchés mal desservis exige souvent un réexamen des produits et services offerts ainsi que des méthodes de distribution, mais cet exercice donne parfois lieu à des innovations majeures qui trouvent aussi des applications sur les marchés traditionnels. La microfinance, par exemple, conçue au départ pour pallier les difficultés de financement dans les pays en voie de développement, est de plus en plus courante aux États-Unis, où elle comble un besoin auparavant insatisfait.
Redéfinir la chaîne de valeur
Inévitablement, la chaîne de valeur des entreprises a une incidence sur de nombreuses questions de société (utilisation de l’eau et des ressources naturelles, santé et sécurité, conditions de travail, équité sur le marché de l’emploi). Inversement, les entreprises sont nécessairement touchées par les questions sociétales. Les occasions de créer de la valeur partagée se présentent quand des questions de société entraînent un coût économique dans la chaîne de valeur d’une entreprise. De nombreuses prétendues externalités engendrent des coûts internes, même en l’absence de régulation ou d’imposition des ressources. Le sur¬emballage ou les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, coûtent cher aux entreprises comme à la société. Wal-Mart a épargné 200 millions de dollars en 2009 en limitant ses emballages et en réduisant de 180 000 kilomètres la distance parcourue par ses camions, qui ont pourtant transporté plus de marchandises. De la même façon, de meilleurs systèmes de recyclage des plastiques, dans ses magasins, lui permettent d’économiser des millions, puisque moins de déchets sont envoyés dans des dépotoirs.
Ces nouvelles façons de penser démontrent que la corrélation entre progrès social et productivité, dans la chaîne de valeur, est bien plus forte qu’on ne le croyait. Et, quand les entreprises abordent, dans une perspective de valeur partagée, des questions de société et que, pour tenter de les résoudre, elles innovent, cette synergie fonctionne à son plein rendement. Pour l’instant, toutefois, seules quelques entreprises ont récolté les fruits de cette approche, dans les domaines de la santé, de la sécurité financière, de la protection de l’environnement, de la rétention ou de la compétence du personnel.
Certains indices ne trompent pas. Un changement s’est indiscutablement amorcé. On a longtemps cru que tout effort de réduction de la pollution — dicté par des règlements ou des impôts — se traduisait nécessairement par une hausse des coûts. Or, on sait aujourd’hui que les entreprises peuvent souvent améliorer leurs performances environnementales grâce à des technologies, et à un coût différentiel minime ; une meilleure utilisation d’une ressource, des processus plus efficaces et une qualité accrue peuvent même signifier une réduction des coûts nets.
Une meilleure compréhension des mécanismes de la productivité et une connaissance plus grande des conséquences de l’objectif de réduction à tout prix des coûts à court terme (réduction qui, étant donné la fausseté du raisonnement en cause, se solde souvent par une productivité moindre ou peu durable) ont donc permis de concevoir de nouvelles approches, qui permettent de transformer la chaîne de valeur pour créer de la valeur partagée. Nous vous en présentons ici quelques-unes, parmi les plus importantes. Ces divers moyens sont interdépendants, et se renforcent mutuellement. Les efforts réalisés en cette ma¬tière sont encore en pleine évolution, et leurs véritables effets ne se feront sentir que dans les années à venir.
La consommation d’énergie et la gestion de la logistique. Tout au long de la chaîne de valeur — dans les processus, le transport, la gestion des biens immobiliers, la chaîne d’approvisionnement, les circuits de distribution ou les services administratifs —, on doit aujourd’hui revoir notre utilisation de l’énergie. Cet exercice a été rendu nécessaire par la flambée des prix de l’énergie, et soutenu par la prise de conscience des bénéfices liés à l’efficacité énergétique. Et il a commencé bien avant que l’émission de gaz à effet de serre ne devienne une préoccupation planétaire. Il a donné lieu à des progrès remarquables dans l’utilisation de l’énergie, grâce, entre autres, à une meilleure utilisation de la technologie, du recyclage et de la cogénération. Toutes ces pratiques créent de la valeur partagée.
Nous savons maintenant que le transport est coûteux, non seulement en raison des coûts de l’énergie, mais également parce qu’il implique du temps, des procédures complexes, des coûts de stockage et des coûts administratifs. Il faut repenser la logistique, afin de réduire entre autres les distances à parcourir, la manutention nécessaire et le kilométrage des véhicules, et ainsi créer de la valeur partagée. La chaîne britannique Marks & Spencer’s a fait des changements d’envergure dans son processus d’approvisionnement (en évitant, par exemple, le transport de marchandises entre les deux hémisphères) qui devraient lui permettre d’économiser 175 millions de livres par an d’ici la fin de l’année fiscale 2016, en plus de réduire considérablement ses émissions de CO2.
L’utilisation des ressources. La conscientisation sur le plan environnemental et les progrès technologiques ont permis de définir de nouvelles pratiques en ce qui a trait à l’utilisation de l’eau, des matières premières et de l’emballage, et de généraliser le recyclage et la réutilisation. Ces nouvelles approches peuvent s’appliquer à tous les types de ressources, et pas seulement à celles dont parlent constamment les environnementalistes. Une meilleure utilisation des ressources, grâce à de nouvelles technologiques, a des répercussions à tous les niveaux de la chaîne de valeur, et peut même avoir une influence sur les fournisseurs et sur les distributeurs. Grâce à cet effet d’entraînement, les dépotoirs et les sites d’enfouissement se rempliraient d’ailleurs sûrement moins vite.
Coca-Cola a déjà réduit sa consommation mondiale d’eau de 9 % (par rapport à 2004), soit presque la moitié de l’objectif de 20 % qu’elle s’est fixé pour 2012. Les plus importantes usines de Dow Chemicals ont diminué leur consommation d’eau douce de près de trois milliards de litres (ce qui équivaut à la quantité d’eau nécessaire chaque année à 40 000 personnes aux États-Unis) et réalisé ainsi une économie de 4 millions de dollars. Et, grâce à la forte demande dans le domaine de l’optimisation de la consommation d’eau, l’entreprise indienne Jain Irrigation, chef de file mondial de la production de systèmes d’irrigation goutte à goutte, a vu ses revenus croître à un taux annuel composé de41 % au cours des cinq dernières années.
L’approvisionnement. En matière d’approvisionnement, la banalisation des produits et l’utilisation du plus grand pouvoir de négociation pour faire baisser les prix des fournisseurs — y compris quand il s’agit de petites entreprises ou de petits producteurs — ont toujours été des approches largement utilisées. Et, avec le temps, de plus en plus d’entreprises ont aussi décidé de faire affaire avec des fournisseurs étrangers, dans des pays où les salaires sont bas.
Cependant, certaines entreprises commencent à comprendre qu’un fournisseur sous-utilisé ne peut pas rester productif ni assurer (et encore moins améliorer) la qualité de ses produits. En favorisant l’accès aux ressources, en partageant les technologies et en procurant du financement, les entreprises peuvent agir sur la qualité des produits et sur la productivité de leurs fournisseurs, et même s’assurer un approvisionnement accru. L’amélioration de la productivité a souvent plus d’effets que les bas prix. Quand des fournisseurs ont de meilleurs moyens, leur incidence sur l’environnement est moindre, ce qui améliore d’autant plus leur efficacité. De la valeur partagée est ainsi créée.
Un bon exemple de cette approche est Nespresso, l’une des divisions les plus florissantes de Nestlé, dont le chiffre d’affaires a bondi de 30 % depuis 2000. Le concept Nespresso, c’est une cafetière à expresso perfectionnée qui fonctionne avec des capsules individuelles contenant différents types de café moulu venant des quatre coins du globe. En misant sur la qualité et la facilité d’utilisation, Nespresso a révolutionné le marché du café haut de gamme.
Mais trouver des sources d’approvisionnement fiables en café de qualité n’est pas facile. La plupart des fournisseurs sont des producteurs installés dans des régions rurales pauvres d’Afrique et d’Amérique latine, prisonniers d’un système marqué par la faible productivité, la piètre qualité et une dégradation de l’environnement qui limitent le volume de production. Pour sortir de ce cercle, Nestlé a tout simplement repensé son approvisionnement et travaillé avec les producteurs: elle leur a donné des conseils pour améliorer leur culture, leur a garanti des prêts et leur a assuré un accès aux ressources nécessaires (plants, pesticides, fertilisants). De plus, Nestlé a construit des installations chez ses fournisseurs, pour contrôler la qualité du café sur les lieux ; l’entreprise paie aussi plus cher les grains de bonne qualité, ce qui a pour effet d’accroître la motivation des producteurs. Grâce à l’augmentation du rendement par hectare et à l’amélioration de la qualité, les revenus des producteurs ont augmenté et leur incidence environnementale a diminué. Et Nestlé, de son côté, s’est assuré un plus grand volume de café de qualité. De la valeur partagée a ainsi été créée.
Plus généralement, l’exemple de Nestlé met en lumière l’avantage d’acheter localement, chez des fournisseurs performants. Au contraire, choisir de s’approvisionner ailleurs simplement parce que les salaires y sont plus bas et les ressources plus abordables finit par entraîner des coûts d’opération plus élevés et des pertes d’efficacité qui annulent tout le bénéfice escompté.
La distribution. Des entreprises ont déjà commencé à s’intéresser à la distribution sous l’angle de la valeur partagée. On a aussi créé de nouveaux modèles de distribution rentables qui réduisent considérablement l’usage du papier et du plastique — pensons aux iTunes, Kindle et Google Scholar (un moteur de recherche en ligne, spécialisé en littérature scientifique), par exemple.
Sur les marchés non traditionnels, les possibilités de créer de nouveaux modèles de distribution sont plus grandes encore. En Inde, Hindustan Unilever a mis en place un nouveau système de distribution, appelé Project Shakti, qui est géré par des femmes défavorisées et permet la livraison de produits d’hygiène dans les foyers de villages de moins de 2 000 habitants. Grâce au microcrédit et à la formation, l’entreprise a réussi à recruter quelque 45 000 femmes entrepreneures, dans 100 000 villages de 15 États indiens.
En formant ces femmes — qui, grâce à leur nouvel emploi, peuvent parfois doubler le revenu familial —, mais aussi en donnant accès, à une plus grande partie de la population, à des produits qui peuvent limiter la propagation de maladies, ce nouveau système de distribution profite aux communautés locales et à l’ensemble de la société. C’est un bon exemple de ce que peuvent faire les entreprises sur ce plan. Project Shakti, qui représente aujourd’hui 5 % du revenu total d’Unilever en Inde, a permis à l’entreprise de consolider sa marque dans des régions rurales où l’information en matière de santé est rare, et lui a ainsi ajouté de la valeur économique.
La productivité des employés. Jusqu’à maintenant, beaucoup d’entreprises, pour se développer, ont misé sur la réduction des salaires et des avantages sociaux ainsi que sur la délocalisation ; cela nous fait aujourd’hui mieux comprendre, a contrario, les effets que des salaires décents, une meilleure sécurité d’emploi, le bien-être accru des employés, la formation du personnel et des possibilités d’avancement peuvent avoir sur la productivité. De nombreuses entreprises ont cherché à réduire (voire à éliminer) le coût des régimes d’assurance collective jugé trop élevé. Mais d’autres (et non les moindres) ont réalisé que l’absentéisme, la perte de productivité et la mauvaise santé des employés sont plus coûteux encore. Prenons l’exemple de Johnson & Johnson. En aidant ses employés à arrêter de fumer (deux tiers des employés y sont parvenus au cours des 15 dernières années) et en mettant en œuvre de nombreux programmes de mieux-être, l’entreprise a réalisé une économie de 250 millions de dollars (2,71 $ par dollar investi dans ces programmes, de 2002 à 2008). En outre, elle a pu réduire l’absentéisme et accroître la productivité de ses travailleurs. Si les syndicats se préoccupaient de la valeur partagée, ce type d’approche se généraliserait encore plus rapidement.
L’emplacement des installations. Pour la plupart des chefs d’entreprise, la situation géographique des installations de production n’est en rien un problème, puisque la logistique est peu coûteuse, que l’information circule rapidement et que les marchés sont aujourd’hui mondialisés. Par conséquent, selon eux, il faut chercher à s’installer là où cela coûte le moins cher possible.
Mais cette simplification à outrance est aujourd’hui remise en question, en partie en raison du coût de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi parce que l’on prend de plus en plus conscience du fait que se disperser un peu partout sur la planète et s’approvisionner dans des régions éloignées a — on l’a vu plus tôt — des répercussions sur la productivité. Chez Wal-Mart, par exemple, on fait de plus en plus affaire avec des petits producteurs de fruits et légumes qui sont à proximité des entrepôts de l’entreprise, parce qu’on s’est aperçu que les économies réalisées sur le transport et la possibilité de commander de petites quantités compensent largement les prix moindres pratiqués par des fermes industrielles plus éloignées. Nestlé, on l’a vu, installe des usines de petite taille à proximité de ses marchés et intensifie ses efforts pour maximiser l’utilisation de matières premières locales.
On comprend aussi de mieux en mieux que la délocalisation dans les pays en voie de développement est un mauvais calcul. Olam International, un chef de file dans le domaine des noix de cajou, transformait autrefois les noix, récoltées en Afrique, dans des usines d’Asie où la main-d’œuvre, peu coûteuse, est très productive. Mais, en ouvrant plutôt des usines en Tanzanie, au Mozambique, au Nigeria et en Côte d’Ivoire, et en formant des travailleurs sur place, Olam a réduit ses coûts de transformation et de transport de 25 % — en plus de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. L’entreprise a aussi établi de solides liens avec les agriculteurs de ces régions, et créé quelque 17 000 emplois directs (occupés à 95 % par des femmes) et à peu près autant d’emplois indirects dans des zones rurales où le chômage était endémique.
Ces exemples en sont la preuve : repenser la chaîne de valeur sous l’angle de la valeur partagée, c’est encourager l’innovation et produire une valeur économique que la plupart des entreprises n’avaient jamais encore envisagée.
Créer des pôles de développement
Aucune entreprise ne peut fonctionner en autarcie. Chacune dépend d’autres entreprises sans lesquelles elle ne pourrait exercer ses activités, ainsi que des infrastructures de la région où elle est installée. La productivité et l’innovation sont fortement tributaires de l’existence de pôles de développement (ou grappes industrielles), c’est-à-dire de concentrations géographiques d’entreprises, de fournisseurs de biens et de services ainsi que d’infrastructures logistiques, dans un domaine donné — par exemple, les technologies de l’information (Silicon Valley), les fleurs coupées (Kenya) ou la taille des diamants (Surat, en Inde).
Ces pôles de développement comportent aussi des lieux de formation, des associations professionnelles et des organismes de normalisation. Enfin, leur existence dépend plus largement d’institutions, de services et de politiques publiques (écoles, collèges et universités, approvisionnement en eau, concurrence loyale, normes de qualité, transparence des marchés).
On trouve des pôles de développement dans toutes les économies régionales en plein essor ; ils jouent un rôle essentiel sur le plan de la productivité, de l’innovation et, bien sûr, de la compétitivité. Comme nous l’avons vu, la présence de fournisseurs locaux a un effet positif sur la logistique et favorise une meilleure collaboration entre les divers acteurs dans un domaine donné. L’accès à de la formation et à des moyens de transport ainsi que l’installation d’industries connexes à proximité stimulent également la productivité ; à l’inverse, l’absence de ces éléments peut lui nuire.
Des failles dans la structure des pôles de développement se traduisent souvent par des coûts internes pour les entreprises. L’absence d’établissements scolaires, par exemple, peut engendrer des coûts liés à la formation. Le manque de moyens de transport peut faire grimper le coût de la logistique. La discrimination sexuelle ou raciale peut réduire le bassin d’employés compétents. La pauvreté peut limiter la demande et mener à la détérioration de l’environnement, à des problèmes de santé qui affectent la main-d’œuvre et à des coûts de sécurité élevés. La capacité des entreprises à contribuer à la résolution de ces problèmes s’est amoindrie au fur et à mesure qu’elles se sont déconnectées des communautés où elles s’étaient installées ; et leurs coûts d’exploitation ont par conséquent augmenté.
Les entreprises peuvent créer de la valeur partagée en bâtissant ces pôles de développement pour améliorer la productivité des entreprises qui en font partie. Travailler à attirer de nouveaux fournisseurs ou à rendre les fournisseurs existants plus performants a des effets bénéfiques sur la chaîne d’approvisionnement, comme nous l’avons vu plus tôt. Pourtant, dans les théories de la gestion, il est peu question de l’importance des pôles de développement. Ceux-ci sont aussi absents de nombreux projets de développement économique — qui échouent, parce qu’ils ne comportent souvent que des interventions isolées et négligent des investissements complémentaires, pourtant très importants.
L’un des aspects clés de la création de pôles de développement, dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement, est l’existence de marchés transparents. En effet, sur les marchés inefficaces, ou en situation de monopole, les travailleurs sont exploités, les fournisseurs ne sont pas payés à leur juste valeur et les prix ne sont pas transparents, ce qui nuit à la productivité. Permettre la création de marchés ouverts et équitables — ce qui ne peut se faire que grâce à la collaboration de plusieurs partenaires — garantit un approvisionnement fiable et constant, stimule les fournisseurs à produire plus efficacement des biens et services de qualité, et augmente de façon non négligeable les revenus et le pouvoir d’achat des citoyens. En d’autres termes, il en résulte un cycle positif de développement économique et social.
Quand une entreprise contribue à l’édification d’un pôle de développement dans une région clé, elle resserre les liens entre sa propre croissance et les bénéfices que peut en retirer l’ensemble de la communauté. La croissance d’une entreprise a toujours des effets multiplicateurs : des emplois sont créés dans des secteurs de soutien, de nouvelles entreprises voient le jour et la demande pour des produits connexes augmente. Améliorer la structure d’un pôle de développement fait toujours boule de neige : les effets se font sentir chez tous les intervenants et dans l’économie locale — bonifier la formation de la main-d’œuvre, par exemple, élargit le bassin d’employés qualifiés pour toutes les entreprises.
De ce point de vue, Yara, un chef de file mondial du domaine des engrais minéraux, est un exemple. Devant les problèmes de logistique, dans de nombreuses régions africaines, qui empêchaient les agriculteurs de se procurer des engrais ou d’autres ressources essentielles et de transporter leur récolte jusqu’aux marchés, Yara a décidé d’investir 60 millions de dollars dans un programme de restructuration des ports et des routes, afin de créer des corridors de croissance agricole au Mozambique et en Tanzanie. Ce projet, réalisé avec la collaboration des pays africains concernés et grâce au soutien du gouvernement norvégien, pourrait bénéficier, au Mozambique seulement, à plus de 200 000 petits agriculteurs et créer quelque 350 000 emplois. Cela stimulera la croissance de Yara, bien sûr, mais l’effet multiplicateur sera aussi bénéfique au pôle de développement agricole de la région.
La création de pôles de développement n’est pas avantageuse que dans les pays en voie de développement. En Caroline du Nord, par exemple, Research Triangle, issu de la collaboration entre le public et le privé, a permis de créer de la valeur partagée grâce à la mise sur pied de pôles de développement dans les domaines des technologies de l’information et des sciences biologiques. La région a profité des investissements répétés du secteur privé et du gouvernement de l’État, puisque l’emploi, les salaires et les performances des entreprises s’y sont améliorés, et que la dernière récession y a eu moins d’impacts qu’ailleurs.
Pour soutenir la création de pôles de développement dans un secteur économique et dans un lieu donnés, les entreprises doivent d’abord définir les faiblesses qu’on y observe en matière de logistique, d’approvisionnement, de distribution, de formation et d’organisation du marché. Elles doivent ensuite se concentrer sur ce qui représente la plus grande contrainte pour leur productivité et leur croissance, et distinguer les domaines dans lesquels elles sont le plus à même d’intervenir seules et ceux dans lesquels une collaboration s’avérera plus rentable.
Comme le montrent les exemples de Nestlé, de Yara et de Research Triangle, améliorer les infrastructures dans une région nécessite souvent une action collective. Pour partager les coûts et s’assurer les compétences nécessaires, les entre¬prises ont tout intérêt à faire appel à des partenaires. Les pôles de développement les plus efficaces sont ceux qui résultent du travail de plusieurs entreprises privées réalisé avec la collaboration d’associations professionnelles, d’organismes publics et d’ONG.
Mise en pratique
Créer de la valeur économique tout en créant de la valeur sociale est l’un des facteurs majeurs de croissance dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui. C’est une nouvelle façon de considérer les clients, d’envisager la productivité et d’évaluer les facteurs externes qui ont une incidence sur la réussite d’une entreprise. Cette approche met en lumière les immenses besoins de l’humanité, les vastes nouveaux marchés à desservir, les coûts qu’impliquent tant les problèmes que les carences de certaines communautés et de la société dans son ensemble, de même que les avantages concurrentiels que l’on peut tirer en tentant de remédier à ces faiblesses. Jusqu’à tout récemment, aucune entreprise n’avait considéré ses activités sous cet angle.
Créer de la valeur partagée sera bien plus efficace et durable que la majorité des efforts que déploient actuellement les entreprises dans le domaine social. Par exemple, les entreprises protégeront mieux l’environnement si elles voient cette action comme un facteur de croissance de leur productivité, plutôt que comme une tâche qu’on leur impose de l’extérieur et qu’elles n’acceptent finalement que pour se donner bonne conscience. On peut dire la même chose à propos du domaine de l’immobilier et du logement : si, au cours des dernières années, les entreprises de services financiers avaient adopté l’approche de la création de valeur partagée, elles auraient proposé des produits financiers novateurs offrant un accès prudent à la propriété. C’est, par exemple, ce qu’a fait l’entreprise de construction mexicaine Urbi, qui a lancé un programme hypothécaire de location avec option d’achat. Mais la majorité des banques américaines — tout en se targuant d’être des entreprises responsables socialement parce qu’elles contribuaient à des œuvres de bienfaisance — ont plutôt fait la promotion de produits financiers non durables, qui ont eu des répercussions sociales et économiques catastrophiques.
Quand une entreprise veut créer de la valeur partagée, elle doit mettre en place les meilleures conditions possibles, c’est-à-dire se concentrer sur son domaine d’activité et sur les secteurs qui sont les plus importants pour elle. Elle en tirera ainsi le maximum de bénéfices économiques, et elle sera motivée à poursuivre dans cette voie. C’est aussi dans ses principaux secteurs d’activité qu’une entreprise a le plus de ressources, et que la place qu’elle occupe sur le marché lui permet d’avoir une influence significative sur un problème de société.
Chose curieuse, les pionniers de l’approche de la valeur partagée disposaient de très peu de moyens — c’étaient des entreprises à vocation sociale ou des entreprises de pays en voie de développement. Ces « marginaux » ont fait preuve d’une grande perspicacité, et grâce à eux, la frontière entre le lucratif et le non lucratif s’est estompée.
Le concept de valeur partagée implique un ensemble de pratiques nouvelles que les entreprises doivent adopter en tant que parties intégrantes de leur stratégie. Par définition, choisir une stratégie, c’est se positionner sur des marchés, établir une chaîne de valeur, puis agir en fonction de ces choix. Adopter le concept de valeur partagée, c’est découvrir une foule de nouveaux besoins à satisfaire, proposer de nouveaux produits et services, servir une nouvelle clientèle et trouver de nouvelles façons de penser la chaîne de valeur. Les avantages concurrentiels qui en découlent sont souvent plus durables que les moyens traditionnels utilisés pour améliorer la qualité et réduire les coûts.
Les occasions de créer de la valeur partagée sont innombrables, et elles ne cessent de se multiplier. Elles n’existent pas toujours dans tous les secteurs d’activité d’une entreprise donnée, mais l’expérience montre que les entreprises en trouvent d’autant plus que leurs différentes unités opérationnelles se familiarisent avec le concept. Il a fallu une décennie à GE, par exemple, pour mettre sur pied Ecomagination ; mais, aujourd’hui, cela lui permet d’offrir un grand nombre de produits et services.
Toutes les décisions importantes qu’une entreprise doit prendre peuvent être analysées sous l’angle de la valeur partagée. Le design de nos produits pourrait-il avoir de plus grandes répercussions sociales ? Toutes les communautés qui pourraient bénéficier de nos produits sont-elles desservies ? Nos procédures et notre logistique permettent-elles une consommation d’eau et d’énergie plus efficace du point de vue environnemental ? La construction d’une nouvelle usine peut-elle avoir des répercussions positives sur la région où elle sera située ? Les failles dans notre pôle de développement ont-elles pour effet de réduire notre efficacité et de freiner l’innovation ? Comment améliorer le bien-être de la communauté où nous exerçons nos activités ? Où nos installations profiteraient-elles le plus à l’ensemble de la population ?
Pour appliquer le concept de valeur partagée, il faut concevoir, pour chaque unité opérationnelle d’une entreprise, des outils d’évaluation adaptés à chacune des trois grandes voies à suivre pour créer de la valeur partagée (repenser les produits et les marchés, redéfinir la productivité dans la chaîne de valeur et créer des pôles de développement). Des entreprises ont déjà tenté d’évaluer certaines répercussions sociales de leurs activités dans ce contexte, mais la plupart n’ont pas encore réussi à établir de corrélation avec leurs intérêts économiques.
La valeur partagée requiert une toute nouvelle forme de collaboration. Il est possible que, dans certaines circonstances, une entreprise crée seule de la valeur partagée et en tire un bénéfice. Mais, dans d’autres circonstances, l’expertise, les compétences et les ressources d’autres acteurs — entreprises à but lucratif ou non lucratif, des secteurs privé ou public — sont souhaitables. C’est le cas quand une entreprise ne peut, seule, prendre en charge un problème qui se pose dans une communauté, et particulièrement quand celui-ci exige la mise sur pied d’un pôle de développement. Il se peut même, dans ce cas-là, que des concurrents doivent mettre en commun leurs efforts. Cette attitude contraste avec celle des entreprises qui préfèrent agir seules quand elles lancent des projets visant à convaincre les citoyens qu’elles sont des entreprises socialement responsables — parce que, souvent, leur objectif n’est alors que de soigner leur réputation. Une collaboration efficace doit être fondée sur le partage de données, la définition des résultats souhaités et les objectifs de chacun des acteurs en présence, et ces résultats doivent être évalués le plus précisément possible.
Vers un capitalisme renouvelé
La prochaine vague d’innovation et de croissance reposera sur la création de valeur partagée. Ce concept permet de rétablir le lien entre croissance des entreprises et bien-être des communautés en rappelant des principes dont nous nous sommes longtemps désintéressés à cause de théories de la gestion étriquées, de la prédominance des visions à court terme et du fossé grandissant qui s’est creusé entre les différents types d’organisations et d’institutions de la société.
Adopter l’approche de la valeur partagée, c’est choisir de réaliser des profits tout en augmentant — plutôt qu’en réduisant — les bénéfices que cela entraîne pour la société. Les marchés continueront bien sûr d’encourager les entreprises à d’abord réaliser des profits à court terme, et certaines continueront de réaliser leurs profits aux dépens de la collectivité. Mais les bénéfices recueillis selon cette approche ne sont généralement pas durables, et la course aux profits immédiats et à tout prix empêche ceux qui s’y engagent de profiter d’occasions qui seraient finalement plus profitables.
Le moment est venu d’élargir notre vision de ce que signifie créer de la valeur. Différents facteurs, comme une plus grande conscientisation des travailleurs et des citoyens ainsi que la raréfaction des ressources naturelles, produiront des occasions exceptionnelles de créer de la valeur partagée.
Le capitalisme doit se renouveler, et pour cela, il doit se fonder sur le bien-être de la société. Cela n’a rien à voir avec l’idée de charité ; c’est plutôt le résultat d’une meilleure compr&e