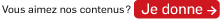Tôt ou tard, tout dirigeant d’entreprise doit prendre des risques qui influeront considérablement sur l’avenir de son organisation. Voici comment jouer gros sans pour autant risquer de tout perdre.
Auteurs : Ram Charam et Michel Sisk, Strategy + Business
Lorsqu’en juillet 2008 Dow Chemical annonce qu’elle a l’intention de faire l’acquisition de Rohm & Haas, c’est son futur qu’elle met en jeu. Le projet est pour le moins audacieux. Non seulement il signifie la mise à la disposition de toutes les ressources financières de l’entreprise, mais encore un changement radical de son modèle d’affaires, ce qui va à l’encontre de tout ce que prône l’industrie. Andrew Liveris, le PDG, qualifie d’ailleurs de « transformation profonde » cette transaction d’un montant de 18,8 milliards de dollars américains qui, selon lui, permettra à Dow d’étendre son offre à des produits de niche — et ainsi de gagner des parts de marché à l’international et d’augmenter ses profits —, pour ne plus dépendre d’une production peu rentable, hautement volatile et cyclique.
Pour cette vénérable compagnie fondée en 1897, il ne s’agit pas d’une simple opération de fusion-acquisition. C’est plutôt une stratégie osée, dont les conséquences peuvent être fatales. Peu de patrons s’y risqueraient. C’est pourtant ce que nombre d’entreprises sont aujourd’hui amenées à faire, en raison de la constante mutation du monde des affaires. Mais revenons à Dow. Dans les mois qui suivent l’annonce de la fusion-acquisition, les choses ne vont pas pour le mieux. Le pari est loin d’être gagné. Wall Street a des réserves et le financement n’est pas une mince affaire. Dow s’est taillé une réputation de chef de file dans la vente de produits de base, et la plupart des analystes de l’industrie s’accordent à dire que la transformation envisagée est trop radicale, l’échéance, trop rapprochée, les chances de réussite, trop incertaines, et le prix, trop élevé, nonobstant le solide bilan financier de l’entreprise et sa place enviable de numéro un mondial.###
Mais, des mois durant, M. Liveris prépare méticuleusement le terrain. Pour s’assurer du succès de son opération, il tente de gagner la confiance des membres de son conseil d’administration et des investisseurs institutionnels en les rencontrant à plusieurs reprises. Avec eux, il discute financement, abandon possible de certaines activités et pertinence de la transaction. Bien sûr, le PDG connaît des revers. De potentiels partenaires financiers lui font faux bond. Mais il persiste et, en décembre 2008, signe un contrat exécutoire avec la Petrochemical Industries Company (PIC), une pétrolière d’État koweïtienne dont la contribution de neuf milliards de dollars américains doit permettre un financement partiel de l’acquisition, réduisant ainsi de manière significative le risque encouru par Dow.
Ce scénario, un grand nombre de multinationales le vivront, elles aussi, dans les dix années à venir. Certaines ont déjà pris les devants, parfois même dans des marchés en émergence : Vale, au Brésil, Cemex, au Mexique, United Breweries, en Inde, SABMiller, en Afrique du Sud, et ArcelorMittal, au Luxembourg, sont devenues des chefs de file dans leurs industries respectives en prenant de tels risques. D’autres, de grandes entreprises américaines, canadiennes, japonaises ou européennes faisant face à des changements de taille ou ayant atteint une phase de maturité, pourraient n’avoir d’autre choix que de miser gros pour assurer leur pérennité.
La capacité de ces entreprises à saisir la pertinence d’un changement majeur au moment opportun et à mettre en œuvre la bonne stratégie sera alors de la plus haute importance. Pour réussir, elles devront non seulement repenser leur manière de concevoir et de façonner une stratégie, mais aussi trouver la déter¬mination et le courage nécessaires avant de passer à l’action (sans attendre le moment fatidique pour découvrir si elles ont la force de carac¬tère suffisante pour une opération de si grande envergure).
Un leadership à toute épreuve
Celui qui s’engage dans une telle aventure peut s’attendre à affronter un certain nombre d’épreuves. Celles-ci sont ardues, s’échelonnent sur plusieurs années et peuvent mettre à bas la détermination et la créativité de tout un chacun. Andrew Liveris peut en témoigner : le 31 décembre 2008, soit deux jours avant la signature de l’entente finale avec PIC, le gouvernement koweïtien fait subitement marche arrière. « Nous étions sous le choc, raconte le PDG, c’était totalement inattendu. Nous avions reçu toutes les approbations et rien dans le comportement, les agissements ou le discours de nos vis-à-vis n’aurait pu laisser présager un tel retournement de situation. »
La structure financière du projet étant ainsi fragilisée, c’est l’ensemble de la construction qui se fissure. De nombreux commentateurs s’attendent d’ailleurs à ce que Dow annule l’entente et se retire. M. Liveris semble être dans une impasse : se retirer serait un échec personnel et pourrait placer Dow dans une situation juridique des plus délicates, car le contrat avec Rohm & Haas est en béton et ses dirigeants ne feront aucune concession. De plus, il s’agit d’une transaction en espèces, et trouver en ce début de 2009 (en pleine récession mondiale) une somme équivalente à celle que proposait PIC tient du miracle. En temps normal, il est déjà difficile de convaincre les investisseurs de soutenir une telle stratégie. Mais à ce moment précis, alors que les marchés sont aux prises avec la pire crise économique depuis 65 ans et que le système financier mondial tremble sur ses bases, leur frilosité s’est accentuée. En mars 2009, l’action de Dow ne vaut plus que 7 $ US (elle était de 30 $ US au moment de l’annonce de l’achat de Rohm & Haas, durant l’été 2008) et l’entreprise risque de se faire recaler par les agences de notation Standard & Poor’s et Moody’s.
Le PDG de Dow décide pourtant de garder le cap. Il lui faut s’assurer du soutien de son conseil d’administration, trouver de nouvelles sources de financement et convaincre les marchés qu’il est, certes, tombé sur un os, mais qu’il n’a pas pour autant dit son dernier mot. Son leadership est mis à rude épreuve. Il doit faire preuve de persévérance et d’une grande force morale pour continuer de vanter les mérites de sa stratégie et persuader le conseil d’administration, les investisseurs institutionnels, les analystes de Wall Street et les agences de notation qu’il a fait le bon choix et que son projet est en¬core viable.
M. Liveris finit par remporter son pari. Les membres du conseil d’administration ne lui font pas quitter le navire, les agences de notation n’abaissent pas la cote de Dow et de nouveaux partenaires financiers — Warren Buffett et deux membres de la famille Rohm & Haas — sont sur le pont. La transaction se traduit bel et bien par une « transformation profonde ». Ensemble, Dow et Rohm & Haas se révèlent bien plus performantes que seules. Aujourd’hui, les profits des produits chimiques de niche représentent les deux tiers du revenu total de Dow, soit 50 % de plus qu’avant la création de la coentreprise. Les marchés des capitaux ont également repris confiance. En janvier 2010 (l’acquisition date de juillet 2009), l’action de Dow dépasse 29 $ US et M. Liveris déclare qu’elle pourrait donner un rendement record de 4,50 $ US par titre, d’ici 2012.
Ainsi, M. Liveris et son conseil d’administration n’ont pas eu peur de miser gros : ils ont compris qu’avec l’évolution rapide de l’industrie chimique mondiale, l’entreprise se devait, tôt ou tard, de changer, et qu’il valait mieux accepter ce changement inexorable que de perdre du terrain, même si cela nécessitait de prendre des risques importants. Avec l’arrivée, dans l’industrie, de nouveaux acteurs issus de pays émergents ou riches en ressources naturelles, il n’était pas difficile de prévoir que les produits chimiques de base deviendraient moins rentables. Le vrai génie a été d’agir sans délai, de changer de modèle d’affaires, et d’acquérir et de mettre en œuvre les compétences nécessaires au changement, avant même que la concurrence ne s’adapte à cette nouvelle donne ou ne s’en rende compte.
Il y a un autre enseignement à tirer de l’expérience de Dow. Les péripéties que celle-ci a connues montrent l’incertitude inhérente à ce type de stratégie. M. Liveris a eu à conclure l’entente signée avec Rohm & Haas dans une situation que personne n’aurait pu imaginer au départ : rien de moins qu’une récession mondiale.
Anatomie d’un pari stratégique
Un pari stratégique est un changement profond et radical visant à transformer une entreprise, à créer de la croissance, voire à mettre au monde une toute nouvelle organisation. Il peut signi¬fier une nouvelle donne pour la compagnie en question, mais également pour son industrie et même pour les industries adjacentes. Le pari straté¬gique peut avoir une incidence telle que toutes les composantes d’une entreprise (personnel, mode opératoire, pratiques…) sont touchées. Pour le mettre en place, il faut le soutien indéfectible de la haute direction et du conseil d’administration. Dans la plupart des cas, sa mise en œuvre inquiète, surtout lorsqu’il s’agit d’une acquisition importante, au vu et au su de tous, car personne ne peut prévoir les réactions tant du marché que des analystes et des agences de notation. Le pari stratégique ne peut réussir que si la direction et le conseil d’administration ont la confiance et l’endurance nécessaires pour le soutenir, jusqu’à ce que le reste du monde en reconnaisse les mérites (ce qui peut prendre des années).
Il existe au moins trois bonnes raisons de vouloir se lancer dans un pari stratégique en vue d’une acquisition.
1. Pour s’assurer d’une participation majoritaire, voire d’une mainmise de l’entreprise ciblée, ou bien pour acquérir des ressources ou des compétences indispensables. À la fin de 2010, de nombreuses stratégies d’acquisition ont été mises en œuvre dans les secteurs minier et métallurgique. Elles ont été le fait de compagnies chinoises et indiennes qui voulaient s’assurer de rester concurrentielles dans la production de ressources rares pour les nouvelles technologies (le lithium, entre autres, dont la demande risque fort d’augmenter avec la mise en marché de la nouvelle génération de batteries d’automobiles).
2. Pour se sortir d’une industrie en déclin, avant que la concurrence ne le fasse. C’est la raison invoquée, par exemple, quand une entreprise reconnaît qu’une partie de ses activités a perdu de son pouvoir d’attraction ou de sa valeur (quelle qu’en soit la raison) ou encore qu’elle n’a plus le pouvoir de fixer les prix. Plutôt que de subir le déclin, elle choisit de réduire ses pertes en vendant le secteur incriminé et de concentrer ses efforts sur un produit ou un service plus prometteur.
Lawrence A. Bossidy, le PDG d’Allied Signal, a ainsi fait preuve de flair en 1996… La vente de pièces d’automobile, qui ne représente à ce moment-là que 15 % du revenu total de l’entreprise, ne lui semble plus un secteur d’avenir. Il décide donc de se départir de l’essentiel des activités qui lui sont liées (une vente qui lui rapporte 2,1 milliards de dollars américains) pour se concentrer sur l’aérospatiale et la chimie. Deux années plus tard, il supervise l’acquisition de Honeywell (une entreprise deux fois plus petite qu’Allied Signal) et, par un échange d’actions d’une valeur de 14 milliards, devient l’un des plus gros acteurs sur le marché mondial de ces deux secteurs économiques.
3. Pour occuper le terrain et prendre des parts du marché. Faire l’acquisition de compagnies, de technologies ou de compétences de base, c’est ce qui peut permettre d’assurer la réussite d’une entreprise en phase de développement. Prenons le cas de Bharti Airtel. Avec ses quelque 120 millions d’abonnés, il s’agit de la plus grande entreprise de téléphonie cellulaire indienne. Dans l’optique d’une expansion mondiale, elle mise sur deux facteurs, l’échelle et l’efficacité, cherchant à séduire chaque nouveau client sans que cela exige un investissement trop important. Or, ce type d’approche est risqué, car il nécessite en général un financement élevé et un rendement sur l’investissement rapide.
En 2009, la haute direction de Bharti Airtel s’engage dans des négociations de longue haleine afin d’acquérir le MTN Group, une entreprise sud-africaine de télécommunications mobiles faisant affaire dans de nombreux pays moyen-orientaux et africains. La coentreprise qui doit en découler — énorme pari stratégique s’il en est — est vivement souhaitée par Sunil Mittal, le PDG de Bharti, mais les investisseurs comme les analystes s’y opposent, en raison du financement de la dette, entre autres. Durant l’automne 2009, M. Mittal doit se résoudre à suspendre les négociations, mais seulement après que le gouvernement sud-africain a décidé de ne plus soutenir le projet.
Le PDG indien ne se résigne pas pour autant et, en juin 2010, Bharti Airtel fait l’acquisition de Zain Africa pour 10,7 milliards de dollars américains. Cette branche de la koweïtienne Zain, une entreprise de télécommunications, œuvre dans 15 pays africains. Avec ce rachat, la firme indienne grignote enfin des parts de marché sur le continent qu’elle convoitait tant. À peu près au même moment, Bharti Airtel annonce son intention d’acheter 70 % de Warid Telecom International, au Bangladesh. Les analystes ont beau discréditer cette dernière opération et faire pression pour que la haute direction et le conseil d’administration l’abandonnent, M. Mittal refuse de céder. Il réunit une équipe de première main pour diriger ses équipes au Moyen-Orient et en Afrique, où il a la ferme intention de s’enraciner. Fait révélateur, les banques embarquent dès lors dans le projet et s’engagent dans une compétition féroce pour financer l’opération…
Faire face à l’adversité
L’issue d’une opération de fusion-acquisition est toujours incertaine, comme le montrent les négociations avortées de Bharti Airtel avec MTN. Il est vrai qu’elle repose sur un pari. Bharti Airtel a eu la chance de pouvoir faire une autre opération de fusion-acquisition dans le secteur convoité, ce qui a rendu son échec avec MTN un peu moins cuisant.
Toutefois, une acquisition faite à un moment inopportun, ou en présence de forces incontrôlables, peut avoir des conséquences désastreuses sur la stratégie, voire mettre l’entreprise en péril. Lorsque Federal-Mogul Corp., un fournisseur de pièces d’automobile américain, achète l’équimentier britannique Turner & Newall, en 1998, il met sans le savoir le pied dans l’engrenage des procès intentés par les victimes de l’amiante. L’opération lui vaut même de se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites, en 2001. Il lui faudra attendre jusqu’en 2007 pour pouvoir donner un nouveau coup d’accélérateur. De même, quand, au milieu de 2008, la Royal Bank of Scotland (RBS) fait l’acquisition, avec Fortis et Banco Santander, de la banque néerlandaise ABN Amro, elle entend bien occuper une position stratégique sur le continent européen. Mais la surenchère à laquelle elle doit se livrer avec Barclays la fragilise à un point tel qu’elle n’a plus le ressort nécessaire pour affronter la crise des subprimes qui fait rage.
Garder les choses en perspective est capital lorsqu’on met un pari stratégique au point. En effet, un dérapage est toujours possible quand on opte pour un plan si radical et si exigeant. Prenons l’exemple de Ken Lewis, l’ex-PDG de la Bank of America. Sa décision d’acquérir Merrill Lynch pour élargir son champ d’action, durant la période de panique qui suit la faillite de Lehman Brothers, ne manque pas d’audace. La clairvoyance de M. Lewis et le profit que cet achat aurait pu représenter pour la banque et ses investisseurs ne sont pas difficiles à imaginer, mais il aurait fallu autrement plus de temps et de persuasion pour exprimer le plein potentiel qu’il voyait alors dans cette acquisition. Le marché n’a finalement pas été conclu — la divulgation des primes versées aux cadres de Merrill Lynch en aura eu raison — et M. Lewis a été contraint de démissionner. Ce qui, une fois encore, donne une bonne idée de la nature des enjeux d’un tel projet.
D’aucuns pourront sourciller et se dire que le sort réservé à Federal-Mogul, à la RBS et à Ken Lewis fait que le jeu, trop risqué, n’en vaut pas la chandelle. Face à l’adversité, on hésite parfois à se lancer dans une aventure incertaine. C’est d’ailleurs ce qui explique la timidité de certaines hautes directions et de certains conseils d’administration, en matière de stratégie d’acquisition. À un pari stratégique mettant potentiellement en péril l’entreprise et son organigramme, et exigeant une grande ouverture d’esprit et une acceptation du changement, on préfère souvent le confort du train-train quotidien.
Et c’est vrai qu’il est parfois préférable de faire l’économie d’une stratégie de mauvais aloi. En 2005, Johnson & Johnson n’a-t-elle pas retiréson offre de 24 milliards pour acheter Guidant Corporation, un fabricant de stimulateurs cardiaques, de défibrillateurs et d’endoprothèses vasculaires, quand elle a eu vent de certains problèmes de sécurité ? C’est la Boston Scientific Corporation qui, avec une offre supérieure, s’est portée acquéreur, ce qui lui a par la suite valu de graves démêlés juridiques. Peu de temps après, le magazine Fortune a qualifié l’opération de pire fusion-acquisition de l’histoire, tout juste derrière celle d’AOL et de Time Warner. L’action de la Boston Scientific Corp. a chuté en Bourse, et ses fondateurs ont été contraints de se défaire de nombre de leurs titres.
Cela dit, ne pas opter pour une stratégie d’acquisition peut être pire, voire fatal. La passivité, le refus d’agir peuvent passer pour du conservatisme, alors qu’en fait il s’agit là aussi d’un choix stratégique, d’une stratégie par omission dont les conséquences sont parfois catastrophiques. Hésiter, ne pas saisir une occasion, voilà qui peut faire de l’entreprise une proie facile pour un acquéreur potentiel. Dans les faits, le dirigeant qui choisit une stratégie par omission confie le destin de son organisation à d’autres acteurs : un organisme gouvernemental de réglementation, un concurrent, un investisseur en financement par capitaux propres ou un fonds de couverture.
La décision d’AOL de ne pas investir dans un moteur de recherche est très significative à cet égard. Au milieu des années 1990, elle surfe bien haut sur la vague Internet, loin devant Yahoo ! et une multitude de portails et de moteurs de recherche aujourd’hui disparus. En ne mettant pas au point un moteur de recherche performant, elle laisse toute latitude à deux talentueux gamins frais émoulus de Stanford, qui, en créant Google, relèguent Time Warner dans la cohorte des acteurs de second plan. Aujourd’hui, le PDG d’AOL, Tim Armstrong (un ancien de Google), fait à son tour un choix stratégique : transformer la compagnie en un fournisseur de contenu, par des acquisitions, des partenariats et des projets visant la croissance à l’interne.
Une attitude héroïque
Il est rare qu’un conseil d’administration soit psychologiquement préparé à un audacieux projet d’acquisition élaboré par les cadres supérieurs de son entreprise. Quelle que soit la raison de la stratégie (le déclin à long terme de la valeur d’un bien ; le besoin en ressources naturelles ; etc.) et peu importe sa pertinence, le conseil ou la haute direction aime à faire de la résistance. Surtout si ses membres sont des personnes précautionneuses ou ayant peu ou pas d’expérience en la matière. On en a même vu certains qui, en proie à une très grande anxiété, se désistent, au moment fatidique, sous prétexte que la plupart des stratégies d’acquisition ne fonctionnent pas et que, pour cette raison, il vaut mieux s’abstenir. La chute du prix de l’action, la baisse de la cote financière ou la mauvaise publicité engendrée par une fusion-acquisition pouvant discréditer tant la société que ses dirigeants, c’est ce qui fait peur, dans la plupart des cas.
Il appartient au leader de faire comprendre ce à quoi l’entreprise fait face en choisissant l’immobilisme. Bien sûr, pour des sociétés comme Siemens AG et Procter & Gamble, les risques encourus ne sont pas aussi grands que pour des entreprises de taille plus modeste. Mais, le danger est grand dans le cas d’entreprises qui sont déjà des cibles pour des acquéreurs potentiels. Une franche discussion avec le conseil d’administration est alors de mise, afin de convaincre ses membres qu’une prise de contrôle par un concurrent est, à terme, inévitable, si la société ne passe pas à l’action. En les persuadant de faire un pari stratégique, le leader peut alors faire passer son entreprise dans la catégorie supérieure.
Alors, si l’enjeu est si important et l’incertitude si grande, quelle différence y a-t-il entre un leader qui lance un pari stratégique et un joueur qui mise le tout pour le tout à une table de poker ? En toute objectivité, le calcul que doit faire le joueur est bien plus aisé.
Le joueur fait face à des probabilités connues, quel que soit le jeu, poker, roulette ou baccarat. Le leader, lui, ne peut compter sur une situation aussi contrôlée et aussi stable pour établir sa stratégie. Pour lui, chaque jeu est différent, le calendrier et le contexte créant toujours des situations inédites. Les exigences auxquelles il doit se plier sont donc énormes. Il y a quelques années, pour toute décision stratégique, la tendance était de s’en remettre à l’analytique et, partant, d’accorder un peu moins d’importance à l’idée même de leadership. Mais l’analytique a ses limites et ne suffit pas à déterminer le bien-fondé d’une stratégie d’acquisition. En effet, décider de la pertinence d’un pari stratégique en se fondant sur les réussites passées est contestable, car le paysage économique risque fort d’avoir changé.
La première justification d’un pari stratégique doit être dans la vision très claire des possibilités futures de l’entreprise. Le leader doit étayer sa thèse avec des outils tant quantitatifs (vérification préalable et analyses) que qualificatifs (en examinant sous plusieurs angles la situation ainsi que tous les scénarios possibles). La mise en œuvre d’une telle stratégie requiert une grande capacité de jugement, qui ne peut s’acquérir du jour au lendemain, mais doit être cultivée. Cette perspicacité est une qualité absolument fondamentale dans le développement du leader, à une époque où les stratégies d’acquisition sont légion.
L’inconfort qu’engendrent les risques inhérents à une stratégie d’acquisition pourra en rebuter certains. Après tout, un pari ne serait pas un pari s’il ne comportait sa part de risques. Mais les affaires sont les affaires. Par définition, elles comportent une certaine dose d’inconfort. Le contrôle absolu est impossible. La seule chose qu’on puisse espérer, c’est saisir les bonnes occasions. Pour le futur de son entreprise, le leader doit accepter d’aller de l’avant et jouer le tout pour le tout, avec discernement. Andrew Liveris, par exemple, n’a peut-être pas rentabilisé son opération aussi vite que Wall Street l’aurait souhaité. Sa stratégie a certes fait couler beaucoup d’encre. Mais il a néanmoins assuré à Dow une place de choix sur le marché mondial. Si bien que le marché commence seulement à constater la prouesse de l’audacieux PDG. Dans quelques années, à n’en pas douter, il sera fin prêt pour un nouveau pari. Là est la marque du vrai leadership.