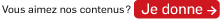Les campagnes Centraide ont débuté dans les régions du Québec. Cet appel à la générosité est très important en raison de la pauvreté qui frappe durement de nombreux concitoyens.
Selon Centraide du Grand Montréal, il y a 453 845 personnes à faible à revenu sur l'île de Montréal, 98 140 sur la Rive-Sud et 50 450 à Laval. Autre donnée inquiétante, le nombre de travailleurs pauvres a crû de 30 % de 2001 à 2012 (on l'évalue à 125 000) dans le Grand Montréal.
La situation est probablement moins tragique dans la plupart des autres régions, mais on y compte sans doute aussi des milliers de personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts ou qui souffrent de sous-alimentation, d'isolement, de maladie mentale, de déficience, de violence, de dépendance, etc. Des jeunes sont abandonnés, décrochent du système scolaire et sont victimes de prédateurs. Des parents sont incapables de nourrir convenablement leurs enfants et de pourvoir à leur éducation.
Il faut remercier et féliciter chaudement les personnes qui oeuvrent au sein des organismes communautaires voués à la lutte contre la pauvreté, à la persévérance scolaire, au soutien des personnes seules et à l'aide aux familles incapables d'assurer leur propre subsistance.
Ces organismes comptent sur trois types de ressources pour accomplir leur mission : les programmes d'aide des gouvernements, qui sont insuffisants, une armée de bénévoles et le financement philanthropique.
La philanthropie, parent pauvre
Or, la philanthropie va mal au Québec. Pour tenter de nous donner bonne conscience, certains font valoir que nous sommes aussi généreux que les autres Canadiens et rappellent les bonnes vieilles corvées d'autrefois. Malheureusement, les statistiques ne mentent pas. Sans être d'une rigueur absolue, elles révèlent beaucoup sur notre manque d'empathie envers les plus démunis, comparativement à la générosité des autres Canadiens.
Selon la dernière enquête de Statistique Canada sur les dons (elle date de 2010, mais les chiffres sont toujours pertinents), la contribution moyenne d'un Québécois atteignait alors 208 $, soit deux fois moins que celle relevée dans l'ensemble du Canada (446 $). Le don moyen dans les provinces de l'Ouest était d'environ 550 $, alors qu'il était de 400 $ dans les provinces atlantiques.
Une deuxième étude, faite par l'Institut Fraser à partir des dons de bienfaisance enregistrés dans les déclarations d'impôt de 2013, va dans le même sens. Les chiffres sont plus élevés, car ils n'incluent que les dons faits par les gens qui paient de l'impôt (60 % de la population). Selon cette étude, les Québécois ont déclaré cette année-là un don moyen de 735 $, soit 0,28 % de leur revenu brut déclaré, en baisse sur le 0,32 % en 2003, comparativement à 1 574 $, soit 0,56 % du revenu brut, pour l'ensemble des Canadiens. Le Québec arrive de nouveau bon dernier à ce titre parmi l'ensemble des provinces et des territoires. Cette même étude révèle aussi que seulement 20,2 % des Québécois qui ont fait une déclaration d'impôt en 2013 (c'était 22,5 % en 2003) ont enregistré un don, contrairement à 21,8 % (24,1 % en 2003) pour le pays.
Toujours selon l'étude de l'Institut Fraser, 25 % des Américains qui ont fait une déclaration de revenus en 2013 ont enregistré un don moyen de 5 342 $, soit 1,39 % de leur revenu brut moyen. Si les Canadiens avaient été aussi généreux que les Américains en 2013, ils auraient déclaré 12,9 milliards de dollars de plus, soit un potentiel de dons de 21,7 G$, au lieu des 8,8 G$ enregistrés.
Dans l'intérêt de tous
La tendance à la baisse de la philanthropie canadienne - et c'est encore plus dramatique du Québec - est très inquiétante et nous interpelle comme citoyen. Si l'on donne si peu comparativement à d'autres, c'est sans doute pour une raison culturelle, d'où le besoin de revitaliser et d'encourager davantage la philanthropie.
Il est dans l'intérêt de l'ensemble de la société non seulement d'aider davantage, mais de montrer aussi aux moins favorisés que les personnes plus avantagées sont sensibles à leur sort et se préoccupent d'eux. Et n'oublions pas que nos dons (même petits) peuvent valoir une fortune pour certains. Autre raison de donner, la solidarité sociale est une police d'assurance contre le cynisme de certains et un gage de paix sociale.
L'État doit aussi se sentir interpellé. Pourquoi ne pas mettre en place des mesures fiscales qui incitent les particuliers à donner davantage ? Pourquoi ne pas permettre aux actionnaires de sociétés à capital fermé de soustraire à l'impôt les gains en capital réalisés lors de la vente de leurs parts, comme on le fait déjà pour les actions des sociétés en Bourse ?
«Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir», entend-on parfois. Oui, cela fait du bien de donner... à autrui, mais aussi à soi-même.
J'aime
Québec veut revoir le régime de retraite des policiers de la Sûreté du Québec. Ce régime prévoit une pleine retraite après 25 ans de service. Le gouvernement paie environ 66 % de son coût, au lieu de 50 % pour les régimes de retraite de la plupart de ses employés. Cet avantage crée une concurrence déloyale à l'égard des services de police des villes et une iniquité face aux autres employés de l'État.
Je n'aime pas
Pharmascience, premier fabricant de médicaments génériques au Québec et deuxième au Canada derrière Apotex, éliminera environ 90 postes à son siège social de Montréal. Cette mesure est liée à la décision du gouvernement du Québec de dégeler les ristournes aux pharmaciens, ce qui nuit à la capacité concurrentielle de Pharmascience.