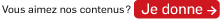Donald Trump manque cruellement d'«intelligence interactionnelle»... Photo: DR
Ils étaient peut-être 500, parmi lesquels des femmes et des enfants. Ils manifestaient dimanche dernier à Tijuana aux abords de la frontière américaine, protestant contre sa fermeture, contre l’impossibilité d’accéder enfin à leur rêve américain après avoir cheminé, des semaines durant, sur quelque 4 000 km dans l’espoir d’une vie meilleure. Et soudain, ils se sont massivement rués vers la première clôture rouillée qui délimitait la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis.
Ils ont réussi à franchir cette barrière métallique, et se sont retrouvés face à une seconde, plus périlleuse, car surmontée de barbelés. Mais surtout, des garde-frontières américains se sont vite déployés pour les bombarder de gaz lacrymogène, et des hélicoptères militaires ont aussitôt décollé pour leur voler juste au-dessus de la tête.
Harcelés de toutes parts, les centaines de migrants n’arrivaient plus à respirer, pris au piège dans un immense nuage de poussières et de gaz toxiques. Ils ont dû rebrousser chemin, et revenir se terrer dans le centre sportif voisin où plus de 5 000 migrants honduriens s’entassent depuis une semaine. Le cœur brisé. L’âme meurtrie.
Donald Trump a alors lâché un tweet. Le président américain a réitéré une énième fois qu’il n’était pas question d’accueillir ces migrants-là, dont «la plupart sont des criminels endurcis», avance-t-il sans aucunement appuyer cette affirmation. Il a martelé sa menace de «fermer définitivement toute la frontière avec le Mexique». Et il a appelé une nouvelle fois le Congrès américain à financer son projet de mur entre le Mexique et les États-Unis, dont le coût est estimé par sa propre administration à 25 G$ US.
Bref, la politique de Trump consiste juste à fermer hermétiquement les 3 141 km de frontière qu’ont les États-Unis avec le Mexique. Et même à fermer chacun d’eux à double tour pour dissuader tout migrant sud-américain de s’en approcher de trop près.
Le hic, c’est que cette politique est aussi ridicule qu’absurde. Pis, elle est cauchemardesque pour l’économie américaine elle-même. Explication.
De nos jours, il existe d’ores et déjà 1 300 km de mur entre les deux pays. Ce qui représente le tiers de la frontière. Cette muraille éparse est essentiellement née en 2006, à la suite du Secure Fence Act signé par le président George W. Bush dans le but de protéger l’économie américaine de l’immigration clandestine et du trafic de drogue. Son coût prévisionnel avait été de 2 G$ US, mais dès le début des travaux il a été réévalué à 7 G$ US, et aujourd’hui les chiffres varient entre 10 et 20 G$ US.
La question est, bien entendu, de savoir si la muraille a permis d’atteindre les objectifs visés, ou pas. De savoir si c’est un franc succès ou un lamentable échec.
Treb Allen, professeur d’économie au Darthmouth College, et Melanie Morten, professeure d’économie à l’Université Stanford, assistée de son étudiant Cauê de Castro Dobbin, ont voulu en avoir le cœur net. Ensemble, ils ont regardé quel avait été l’impact économique réel du mur en place. Et ce, en recourant surtout à une base de données à la fois inédite et confidentielle, celle des consultats mexicains implantés aux Etats-Unis, qui procurent une carte d’identité provisoire aux clandestins mexicains, histoire de leur faire bénéficier de certains droits sur le territoire américain.
L’intérêt de cette base de données ? Elle permet d’observer en détails les flux migratoires clandestins dans quelque 3 000 zones géographiques des Etats-Unis ainsi que les variations de leurs impacts économiques directs et indirects au fil du temps, et donc, à mesure que les 1.300 km de la muraille de Bush ont vu le jour. Fascinant, n’est-ce pas ?
Résultats ? Tenez-vous bien :
– La muraille de Bush a coûté en moyenne 7 $ US à chaque Américain. Et elle a rapporté très exactement 0,36 $ US à chaque travailleur américain peu qualifié. Oui, vous avez bien lu : 36 cents.
– Si on continuait les travaux au point d’installer le mur sur la moitié de la longueur de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, le gain pour chaque travailleur américain peu qualifié serait de 0,58 $ US. Une fois de plus, je vous confirme que vous avez bien lu : 58 cents.
Autrement dit, à cause de la politique de Bush, chaque Américain a déboursé de sa poche 7 $ pour que les travailleurs américains peu qualifiés gagnent chacun 36 cents. Et si l’on poursuivait cette politique, le «rendement» serait pire.
L’évidence saute aux yeux : il s’agit là d’une politique catastrophique sur le plan économique.
Ce n’est pas tout. Grâce à la richesse de leurs données, les chercheurs ont pu regarder ce qui se passerait si les flux migratoires et commerciaux étaient non pas freinés, mais facilités entre le Mexique et les Etats-Unis. Et ce qu’ils ont ainsi découvert est carrément renversant !
Si les Etats-Unis ouvraient assez leur frontière pour permettre une réduction de 25% des coûts d’import/export, alors :
– Chaque travailleur américain peu qualifié empocherait en moyenne 59 $ US ;
– Les gains seraient encore plus importants pour les travailleurs mexicains peu qualifiés, tout comme pour les travailleurs hautement qualifiés, qu’ils soient mexicains ou américains.
– Le nombre de migrants clandestins originaires du Mexique chuterait aussitôt de 123 000 puisqu’il ne serait plus si intéressant que ça de s’exiler aux Etats-Unis pour s’en sortir sur le plan économique.
Bref, tout le monde serait content : d’une part, chacun s’enrichirait, des deux côtés de la frontière ; d’autre part, le flux de clandestins s’estomperait de lui-même.
«Notre analyse des 28 murs qui ont été érigés dans le monde entre deux pays depuis 2000 montre que ceux-ci n’ont vu le jour que pour une seule et unique raison : la protection économique. Or, cette politique est contre-productive, car un mur ne fait jamais que générer de nouveaux problèmes : il crée de nouvelles tensions économiques et politiques, et se traduit parfois même par des hostilités ouvertes entre les deux pays concernés», notent dans une autre étude David Carter et Paul Poast, deux professeurs de politique oeuvrant respectivement à l’Université de Princeton et à celle de Chicago.
Une conclusion qui fait furieusement penser, je trouve, aux récents tirs de gaz lacrymogène des garde-frontières américains…
Un manque cruel d’intelligence interactionnelle
Donc, la politique de protection économique de Donald Trump est une grossière erreur. C’est maintenant un fait. Et malheureusement pour le président américain, ce n’est pas tout : celle-ci nuit, en plus, à son propre leadership…

Le tiers de la frontière entre le Mexique et les États-Unis est d'ores et déjà murée. Photo:DR
Dans son livre Every nation for itself : Winners and losers in a G-Zero World, le politologue américain Ian Bremmer regarde quels États sont les plus à même de se développer dans un monde en perpétuelle mutation. D’après lui, les «gagnants» seront ceux qui parviendront à avoir non seulement «différentes options de croissance», mais aussi «de l’influence sur les autres États» ; ceux qui feront preuve de souplesse et de résilience ; ceux qui seront stables dans un monde instable. En revanche, les «perdants» seront ceux qui se montreront «inflexibles», voire «rigides», étant sans cesse campés sur leurs idées fixes ; ceux qui seront incapables d’adaptation ; ceux qui seront déstabilisés à chaque vague d’un monde instable.
Bref, M. Bremmer considère que le leader d’aujourd’hui et de demain est celui qui dispose d’emblée une «intelligence interactionnelle» conséquente, et mieux, sait la cultiver à bon escient. Autrement dit, le leadership est actuellement l’art d’établir autour de soi un vaste réseau de connexions et de manœuvrer au sein de celui-ci de telle sorte que chaque mouvement, chaque décision, enrichisse – et non pas détériore – le réseau lui-même.
Subtil, n’est-ce pas ? À noter que cette vision du leadership fait de plus en plus d’adeptes, ces temps-ci. Ainsi, Daniel Flemes, chercheur en science politique au German Institute of Global and Area Studies (Giga) de Hambourg (Allemagne), estime dans ses travaux que «les leaders qui ne saisissent pas l’importance vitale de l’intelligence interactionnelle ne font pas que manquer les trains qui passent sous leur nez, ils perdent considérablement en pouvoir et en influence, et donc en leadership».
Idem, Joshua Cooper Ramo, vice-président et codirecteur général du cabinet-conseil Kissinger Associates et auteur de The seventh sense : Power, fortune, and survival in the age of networks, montre dans son bestseller que les leaders se doivent désormais de développer un «nouvel instinct», à savoir l’intelligence interactionnelle. «De nos jours, tout leader qui souffre d’une faible intelligence interactionnelle perd automatiquement en légitimité, sans même comprendre pourquoi, note-t-il. Et cela s’explique en grande partie par le fait que «ce type de leader ne voit qu’incohérences tout autour de lui et réagit, en conséquence, en figeant sur ses positions arrêtées, incapable qu’il est de percevoir là les fantastiques occasions de progrès qui se présentent à lui».
Bien. Maintenant, qu’en est-il de Donald Trump ? Les derniers travaux universitaires de Jessica Becker permettent de s’en faire une juste idée...
La toute nouvelle analyste d’Affaires mondiales Canada, l’entité qui gère les relations diplomatiques de notre pays, a en effet passé plusieurs semaines à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, en février dernier. Son objectif : analyser le vaste réseau de connexions officielles qui s’y trouve et identifier le meilleur moyen de le rendre efficace.
La chercheuse canadienne s’est rendue à El Paso (Texas), Ciudad Juarez (Chihuahua), Douglas (Arizona), Agua Prieta (Sonora) et Nogales (Arizona). Elle a mis au jour les différents réseaux de connexions qui s’y trouvent, ceux qui sont apparents comme ceux qui sont sous-jacents. Elle a identifié les acteurs principaux de ces réseaux-là – les garde-frontières, les dirigeants des consulats, les défenseurs des droits humains, etc. Et elle a regardé comment ils interagissaient entre eux.
Mme Becker a ainsi noté qu’un réseau de connexions efficient à une frontière présentait trois caractéristiques :
– Médiation. Des acteurs jouent le rôle de médiateurs entre les individus aux intérêts divergents.
– Confiance. Le réseau de connexions ne peut en aucun cas faire preuve d’harmonie, voire de résilience, si la confiance n’y règne pas.
– Centralité. Les acteurs qui occupent une position centrale dans le réseau de connexions déterminent en grande partie son efficience. S’ils agissent de manière bienveillante, l’harmonie a de fortes chances de voir le jour en son sein. En revanche, s’ils se comportent de manière malveillante, la discorde risque fort de prédominer.
Autrement dit, un mur toujours plus long et plus haut, accompagné de tirs de gaz lacrymogène sporadiques, est l’exacte antithèse d’un réseau de connexions efficient. Cela témoigne de toute évidence d’une rigidité extrême, pis, d’une coupure brutale au beau milieu du réseau de connexions frontalier. Ce qui plombe totalement le leadership de Donald Trump.
«En refusant de voir la frontière comme un réseau de connexions subtil, l’État américain court le risque de prendre des décisions de politique internationale néfastes, pour ne pas dire lourdement dommageables, pour son propre pouvoir au sein de celui-ci, note-t-elle dans une étude. Car dès lors, il ne peut tirer parti de la dynamique du réseau, ce qui, inévitablement, profite à d’autres.»
Et de résumer : «C’est bien simple, tout leader dénué d’intelligence interactionnelle va vite perdre la barre du navire pour finir par se retrouver en soute, au beau milieu des passagers».
Vers un «plan Marshall» pour le Mexique et l’Amérique centrale ?
Voulez-vous à présent une preuve flagrante du leadership écorné de Donald Trump ? Parfait, j’ai alors un «scoop» pour vous…
Pour commencer, j’ai une petite question à vous poser : Avez-vous remarqué combien le Mexique se montre discret à propos de la «caravane» de migrants qui se rue vers la frontière américaine ? Oui, vous souvenez-vous de la moindre déclaration fracassante du tout nouveau président mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) ? J’imagine que rien ne vous vient en tête. Du moins, rien de précis.
Comment cela se fait-il ? Eh bien, sachez que celui qui va officiellement entrer en fonction le 1er décembre ne se tourne pas les pouces en attendant samedi. Loin de là. J’ai appris qu’il est en train de négocier avec Washington, et qu’il s’apprêterait même à faire un coup de maître…
Le Mexique sait que la vague de Honduriens qui crée en ce moment des troubles à la frontière mexicaine n’est rien comparé à celles qui vont venir dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Et les Etats-Unis en ont tout aussi conscience : le triangle d’Amérique centrale que forme le Honduras, le Salvador et le Guatemala s’illustre par la violence qui y sévit, San Salvador (Salvador) et San Pedro Sula (Honduras) figurant d’ailleurs parmi les villes les plus dangereuses du monde, si bien qu’on peut raisonnablement s’attendre à de nouvelles «caravanes» de migrants de ces pays-là, effrayés par les violences civile et policière.
Du coup, le nouveau gouvernement mexicain a le gros bout du bâton puisqu’il ne dépend que de lui d’y mettre un frein, ou pas. L’idée d’AMLO ? Exiger carrément que les Etats-Unis lancent un gigantesque «plan Marshall» en faveur du Mexique et de l’Amérique centrale, en échange de quoi il empêchera toute caravane de traverser son territoire du sud au nord !
Les grandes lignes du plan qui est actuellement discuté sont les suivantes, d’après mes sources :
– Les Etats-Unis verseraient «au moins 20 G$ US» au Mexique sur une période de six années, histoire de dynamiser son économie.
– Les Etats-Unis verseraient simultanément «au moins 1,5 G$ US» aux pays d’Amérique centrale afin qu’ils puissent eux aussi dynamiser leurs économies. Pour l’instant, la seule aide directe des États-Unis à leur égard correspond au Central America Prosperity Project, né en 2014 : il s’agit d’une mince enveloppe de 600 M$ US, dont seulement 200 M$ US ont été versés jusqu’à présent.
– Le Mexique «absorberait» alors les quelque 200 000 migrants qui traversent chaque année son pays en direction des Etats-Unis, en leur offrant du travail dans le sud, une zone géographique défavorisée sur le plan économique. D’ores et déjà, trois grands projets ont été identifiés en ce sens :
1. La reforestation du Chiapas. Il s’agirait surtout de planter des arbres fruitiers, ce qui permettrait la création de quelque 400 000 emplois.
2. La construction de la ligne de chemin de fer Maya, au sud-est de la capitale Mexico. Cette ligne longue de 1&Nbsp;500 km traverserait les États de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatan et Quintana Roo.
3. La construction d’une nouvelle voie ferrée du Transitmico, qui relierait Oaxaca à Veracruz.
– Le Mexique mettrait en place un programme de «visas humanitaires», qui permettrait aux migrants d’Amérique centrale de séjourner et de travailler pendant un an au Mexique. Ce visa serait renouvelable à certaines conditions, notamment celle d’avoir un revenu fixe et régulier au moment de la demande de renouvellement.
Et vous savez quoi ? Il paraît que l’administration Trump – et le président américain lui-même – ne serait pas opposé à un tel «plan Marshall». Elle le verrait même d’un bon œil, paraît-il…
On le voit bien, le leadership de Donald Trump a pris un méchant coup en raison de son manque cruel d’intelligence interactionnelle : pour arrêter les migrants à la frontière, il va vraisemblablement lui falloir mettre la main à la poche et dépenser sans compter l’argent des contribuables américains. Et ce, rien qu’en raison de son incapacité à voir le monde autour de lui comme un vaste réseau de connexions, obnubilé qu’il est à réfléchir encore en termes basiques d’actions et de réactions, ou encore de pressions en vue d’obtenir la soumission. Tout bonnement parce qu'il agit en leader du 20e siècle en ce début de 21e siècle.