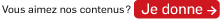Une manifestation contre la pauvreté à New York en 2017 (source: Getty)
ANALYSE GÉOPOLITIQUE – C’est un mantra répété par les leaders politiques et économiques : il faut réduire les inégalités. Or, non seulement ils connaissent souvent mal les causes de leur augmentation, mais ils ne voient pas non plus la solution logique pour les réduire, soit la reconstruction d’un État-providence moderne et la hausse probable des impôts pour les riches, disent des spécialistes.
L’enjeu est de taille, car la montée des inégalités crée de l’anxiété économique, mine la cohésion et la stabilité de nos sociétés, en plus de favoriser l’élection de partis populistes de gauche et de droite, soulignent diverses études.
Contrecarrer la montée la montée des inégalités vient donc un impératif, voire une urgence nationale et internationale, pour éviter la répétition d’une crise sociale comme celle des gilets jaunes en France. C'est le prix à payer pour rétablir un équilibre et une paix sociale.
Avons-nous toutefois la volonté collective de le faire?
Avons-nous la volonté de rétablir un filet de protection sociale universel et généreux, capable de réduire à nouveau les inégalités, comme les pays occidentaux ont réussi à le faire entre 1945 et le début des années 1970?
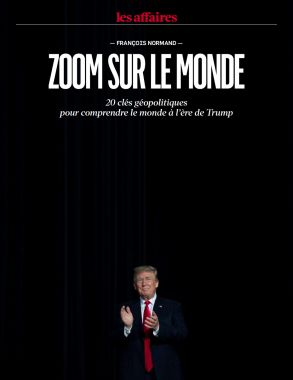
Il ne s’agit pas de reproduire une copie conforme de l’État-providence de l’après-guerre.
Mais plutôt de mettre en place un «État-providence 4.0», moderne, intelligent, flexible, qui protège les plus vulnérables de la société, réduit les inégalités avec une meilleure redistribution de la richesse et favorise l’égalité des chances.
Ce discours n’est pas que l’apanage des sociodémocrates comme le Prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz qui, lors de son passage à Montréal cette semaine, a déclaré qu’il ne fallait pas moins, mais plus d’État pour combattre les inégalités.
Même les économistes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui n’a pas la réputation de pencher à gauche, disent sensiblement la même chose.
L’OCDE vient de publier une étude dans laquelle elle s’inquiète du déclin des classes moyennes dans les pays industrialisés depuis les années 1980, qu’elle impute en grande partie à la hausse du coût du logement et aux mutations du marché du travail.
Renforcer la solidarité sociale
Pour contrebalancer ce déclin et la montée des inégalités, l’organisme propose essentiellement une plus grande solidarité sociale. Comment?
- En améliorant les services publics.
- En optimisant la couverture de la protection sociale.
- En augmentant l’offre de logements abordables.
- En taxant davantage le revenu du capital.
- En rendant l'impôt sur le revenu plus progressif et équitable.
Le Fonds monétaire international (FMI), qui n’est pas non plus à gauche, affirme aussi que l’État doit en faire plus pour combattre les inégalités.
Dans une note publiée en janvier 2018, le FMI souligne que les politiques budgétaires sont le principal outil des gouvernements pour réduire les inégalités et redistribuer les revenus plus équitablement dans la société.
Comme on peut le constater, à gauche comme à droite, il semble y avoir un consensus sur ce que doivent faire les gouvernements pour réduire les inégalités.
Le problème, c’est qu’on réfléchit rarement à la manière de financer cette lutte aux inégalités, une lutte qui implique nécessairement des hausses des impôts. Pourtant, c’est le nerf de la guerre et, surtout, une logique comptable implacable.
Bien entendu, dans l’état actuel des choses, on voit mal comment des hommes et des femmes politiques peuvent bien se présenter devant les électeurs pour leur «vendre» des hausses d’impôts.
Les classes moyennes -qui sont endettées et voient leur niveau de vie stagner depuis des années- étouffent déjà et peinent à joindre les deux bouts. La fronde serait immédiate et compréhensible. Le compromis, on le devine, est d’imposer les contribuables les plus riches, qui ont les moyens de payer.
Mais là encore, ce n’est pas une panacée, car plusieurs d’entre eux pourraient déménager.
Pourtant, il faudra bien débattre de cet enjeu, si nous voulons vraiment réduire les inégalités. Et surtout réfléchir collectivement sur l’origine de la remontée des inégalités en Occident depuis les années 1980.
Ce n’est le fruit du hasard, soulignent les historiens.
C’est en fait le résultat de politiques publiques.
Tout a débuté quand des gouvernements, endettés et inspirés par la révolution néolibérale de Ronald Reagan et Margaret Thatcher, ont commencé à réduire la taille et l’intervention de l’État dans la société.
Ils ont alors privatisé des sociétés d’État offrant souvent des services publics, déréglementé l’économie, libéralisé le commerce international et, surtout, réduit les impôts des particuliers et des sociétés.
Certes, les entreprises, les investisseurs, les particuliers (surtout les riches) en ont profité, malgré l’effritement de l’universalité et de la générosité des programmes sociaux.
Les baisses d’impôts ont aussi stimulé la croissance économique et l’investissement.
En revanche, les plus vulnérables (les pauvres, les citoyens peu éduqués, les ouvriers, les employés à statut précaire, etc.) ont pâti de l’attrition des services publics, sans parler de la stagnation du niveau de vie de classe moyenne, notamment aux États-Unis.
Bref, la réduction de la taille de l’État n’a pas profité à l’ensemble de la population.
C’est un échec, a même déclaré cette semaine Joseph Stiglitz.
Un échec qui a d’ailleurs nourri le populisme en Occident.
Pourquoi? Parce que l’érosion des programmes sociaux et du système de redistribution de la richesse à l’aide l'impôt a favorisé la montée des inégalités et l'insécurité économique, selon diverses études.
Une insécurité qui, depuis la récession mondiale de 2008-2009, incite de plus en plus d'électeurs à rejeter les partis traditionnels (qui ne s’intéressent guère plus généralement aux classes populaires ) pour se tourner vers des partis populistes.
L'effritement du bien commun
Fondamentalement, la montée du populisme est le symptôme d'une crise socio-économique et de l'effritement du bien commun, selon Michael J. Sandel, professeur de philosophie politique à l'Université Harvard.
Si les solutions sont connues, encore faut-il avoir la volonté de les appliquer. De plus, comprendre pourquoi on a mis en place l’État-providence après la Deuxième Guerre mondiale est crucial dans ce débat.
À l'époque, les élites politiques ont créé les programmes sociaux universels à la suite de la crise économique et politique des années 1930, qui a contribué à la montée du fascisme et au déclenchement de la guerre.
L’État-providence était donc vu comme une infrastructure sociale pour endiguer la misère humaine et le désespoir qui avaient nourri l’extrême droite. Et, pendant la guerre froide (1945-1991), pour endiguer la montée des partis communistes en Occident.
Or, la révolution néolibérale a affaibli cette digue, et nous en payons aujourd’hui le prix.
Mais il est encore temps de la restaurer, si nous le voulons vraiment.