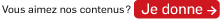Une maison endommagée par un ouragan (source: Getty Images)
ANALYSE GÉOPOLITIQUE – Les lapins ne doivent pas surveiller la laitue. Cette métaphore illustre pourquoi ce sont les banques centrales qui ont la responsabilité de stabiliser les prix et non pas les gouvernements, car ils pourraient utiliser la planche à billets pour financer leurs dépenses. Et si on faisait la même chose avec le climat, en confiant sa stabilisation à des institutions publiques indépendantes du politique?
Comme les banques centrales, ces «agences du climat» -une par pays, dans le meilleur des mondes- seraient dirigées par des gens nommés par les gouvernements, comme le fait Ottawa, pour le gouverneur de la Banque du Canada, ou Washington, pour le président de la Réserve fédérale américaine.
Mais une fois nommés, ils sont indépendants.
Contrairement aux politiciens, ils n’ont pas besoin de se faire réélire, ils sont difficiles à influencer et ils n’ont pas à tenir compte du pouvoir d’intérêts privés dans le financement des partis politiques, comme aux États-Unis.
Bref, les banquiers centraux peuvent faire leur travail : gérer la masse monétaire et maintenir l’inflation relativement basse, notamment grâce au taux directeur sur lequel s’alignent les agents économiques.
C’est ce qui assure la stabilité des prix dans l’économie.
Or, cette condition est essentielle pour l’entreprise qui a un projet d’expansion, un jeune couple qui envisage d’acheter une maison ou un investisseur qui veut gérer son risque de taux d’intérêt.
Revenons au climat maintenant.
Les gouvernements pourraient certes continuer à fixer les objectifs pour lutter contre le changement climatique. Par contre, ces agences du climat indépendantes auraient carte blanche pour atteindre les objectifs, dans le cadre de la loi.
Elles seraient les fiduciaires du capital naturel et de sa gestion durable.
Ainsi, si la réduction des émissions de GES nécessite d’imposer par exemple une taxe de 40 cents le litre sur l’essence vendue à la pompe, les agences du climat l'imposeraient malgré la grogne populaire et les pressions des élus.
Les citoyens devraient modifier leurs comportements, tandis que les gouvernements devraient développer rapidement de nouvelles offres de transport en commun. On pourrait même imaginer une formule pour indemniser les gens défavorisés.
Les entreprises pâtiraient d’une telle hausse, mais elles s’adapteraient et innoveraient, comme elles le font toujours. Dans notre système capitaliste, le signal des prix est fondamental pour obtenir des résultats, disent les économistes.
Le statu quo n’est plus une option
Il va sans dire que cette suggestion de créer des agences du climat indépendantes fera bondir des politiciens, des analystes politiques, des citoyens, sans parler de groupes de pression qui tirent avantage du statu quo.
C’est normal, car elle remet en cause un paradigme auquel nous nous sommes habitués : les politiciens déterminent et tentent de faire respecter des cibles pour lutter contre le changement climatique provoqué par l’activité humaine.
Or, malgré certaines avancées au fil des décennies, principalement au niveau des villes, cette stratégie des «petits pas» -pour reprendre l’expression de l’ex-ministre français de la Transition écologique, Nicolas Hulot- est un échec, affirment les scientifiques.
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) continuent à augmenter. Nous consommons les ressources de la planète à un rythme supérieur à leur cycle naturel de renouvellement. Et notre mode de vie est en train de provoquer la sixième extinction de masse des espèces dans l’histoire de la Terre.
Bref, nous vivons une crise écologique très grave, qui représente le plus grand défi auquel l'humanité n’a jamais été confrontée.
Aussi, il faudrait y penser deux fois avant de brûler cette suggestion sur la place publique.
En entretien à Les Affaires, François Delorme, professeur de l’économie de l’environnement à l’Université de Sherbrooke, affirme que cette idée est intéressante et qu’elle mérite d’être étudiée en profondeur et débattue.
Cet économiste connaît très bien ces enjeux, car il collabore au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), créé par l’Organisation des Nations unies (ONU) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM), afin d’évaluer le changement climatique.
Selon lui, le temps des demies-mesures est révolu.
Et comme nous n’avons pas changé suffisamment notre mode de vie, nous devons absolument accélérer le pas pour limiter l’impact des bouleversements du climat sur la planète.
Le problème, c'est le manque de volonté politique
Les solutions sont connues : il faut délaisser les énergies fossiles, il faut consommer en fonction des capacités réelles de la Terre et il faut protéger les écosystèmes et la biodiversité.
C’est la volonté politique et individuelle qui fait cruellement défaut. Or, plus nous attendons, plus les solutions deviendront radicales et coûteuses, selon François Delorme.
Nous commençons seulement à subir le réchauffement du climat. Et il nous reste peu de temps pour tenter de limiter les dégâts pour les prochaines générations.
Selon le GIEC, nous avons en fait jusqu’en 2040-2060 environ pour stabiliser le réchauffement de la Terre sous la barre des 2 degrés Celcius par rapport au début de l’ère industrielle, au 19e siècle.
Or, l’ONU redoute une hausse des températures supérieures à 3 degrés si les pays signataires de l’Accord de Paris sur le climat ne font pas plus d’efforts.
Un tel scénario serait une catastrophe qui aurait un impact immense sur les sociétés et l’ensemble des écosystèmes dans le monde.
La civilisation telle que nous la connaissons pourrait même être compromise, estiment certains spécialistes.
Dans ce contexte, voulons-nous vraiment laisser aux politiciens le soin de mener cette bataille?