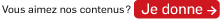Les investisseurs présents dans l'écosystème montréalais des start-up reçoivent chaque année des milliers de demandes d'investissement. Or, moins de 5 % de ces jeunes pousses réussissent à obtenir du financement. Qu'est-ce qui les distingue des autres ?
«Décider d'investir dans une société en démarrage repose parfois sur des facteurs très subjectifs. Il peut s'agir d'une société qui veut percer un secteur dans lequel nous avons eu une sortie payante récemment ou d'une entreprise qui s'est démarquée par la qualité de son introduction», confie Chris Arsenault, associé principal chez iNovia Capital, un fonds de capital de risque qui compte 500 millions de dollars sous gestion. M. Arsenault dit regarder quelques facteurs dès le départ, dont l'expérience et le bagage de l'entrepreneur, de même que l'état du marché par rapport au produit qui sera lancé. «Le commerce électronique existe depuis une vingtaine d'années et il serait très difficile pour n'importe quelle start-up de s'y démarquer. Par contre, si le marché est jeune et potentiellement énorme, l'occasion est là», explique-t-il.
Du côté de BDC Capital, division de la Banque de développement du Canada, on examine surtout cinq critères avant de faire un choix. En plus de la qualité de l'équipe de direction, l'entreprise doit bien cadrer avec la stratégie d'investissement du fonds. «Nous cherchons un modèle d'affaires disruptif. Nous ne cherchons pas des améliorations de produits qui existent déjà, mais plutôt des innovations radicales», explique Dominic Bélanger, directeur général des investissements-fonds. Les dirigeants doivent également connaître les métriques de l'industrie et de leur produit. «Chaque industrie a ses unités de mesure. Le commerce électronique ne se mesure pas de la même manière que la fabrication de vêtements», illustre M. Bélanger.
Pour ce qui est des produits, les entrepreneurs devraient, par exemple, être capables d'évaluer le coût d'acquisition et de rétention d'un client, sa valeur durant sa relation avec la société et le ratio de perte de clients. Pour les entreprises qui offrent des services dans l'infonuagique, la croissance du revenu récurrent mensuel est un indicateur incontournable.
La particularité du modèle d'affaires de BDC Capital est qu'elle investit directement 50 M $ par année dans les entreprises technologiques au Canada, mais aussi 100 M $ dans divers fonds (elle a entre autres des articipations dans Real Ventures, iNovia et TandemLaunch).
Changement de paradigme
«Après un peu plus de quatre ans, on s'est rendu compte qu'il était très difficile de prévoir, au tout début du parcours, si une start-up allait avoir du succès ou non. La façon la plus simple de s'y prendre, c'est de laisser les jeunes pousses s'auto-éliminer», croit Xavier-Henri Hervé, directeur général chez District 3 Innovation Center, l'accélérateur de l'Université Concordia.
Certains dirigeants vont, par exemple, constater après quelques mois que leur modèle d'affaires ne tient pas la route. «On a tendance à créer un entonnoir assez fort et, quand huit équipes entrent à l'accélérateur, il est rare que plus de trois ou quatre d'entre elles terminent le programme», affirme-t-il.
M. Hervé, l'un des cofondateurs du fabricant de simulateurs de vol Mechtronix, ajoute que l'accélérateur cherche des entreprises offrant un produit qui comble un besoin non satisfait. «Nous voulons des gens qui peuvent nous expliquer à quel besoin ils répondent et en quoi ils auront une véritable valeur ajoutée. Il n'est pas question d'améliorer un peu un produit existant, il faut provoquer un changement de paradigme», dit-il.
Les dirigeants qui veulent entrer chez District 3 doivent être prêts à se remettre en question. «Nous cherchons des équipes de direction qui sont prêtes à retrousser leurs manches et à se mettre les mains dans le cambouis pour arriver à leurs fins», ajoute-t-il.
Sylvain Carle, directeur général de l'accélérateur FounderFuel, parle aussi de l'importance de l'équipe initiale de direction, qui comprend souvent deux ou trois personnes. «Pour te joindre à l'accélérateur, il faut que tu arrives au moment où tu commences à présenter ton produit à des clients potentiels. Il n'est pas nécessaire d'avoir généré des ventes, mais il faut trouver un objectif significatif en lien avec ce que les dirigeants sont en train de bâtir», explique-t-il.
Le dirigeant, aussi associé au fonds Real Ventures, donne l'exemple d'une entreprise de robotique dont l'objectif, au sein de l'incubateur, était de trouver 10 laboratoires universitaires prêts à essayer son kit de développement. Un autre objectif, dans un contexte de modèle d'affaires reposant sur le nombre d'utilisateurs, pourrait être d'aller chercher 10 000, voire 100 000 abonnés en trois mois. «Les objectifs sont très différents selon les types d'entreprises», dit M. Carle.
Lorsque les entreprises ont leurs premiers clients et sont à l'étape de la croissance, elles peuvent aller frapper à la porte de Real Ventures pour tenter d'obtenir un montant variant de 500 000 $ à 1 M $. À cette étape, les critères de sélection sont différents. «Chez Real Ventures, avant d'investir, il faut que je comprenne qu'un jour ta société va valoir 100 M $. Bien sûr, le cheminement ne se fera pas en ligne droite, mais il faut que tu m'expliques comment tu penses te rendre là», raconte Sylvain Carle.
Une entreprise qui génère 5 cents de revenus par utilisateur aurait besoin de 2 milliards d'abonnés pour générer un chiffre d'affaires annuel de 100 M $. Un bassin trop grand pour pouvoir atteindre cet objectif.
Sylvain Carle décrit les bons entrepreneurs en une petite formule : le potentiel multiplié par le momentum. «Le momentum, c'est ce que tu fais pour avancer dans la bonne direction, la vitesse à laquelle tu progresses. Je rencontre beaucoup de gens qui ont du potentiel, mais peu qui ont aussi du momentum. Ceux et celles qui possèdent cette combinaison seront capables de se faire financer», dit-il.
Apprendre à vivre avec l'échec
Le fonds d'investissement en capital de risque 500 Startups Canada, filiale de l'entreprise américaine 500 Startups, a annoncé à la fin du mois de mars la conclusion d'un financement de 30 M $ qui servira à réaliser une cinquantaine d'investissements au pays au cours des trois prochaines années. L'un des associés de l'entreprise, David Dufresne, souligne aussi l'importance de négocier avec des entrepreneurs d'expérience, que ceux-ci aient connu le succès ou l'échec dans le passé.
«Nous avons une approche très américaine lorsque nous analysons un entrepreneur qui a vécu un échec commercial avec une entreprise. Nous ne voyons pas l'échec comme un handicap ou une faiblesse, pourvu que nous saisissions pourquoi ça n'a pas fonctionné. Il faut aussi que l'entrepreneur comprenne quelles erreurs ont été commises, afin d'éviter de les reproduire», dit-il.
M. Dufresne concède que, si un échec commercial est le résultat d'une «grossière incompétence» de l'entrepreneur, il ne sera pas intéressé à investir. Par contre, il sera plus indulgent s'il comprend que le marché n'était pas prêt pour le produit et la technologie. «Parfois, des compétiteurs profitant de plus gros investissements ont réussi à arriver en premier sur le marché et à le dominer. Nous pouvons alors faire la part des choses», explique-t-il.
L'entrepreneur doit avoir appris de cette expérience au moment de se constituer une nouvelle équipe de direction pour démarrer un autre projet. Lorsqu'un entrepreneur arrive à s'entourer des mêmes dirigeants et investisseurs que dans l'entreprise qui n'a pas fonctionné, il s'agit d'un signal fort que l'échec n'était pas attribuable à l'incompétence de l'individu, selon M. Dufresne.
FINANCEMENT DES START-UP : MONTRÉAL AU 2E RANG
La région de Montréal est au deuxième rang au Canada en ce qui a trait aux pôles d'importance qui attirent le plus de capital de risque. Juste après la région de Toronto-Waterloo. Selon le rapport MoneyTree, réalisé conjointement par PwC et CB Insights, Montréal a attiré des investissements totalisant 334 millions de dollars américains (M $ US) en 2016, une hausse de 8 % sur un an.
Le document précise que Toronto et Waterloo ont obtenu respectivement 578 M $ US et 253 M $ US en capital de risque l'an dernier.
Au total, 41 transactions ont été conclues à Montréal en 2016, en hausse de 11 % sur un an. Plus précisément, le document a répertorié 43 transactions au Québec, dont 11 en téléphonie mobile et télécoms (d'une valeur totale de 132 M $ US), 5 dans les soins de santé (116 M $ US), 10 dans Internet (25 M $ US), 4 dans les logiciels (8 M $ US) et 11 dans d'autres secteurs (56 M $ US).
Un autre rapport, le «Portrait de l'écosystème start-up montréalais» (PESM), publié en novembre dernier, brosse un portrait du monde du financement des sociétés en démarrage de 2011 à 2016. Selon le document, le fonds Real Ventures a été l'investisseur le plus actif durant la période, avec 40 transactions, suivi de la Banque de développement du Canada (20) et des accélérateurs FounderFuel (17) et District 3 Innovation Center (13).
Ces données sont toutefois contestées, notamment par District 3, qui dit ne pas investir dans les sociétés qu'il accompagne, tout comme le Canadian Technology Accelerator Digital NYC, cité dans le document comme ayant participé à 7 transactions entre 2011 et 2016.
«Nous souhaitons toutefois réaliser un premier investissement d'ici juin», précise Xavier-Henri Hervé, de District 3.
Le PESM a été produit à partir de données recueillies sur les plateformes CrunchBase et PitchBook, qui répertorient les investissements dans les start-up. «Les bases de données ont défini ces investisseurs comme des acteurs clés dans les transactions», soutient Christian Bélair, président et cofondateur de la société montréalaise Credo, à l'origine de l'écriture du PESM. M. Bélair ajoute que le document a une définition très stricte du terme start-up. «Nous avons pris la même définition que celle qui est utilisée dans l'étude «Start-up Genome», produite par l'entreprise californienne Compass et reprise par le rapport «Regional Queensland Start-up Ecosystem» en Australie. Notre définition met de côté certains secteurs d'activité, comme les biotechs, les nanotechs et les fintechs, où les cycles de vie sont beaucoup plus longs que dans les technologies de l'information», dit-il
De plus, les start-up de services-conseils, qui conçoivent uniquement des composantes (hardware), ont aussi été exclues du rapport. «À Montréal, il y a beaucoup plus de joueurs dans le monde des start-up que ce que nous incluons dans notre définition», précise-t-il.
Des choses à améliorer dans l'écosystème montréalais ?
S'il considère que des «choses extraordinaires se passent à Montréal», Xavier-Henri Hervé estime que l'écosystème montréalais des start-up peut encore s'améliorer, notamment «aux deux bouts de la chaîne».
«En amont, on a 200 000 étudiants à Montréal et on a des centres de recherche parmi les plus importants du monde dans certains domaines, comme la biologie synthétique. De l'autre côté, on a un faible pourcentage de transformation de ces gens en entrepreneurs, en innovateurs. Quand tu vas à San Francisco, dans tous les laboratoires à peu près corrects, chacun des chercheurs aura au moins une start-up à son palmarès. Ici, c'est l'inverse : s'ils ont une start-up à leur palmarès, les chercheurs ne veulent pas en parler», affirme-t-il.
M. Hervé estime également qu'à l'autre bout de la chaîne, les start-up qui arrivent à une certaine étape doivent être adoptées par des financiers ou des clients. «Quand on va à Boston ou à San Francisco, les gens font la queue pour parler aux dirigeants de start-up. Ici, ce sont les start-up qui doivent déployer des efforts considérables pour obtenir la confiance de clients potentiels. Le Québec a besoin de plus de gens, au niveau local, qui vont faire confiance aux start-up», dit-il.
Pour remédier au problème, District 3 souhaite, plus tard cette année, lancer le programme Early Adoption en partenariat avec l'École de technologie supérieure (ÉTS).
David Dufresne, associé de 500 Startups Canada, ajoute que la région de Montréal est historiquement très forte sur les plans de l'ingénierie et du développement. «Il y a beaucoup de créativité en ville avec les industries du cinéma et de la télévision, sans oublier celle du jeu vidéo ou des entreprises comme le Cirque du Soleil», dit-il.
Par contre, M. Dufresne souligne que la région de Montréal est historiquement moins bonne pour commercialiser ses produits et ses innovations. «Ce que je trouve intéressant, c'est qu'une certaine maturité s'installe à Montréal. On commence à avoir des sociétés qui passent avec succès l'étape de la commercialisation, comme Lightspeed, Frank & Oak et Busbud. On crée une masse critique d'employés et d'investisseurs qui sont capables d'amener des entreprises à l'étape suivante», affirme-t-il.
L'accélérateur InnoCité MTL, créé en juin 2015 avec la mission de faire du maillage entre les start-up, les villes, les investisseurs et différentes organisations des secteurs public et privé, constitue peut-être aussi une réponse à cette problématique. L'accélérateur a déjà parrainé 14 entreprises qui ont signé 80 ententes, dont 37 avec le secteur privé, 21 avec le secteur public et 22 avec des municipalités, comme Montréal et Brossard.