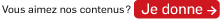«Après l'activisme, les entrepreneurs sociaux amorcent l'ère de la collaboration» - Sally Osberg, pdg de la Skoll Foundation.
Sally Osberg dirige une des plus vastes pépinières d'entrepreneurs sociaux du monde, la Skoll Foundation, de Californie. Le Canadien Jeff Skoll, qui a été le premier pdg d'eBay, met sa fortune au service de ce type d'entrepreneuriat. La Skoll Foundation provoque la réflexion autour de l'impact social. J'ai interviewé Mme Osberg lors de la 13e édition du Skoll World Forum on Social Entrepreneurship, qui a eu lieu à la mi-avril, en Angleterre.
Visitez le blogue de Diane Bérard
À lire aussi : Les 3 défis du nouveau secteur de l'impact social
Diane Bérard - Le Skoll World Forum on Social Entrepreneurship en est à sa 13e édition. Le secteur semble atteindre un point de bascule. Racontez-nous.
Sally Osberg - Les entreprises sociales sont créées dans le but de résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux. Pour y arriver, elles doivent proposer des solutions adaptées à la taille des problèmes auxquels elles s'attaquent. D'où la nécessité de passer à un autre niveau. Les 1 000 participants de notre 13e édition ont beaucoup parlé de stratégies de croissance. Des modèles qui ont de l'impact et de ceux qui en ont moins. Ils ont déterminé les obstacles, formels et informels, qui empêchent ou ralentissent la croissance des entreprises sociales.
D.B. - On sent un nouveau regard critique, une sorte de maturité du secteur...
S.O. - Je parlerais d'humilité. Les problèmes auxquels s'attaquent les entrepreneurs sociaux sont souvent systémiques. Pour trouver des solutions, il faut comprendre le système qui les a fait naître et qui les perpétue. Reconnaître cette complexité force ces entrepreneurs à se montrer plus stratégiques dans le choix de leurs méthodes et de leurs partenaires ainsi que dans la nature de leurs relations avec les gouvernements et le secteur privé.
D.B. - Certains participants ont évoqué la «businessisation» du secteur de l'entrepreneuriat social. Que faut-il en penser ?
S.O. - Pour moi, il y a «businessisation» et monétisation. Dans les deux cas, ce peut être positif ou négatif, selon l'intention finale. Comme je la comprends, la «businessisation» consisterait à adopter certains principes de gestion du secteur privé. Entre autres, la satisfaction des besoins des clients. Et la conscience que ces clients ont le choix. Ce n'est pas parce qu'une entreprise s'attaque à un problème social qu'elle doit traiter l'utilisateur comme s'il n'avait aucun autre choix que de consommer son produit ou son service. Vue ainsi, la «businessisation» de l'entrepreneuriat social est positive. La monétisation, c'est le désir de générer un revenu suffisant pour permettre de durer et d'étendre son impact. La «businessisation» et la monétisation des entreprises sociales sont positives lorsque la finalité n'est pas de générer des revenus, mais d'accroître l'impact.
D.B. - On a parfois l'impression que la vraie place de l'entrepreneuriat social se trouve dans les pays émergents. Quel rôle joue-t-il dans les pays développés ?
S.O. - Il joue un rôle essentiel. Le système de santé américain, par exemple, est très inégalitaire. Plusieurs entrepreneurs sociaux s'affairent à aligner les services sociaux et de santé afin que les pauvres aient accès à des services lorsqu'ils sont malades, mais aussi à des services qui les empêchent de tomber malades. Le secteur de l'éducation, lui, a des failles dans tous les pays avancés. Tout comme l'accès aux services juridiques et l'intégration des immigrants. Ce ne sont pas les occasions qui manquent pour les entrepreneurs sociaux.
D.B. - La distinction entre les entreprises traditionnelles et les entreprises sociales subsistera-t-elle ? Comment ces univers évolueront-ils, selon vous ?
S.O. - Les entreprises traditionnelles subissent des incitatifs concrets pour adopter un comportement environnemental responsable. C'est bon pour leurs affaires de se pencher sur leur consommation d'eau, par exemple. Ou d'évaluer les risques que pose l'empreinte carbone de leur chaîne d'approvisionnement. C'est moins une question de responsabilité sociale qu'un enjeu de croissance et de pérennité. La réglementation n'ira pas en diminuant. Ni les demandes de transparence et d'imputabilité. Les entrepreneurs sociaux, quant à eux, visent moins à critiquer le secteur privé et davantage à l'influencer et à le rallier. Ils désirent des partenariats pour mieux rejoindre certaines clientèles ou atteindre leur mission. Bref, les entrepreneurs sociaux veulent débloquer le potentiel d'impact social et environnemental inexploité du secteur privé. On amorce une nouvelle ère. Après l'activisme, c'est le moment de la collaboration.
D.B. - Vous évoquez la nécessité de débloquer le potentiel d'impact social et environnemental inexploité du secteur privé. De quoi s'agit-il ?
S.O. - Laissez-moi vous parler de l'engagement d'Unilever dans la pêche durable. Unilever est un des plus importants acheteurs de poissons du monde. Après l'effondrement de l'industrie de la morue au Canada dans les années 1990, Unilever a constaté qu'elle se dirigeait vers une pénurie de morue si rien n'était fait. Et qu'elle avait un rôle à jouer dans la transition de l'industrie de la pêche. Elle a donc collaboré avec l'ONG Marine Stewardship Council à l'implantation de pratiques durables.
D.B. - Et c'est le rôle des entrepreneurs sociaux de débloquer ce potentiel ?
S.O. - Oui, les entrepreneurs sociaux sont des catalyseurs et des facilitateurs.
D.B. - Quels leviers possèdent-ils pour convaincre le secteur privé d'accroître son impact social ou environnemental ?
S.O. - Pour l'instant, le levier le plus prometteur me semble la gestion de risque. Les entrepreneurs sociaux contribuent à réduire le risque des entreprises traditionnelles. En s'associant à celles-ci, ils les aident à augmenter leur impact social et environnemental, donc à réduire leur risque de réputation, leur risque financier, leur risque légal, etc. Et l'angle d'approche des entrepreneurs sociaux n'est pas de montrer du doigt, de dénoncer le comportement du secteur privé. Ils proposent plutôt leur expertise.
D.B. - Parlez-nous du cas de la fabrication de tapis en Inde.
S.O. - Le détaillant américain Target travaille avec l'ONG GoodWeave pour s'assurer que tous les tapis vendus dans ses magasins n'ont pas été fabriqués par des enfants. Target ne sous-traite qu'à des manufacturiers qui ont été certifiés par GoodWeave. Seule, Target n'y serait jamais arrivée. Elle avait besoin de l'expertise de GoodWeave.
D.B. - Quelle est à votre avis la contribution la plus importante de l'entrepreneuriat social ?
S.O. - Il remet en question le paradigme voulant qu'une organisation puisse durer en reposant uniquement sur la quête du profit. Cette profitabilité sera compromise à moyen et à long terme si l'organisation ne se soucie pas d'enjeux sociaux et environnementaux. Et si elle n'en tient pas compte dans son processus de production et sa chaîne d'approvisionnement.
D.B. - Peut-on imaginer la disparition de l'étiquette «entrepreneur social», puisque toutes les entreprises auront une mission sociale ?
S.O. - Pas tout de suite ; le secteur privé est vaste. Il comporte des acteurs disparates. Certains s'adaptent plus vite que d'autres.
D.B. - Le but ultime d'un entrepreneur social devrait être de fermer boutique parce que le problème auquel il s'est attaqué a été résolu. L'entrepreneuriat social est-il une phase ?
S.O. - L'entreprise elle-même est une création plutôt récente. Et je trouve qu'elle évolue assez rapidement. Je m'inquiète bien plus du rythme d'adaptation du gouvernement aux problématiques sociales et environnementales.
Visitez le blogue de Diane Bérard
À lire aussi : Les 3 défis du nouveau secteur de l'impact social